En septembre 2019, le romancier Christophe Siébert avait été récompensé du Prix Sade pour son livre Métaphysique de la viande. L’ouvrage, réunion de deux courts romans, nous avait permis de rencontrer un auteur parmi les plumes montantes d’une littérature noire qu’on pensait laissée pour morte sur le bord de l’autoroute. A l’époque de notre rencontre, l’auteur nous avait raconté la suite de ses aventures éditoriales : Les chroniques de Mertvecgorod. Titré Images de la fin du monde, ce premier tome d’un mur qu’il est en train de construire autour de la connerie humaine, pour mieux en préserver la saveur, est sorti juste avant le confinement. L’occasion de replonger dans l’enfer noir du diable Siébert.
« Avec son vagin doté d’un lecteur sans contact, l’Escort-girl scannait les pénis pucés de ses clients et piratait leurs données bancaires ».
« Un mystérieux groupe terroriste affirme être capable de fabriquer des nano-missiles à reconnaissance faciale. »
« Pour survivre, elle a tué ses enfants, les a cuisinés et les a vendus à des restaurants chics sous forme de bocaux estampillés Made in Paradise »
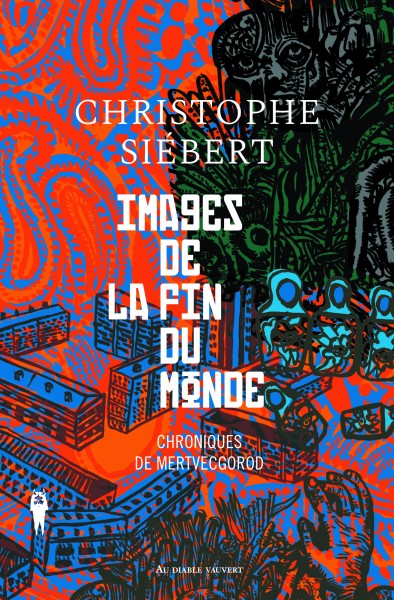
Aussi improbables soient ces histoires, elles ne proviennent pas du canard local d’un bled paumé de Tchétchénie. Ces faits divers se sont déroulés dans la RIM, comprenez la République indépendante de Mertvecgorod. Avec un nom aussi imprononçable qu’une marque de détergent ukrainien, Mertvecgorod est selon Christophe Siebert « l’alliance de différentes combinaisons de mots qui signifient plus ou moins « la ville des morts ». C’est surtout le pays fictif, tampon entre la Russie et l’Ukraine, qu’il a créé afin de donner corps à ses futurs romans. Sa capitale, énorme mégapole suintant tout ce que l’éventail de la couleur gris comptent comme nuances, ressemble au Londres monstrueux, fumant et branlant de toute part du livre Mécanique Fatale de Philip Reeve. Les romans vont ainsi établir un cycle lourd comme un char KV, ces mastodontes de l’armée rouge ayant défouraillé à tout va pendant la seconde guerre mondiale et dont Images de la fin du monde, entame la première déflagration.
Mais malgré l’excitation aussi forte qu’une louve affamée face à sa proie, on avance un peu à tâtons dans l’univers de Siébert, plutôt comme un petit chat tremperait sa patte dans l’eau pour vérifier la température avant de se baquer, car si on avait beaucoup apprécié le style et la fougue de son précédent livre, difficile de rester insensible devant le lot de saloperies balancée à la gueule : parfois poilant, souvent choquant, mais surtout extrême dans les horreurs qu’il décrivait, Métaphysique de la viande était loin de laisser de marbre. Que vaut donc ce premier voyage en terres Mertvecgorodiennes ?
MUSEE DE CHIBRES
L’entrée en matière d’une nouvelle histoire est toujours difficile à instaurer. Siébert contourne habillement l’effet de style convenu et aussi étonnant que cela puisse paraitre de la part d’un auteur qu’on sait aimer triturer la matière, pas une once de violence ou de démesure ne vient pointer à l’horizon de son pays fantasmé. Du moins pour cette mise en bouche. Le décollage est mesuré, presque doux. On comprend que la montée sera puissante, comme un lent shoot vers la folie qui semble avoir dessiné les frontières du territoire. Serions-nous face à ce que l’auteur nous racontait il y a peu : « une volonté à être plus subtil au fur et à mesure des années, une volonté d’écrire les mêmes horreurs mais qui plaisent à 100 000 personnes et non pas à 200. » ?
Dans la nouvelle en deux parties qui ouvre le livre, intitulée Comme un grand-duc en enfer, nous suivons l’enquête d’un journaliste Français fraichement débarqué à Mertvecgorod après plusieurs mois d’investigation. Son but : rencontrer Nikolaï le Svatoj. L’homme, techno-terroriste limite gourou, mystérieux personnage actif sur les réseaux sociaux du pays, prépare en fait un très mauvais coup. Avec ce journaliste, nous infiltrons rapidement l’organisation terroriste. Plus que la simple découverte d’une ville en totale déchéance racontée par le journaliste à son arrivée, c’est l’aura de ce personnage, ce le Svatoj, qui pose l’ambiance de ce que sera la suite de ces Images de la fin du monde. Nous ne dévoilerons rien mais malgré ses aspects hautement fascinants, il traine derrière lui une histoire aussi trouble que l’eau ferrugineuse qui dégueule des robinets de la ville. Accessoirement, le Svatoj est aussi un grand collectionneur de phallus célèbre. Oui oui, un musée de la bite ! Dans son catalogue de chibres, les attributs de Jimmy Hendrix ou Pablo Picasso, parmi d’autres trophées lourdement armés. L’humour, noir évidemment, n’est jamais très loin, compose lui aussi l’ambiance grotesque de ces instantanés de vie marginales. Une fois passé ce postulat de départ, simple comme un quidam rencontré à l’angle d’un comptoir nous aurait gentiment invité à prendre un verre, Siébert perd en sagesse, passe commande et boit cul-sec sans trinquer. La suite va nous mener de surprises en surprises. On entre ainsi dans les profondeurs, comme ivre sans même avoir touché une goutte, descendant dans le lard de la mégapole dégueulassée plus que d’usage, viciée jusqu’aux tuteurs en acier décharnés qui tiennent avec peine ses murs de béton crasse.

« Je suis devenu rédacteur de fausses lettres de cul pour un canard et je faisais parfois un demi numéro à moi tout seul. Certaines lettres qui sont reçues sont tellement mauvaises qu’elles sont impubliables; parfois il est préférable de faire appel à des pigistes pour nourrir le journal. » Sa science du faits divers et de la petite annonce charnue pour laquelle il a tant œuvré, Christophe Siébert la met ici au service de son récit fragmenté, comme son titre l’indique, en chroniques. S’il sait nous prendre par la main et malicieusement nous inviter à découvrir sa science-fiction sombre via des récits qui parcourent l’horreur et le gore, cernés par des parenthèses poétiques ou musicales bienvenues, on arpente plus d’une fois certaines situations sans sérénité aucune, curieux mais constamment aux aguets, suant à grosses gouttes dès qu’il s’agit de découvrir ce qui est caché derrière le mur d’une cave, pendant le vol d’un drone, dans un enregistrement vidéo pirate ou par-delà le niveau squatté d’un immeuble abandonné. Les personnages naviguent dans des tranches de vies que certains n’ont pas choisies, prenant de plein fouet les cailloux qu’on leur jette. A Mertvecgorod, les cailloux ne font pas de ricochets, ils filent droit, parpaings de béton armé. Sondant l’humain et son âme tourmentée, ses histoires marient ampleur baroque et énergie punk, que ce soit dans la peinture d’une fratrie pauvre, obligée de se lobotomiser pour se transformer en combattant mécanique et espérer faire fortune dans la nouvelle Masha et Michka, ou dans le moment de vie de cet autre journaliste, témoin forcé du meurtre d’enfants en bas âge dans la première partie de La Danse de la mort. Certaines de ces tranches de vie retrouvent l’esprit de ses précédents écrits, donne la gerbe quand d’autres sont des bijoux de noirceur sensible et de récit fantasmé. Parmi elles, la plus touchante, qui prouve au passage que Siébert est tout sauf un monstre de sadisme : l’amour n’est pas une maladie infantile, qui voit un rendez-vous entre deux paumés sur les hauteurs d’une gigantesque tour fantôme, prendre soudainement des allures de survival amoureux.
BIDOCHE
Souvent comparé à Alain Damasio, qui utilise lui aussi le récit d’anticipation pour mieux critiquer les mécanismes de nos sociétés contemporaines, Siébert n’a pas, comme peut souvent le faire l’auteur de La Horde du Contrevent, besoin de crier son talent sur tous les toits. Anxiogènes, ses mots nous noircissent régulièrement les alvéoles, peinent à nous faire reprendre notre souffle tant le débit est mitraillette et vise juste. Mais parfois Siébert cale un peu. Le style hésite, raconte sans s’aventurer, bande presque mou. Vraiment ? On pense à une baisse de libido pour mieux se rendre compte que la panne occasionnelle permet à notre cerveau de se reposer, lui laisse le temps de se remettre de ses émotions et prépare le terrain aux autres étrangetés qui composent son monde autant qu’elles le construisent. A contrario, quand il déroule, on le sent comme un bull dog s’enivrerait de l’odeur de sang d’un os fraichement arraché à son propriétaire et avec lui on jubile à mastiquer la viande. On sautille, on remue la tête dans tous les sens, sourire carnassier et bave aux coins des lèvres. La viande justement. D
ans les perles de cette dernière catégorie, la nouvelle Viande Humaine, qu’on avait déjà entraperçu dans un numéro du Gorezine, fanzine d’horreur dirigé par Luna Beretta, proche de l’auteur. Le pitch : un riche vieillard rachète un immeuble délabré afin de satisfaire la bourgeoise Mertvecgorodienne en manque de sensations fortes et le transformer en zoo humain. Le vieux, le cul vissé sur un fauteuil roulant électrique, partage ses délires sexuels entre rencontres grivoises qui tournent à l’orgie de chair et de sang ou se faire fouetter la gueule par des mâles alpha membrés comme des éléphants. Morceau choisi :
« Le chippendale gavé de stéroïdes, muscles monstrueux luisants d’huile, astique sa queue longue comme un avant-bras, si raide qu’on la croirait sculptée dans un morceau de bois, surnaturellement épaisse, violacée, aux veines énormes et sinueuses. Il se branle contre le visage du vieillard qui continue d’éructer, rouge, congestionné, bavant, les yeux exorbités. Lui aussi a sorti son sexe. Il agite par habitude entre ses doigts tordus d’arthrite le morne bout de chair sentant la pisse et la sueur mais n’éprouve rien depuis longtemps. Incapable de se résoudre à ce que le miracle ne se produise pas, ne se produira plus jamais, il branlotte avec l’énergie du désespoir, du moribond, ce bout de peau vide de chair pas plus gros que le prépuce du monstre bourré d’hormones qui grogne comme un ours en lui martelant le visage de sa matraque de chair. Le grabataire braille de sa voix désagréable, trop aigüe, mal timbrée. Il gueule, invective, insulte jusqu’au délire, perd la tête : désormais la seule façon pour lui de prendre son pied. »
S’il n’évite pas certaines redondances quant à l’évocation de la géographie de son pays, où l’on se perd parfois dans une élaboration du territoire voulue comme très (trop ?) complexe et encore quelque peu balbutiante, on sent néanmoins que la carte de Mertvecgorod se construit avec le savoir-faire de son auteur autant qu’elle se nourrit d’influences et de documentations bien précises. S’il arpentait la France dans son précédent livre, Siébert se nourrit ici de l’imagerie du communisme et de l’ex-URSS en général, traversant les époques, de son effondrement déstructuré à une fin rêvée. Les références qui le guident semble suivre le chemin des récits : nombreuses, glauques ou obscures, elles nourrissent avant tout un imaginaire détraqué mais jouissif. Comme un hideux complément à ces images dont il se gave, l’auteur met en ligne ce qu’il considère comme la bande originale idéale de ses chroniques, compilation de morceaux divers et variés, brassage foutraque allant de Tuxedomoon à Current 93, de Death in June à Coil, de Einstürzende Neubaten à Diamanda Galas ou Laibach. Du gothique, de l’indus, du post-punk. Du sombre, du loubard qui rase les murs et se bourre le pif à la suie. Rien ne se passe mal mais tout dérange sur Mertvecgorod Channel.
Le projet n’est pas participatif mais l’aventure a néanmoins quelque chose de choral, laisse à penser que Siébert, en grand maitre de l’horrible, a converti quelques mauvaises âmes à sa religion de fou. Pour preuve, l’incroyable liste de faits divers signés de plumes venues de la galaxie des autres publications horrifiques de l’auteur. Parmi eux, figurent les trois histoires citées au début de ce texte. La liste est longue mais ces faits divers, dont certains sont à pisser de rire, finissent avec la fiche Wikipédia du pays, de nourrir la mixture cauchemardesque de cette fin du monde. La suite, Siébert la voit grande :
« Le prochain roman sera plus fluide, plus long, plus romanesque et plus expérimental. Si mon plan ne change pas en cours de route, il y aura trois cycles. Le premier, qui comptera quatre tomes (dont celui-ci est le premier), met en place l’univers et installe la situation de départ jusqu’à une nouvelle situation. Le deuxième, qui comptera une ribambelle de romans courts et nerveux façon Fleuve Noir de la grande époque, explorera la situation et le troisième apportera une résolution à l’ensemble. En gros, après la mise en bouche que constitue ce premier tome, là j’attaque vraiment. »
L’apocalypse n’a qu’à bien se tenir.









3 commentaires
Mèches dans les yeux et regards langoureux voila l’écrivain priapique de son propre style
Un zest d’érotisme, de futurisme et le pigiste crie au génie