Récemment auréolé du Prix Sade, le romancier Christophe Siébert délivre avec Métaphysique de la viande le livre le plus chic et choc de l’année, réunion de deux romans à ne pas mettre sous toutes les pupilles : Nuit Noire, plongée scabreuse dans la tête d’un tueur en série bas du front et Paranoïa, transe psychotique dans une France en mal de vivre. Un conseil : avant d’entamer la lecture de ce joyaux noir et rouge, évitez tartiflettes, fondues et autres joyeusetés Savoyardes, il y a peu de chances pour que vous ayez le temps de les digérer. Rencontre avec le bourreau Siebert, gueule d’ange que le diable a définitivement adoubé comme l’un de ses suppôts.
« En vingt ans, je n’ai pas tué tant de gens que ça, deux ou trois par an, pas plus. Le reste du temps, je menais une vie presque normale. » Cette phrase est la partie immergée de l’iceberg qu’est Nuit Noire, premier bloc de l’halluciné roman Métaphysique de la viande sorti en début d’année aux éditions au Diable Vauvert.
Pour la suite, il n’appartient qu’à vous de plonger dans les eaux troubles de ce roman à la couverture signée Stéphane Blanquet. Incarnation de l’esprit du livre, elle montre une rencontre dantesque entre des êtres au-delà de la norme qui se mélange en un tout impalpable et grotesque. Quand certains choisissent de mettre leur imaginaire aux services d’elfes ou de nains, d’autres préfèrent prendre part aux errances des désaxés de toutes sortes qui font aussi la chair de notre belle nation France. Christophe Siebert est de ceux-là, un acharné, un fou. Célébré ex-aequo par le Prix Sade qui récompense « un auteur singulier et honnête homme, selon la définition de son siècle. Un authentique libéral qui sera parvenu, par-delà les vicissitudes de la Révolution et l’emprise de l’ordre moral, à défaire les carcans de la littérature comme ceux de la politique », Siebert vit son heure de gloire. Pour un homme à qui la vie à plus souvent tendu le poing que la main, la victoire n’est que plus belle.
Il fait comment Siebert pour écrire des horreurs pareilles ?
Siebert, âme solitaire, décide à 17 ans de se mettre derrière une machine à écrire pour combler l’ennui d’une vie provinciale sans relief. Il va en faire un sacerdoce, une semi-religion. Détailler tout ce qui fait le sel de la personne ne sert à rien, grâce à sa plume qui roule comme un trente-six tonnes lancé sur une route de campagne, le Diable Vauvert a édité en petit format, le texte qui raconte ses débuts. Fabrication d’un écrivain montre en quelques pages comment de semi-clochard, il deviendra rmiste, tout en continuant à arpenter l’underground avec des textes toujours plus fort, toujours plus noir. Celui qui le consacre aujourd’hui, réunit deux courts romans. Le premier, raconté à la première personne, est loin d’être une partie de plaisir. Quand il ne raconte pas un inceste, n’évoque pas un suicide, il délivre les pensées déviantes de son héros pour qui le meurtre est devenue une normalité et sa seule raison d’être On peut se lasser de ce déchainement de violence, de cette exploration ardue des sexualité marginales, de cette volonté salace de plonger le lecteur dans un inconfort permanent. Poser le livre, ce n’est pas forcément vouloir le reprendre tant les descriptions sont intenses, justes et correspondent à merveille à la déchéance d’un esprit malade auquel il est quasiment impossible de s’identifier. On vit sa lecture comme un chemin de croix dont on n’a pas envie de porter la lourde charge. On en vient même à se poser la question : Il fait comment Siebert pour écrire des horreurs pareilles ? Beaucoup ont comparé le livre à la bande dessinée de Derf Backderf, Mon ami Dahmer, qui raconte la proximité qu’a eu l’auteur avec le tueur en série de Milwaukee. Mais là où le récit de Backderf ne se concentre que sur l’adolescence de Dahmer, Siebert nous promène sur toute la triste vie de son personnage, sans jamais nous lâcher la main. A titre de comparaison, même s’il est difficile de trouver une réelle équivalence à ce que raconte le livre, la BD qui pourrait s’en rapprocher serait le Blast de Manu Larcenet. Comme Larcenet, Siebert pose un regard juste sur ces laissés pour compte dont les seuls compagnons ne sont que blessures, misères et vie intérieure tourmentée. Comme Larcenet, Nuit Noire raconte la parenthèse désenchantée d’une âme marginale, invisible aux yeux de tous et qui ne réclame qu’un seul droit : celui d’exister. C’est peut-être ça la vraie force du roman, faire parler ceux qui ne trouve jamais tribune, mettre sur la souffrance des mots que personne n’a envie de lire mais qui deviennent nécessaire pour mieux comprendre leurs auteurs. La seconde partie, Paranoïa, renoue avec la même frénésie, cette fois au service d’une histoire tordue, moins sauvage, matinée de fantastique et qui célèbrerait presque son auteur comme roi d’une alternative France profonde.
Au moment de le contacter pour parler de son livre, Christophe Siebert est devenu directeur de collection pour la maison d’édition La Musardine, spécialisée dans les publications érotiques et pornographiques, ou il tente de donner un nouveau visage à un genre en perte de vitesse : le roman porno. Il explore le domaine du fanzinat, performe aussi. Le programme est alléchant mais arrive le moment fatidique : rencontrer l’homme. Vouloir discuter avec celui qui déroule un tel flot d’insanités, c’est se demander face à qui, face à quoi même, on va se retrouver. Un bar dans Paris pour le lieu, l’été et sa canicule pour l’ambiance lourde. L’homme arrive, l’air détendu, sourire torve et chemise à fleur qui scintille. Christophe Siebert est drôle, engagé, ne parle pas pour ne rien dire et a le débit de Ricard aussi mitraillette que celui de ses paroles. Note pour une prochaine rencontre : ne pas oublier que Siebert boit son Ricard comme il parle, sec et sans eau.

Les genres que tu défends que ce soit l’horreur, le gore ou la violence sociale, ça vient d’où ?
Déjà ce n’est pas des genres que je défends. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est la violence en général. J’ai exploré cet aspect à travers de nombreuses formes et écrire Nuit Noire était pour moi un moyen de ramener la violence dans une forme que je maitrise bien : le roman porno de gare. Il y a quelques temps, j’ai écrit plusieurs romans porno pour La Musardine. Écrire un roman Porno, c’est un cahier des charges assez précis puisque les scènes de cul doivent prendre une part importante du récit. Le directeur de la collection avec qui je collaborais était assez dur et il m’a vraiment permis d’apprendre mon métier. L’idée était donc de voir si je pouvais faire rentrer ce que j’avais appris en technique dans un roman de gare qui respecterait ce cahier des charges mais qui en même temps correspondrait à mes préoccupations. A l’époque, j’en avais marre de Hannibal Lecter. Je voulais raconter un vrai tueur en série pour que les gens comprennent ce qu’il se passe dans la tête d’un gros con dangereux. Les tueurs en série connus du grand public sont toujours super intelligents, bons en cuisine, ils draguent toutes les meufs, s’habillent bien. Un tueur en série n’est rien de tout ça. C’est un mec qui deal du shit à la sortie du collège, rongé par ses pulsions et qui va défoncer des putes dans le bar d’à côté. Pour moi, tout un pan de la fiction ignorait cet aspect, soit par bêtise, soit par naïveté. Le film de référence c’est Henry, portrait d’un sérial Killer. Pour une fois, une fiction montre les choses telles qu’elles sont et il m’a servi de guide dans l’écriture du roman.
Penses-tu que ce soit par ce biais qu’il faut sonder la société pour mieux la comprendre ?
Clairement oui. On a tous des expériences de vie qui apparaissent dans un spectre assez étroit mais si on veut en comprendre les fondamentaux, il faut aller dans les marges, au-delà de ce spectre. Assez peu de livres parlent ou abordent de manière frontale la pensée des gens qui vont vraiment mal. Dans le polar, à une certaine époque un peu. La littérature en France est une littérature de classe moyenne ou les tarés, les cons, les pas fréquentables, les pas présentables n’ont pas le droit de cité et c’est justement de ceux-là dont j’ai envie de parler puisque pendant toute ma jeunesse, c’est la faune qui m’entourait. Ça me parait important de leur donner une apparence et une voix. La citation n’est pas exacte mais Arthaud disait que « la littérature sert à donner une voix aux morts, aux animaux et aux fous ». Cette phrase m’avait beaucoup marqué. En ce moment une collection renoue avec cet abord, c’est « Equinox » aux Arènes, dirigée par Aurélien Masson. Sa collection ce n’est même plus du polar, c’est du roman noir au sens qu’évoquait Robin Cooke, du roman de deuil ou du roman critique violent. Le coté policier, criminel est vraiment évacué et un livre sur deux est une bombe. Le dernier en date « Le Triomphant » de Clément Milian, qui se passe pendant la guerre de 100 ans et d’une brutalité très travaillée. Un récit très court, très sec. Tout ce que j’aime.
Nuit Noire est sorti en 2011 aux éditions Trash, mais tu l’as écrit en 2008. Contextuellement c’est quoi pour toi l’écriture de ce roman ?
Je vivais avec ma nana avec qui je ne m’entendais absolument plus. Elle partait bosser et je restais coincé chez elle, en Picardie. J’écoutais du Doom Métal à longueur de journées, j’étais en plein dépression et l’écriture à ce moment-là m’a vraiment aidé à m’en sortir. C’était la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher. Le livre a eu deux formes principales. Celle que les gens peuvent découvrir maintenant était quasiment sa forme de départ. Je l’ai beaucoup publié sur internet ou je me faisais virer des forums de Black Métal parce que les administrateurs trouvaient le récit trop hardcore. C’est drôle de constater qu’il y a dix ans je me faisais radier des forums et qu’aujourd’hui Michel Field me pose des questions sur le même livre ah, ah. On a juste viré les fautes mais sinon le bouquin n’a pas changé. La seconde forme était liée à sa publication chez Rivière Blanche. Pour des raisons d’édition, j’avais dû quelque peu diluer l’histoire actuelle. Nuit Noire est construit en trois parties et j’avais intercalé une intrigue secondaire dont je n’étais pas hyper satisfait, elle aussi en trois parties. J’y racontais sous des dehors un peu Lynchien, la vie d’un type qui a des problèmes de couple et dont on finissait par comprendre qu’il avait tué sa femme, en tous cas c’est ce qu’il croyait.
L’idée n’était pas conne mais l’histoire cassait le rythme et se trouvait hors-sujet. C’était de l’horrible aussi mais plus classique, plus polar dans la trame. Certains lecteurs préféraient cette forme puisqu’elle tempérait justement les accès de violences et les horreurs qui font le récit paru au Diable Vauvert.

Ça se construit comment un livre comme celui-ci, y projettes-tu des fantasmes ?
Dans le livre à part l’histoire, tout le reste vient de moi. J’aime beaucoup beaucoup le concret, quitte à lui apporter un soin presque maniaque dans sa reproduction. J’ai construit le livre via une structure extrêmement forte ou chaque séquence fait 333 mots, ce qui a rendu folle la correctrice ah ah. Cela rentrait dans une logique. Dans l’univers de fiction que j’ai bâti, le bouquin existe vraiment. Dans mon esprit, le tueur à réellement écrit son livre, l’a envoyé à des éditeurs et s’est fait jeter, mais le bouquin est réel. Pour mon tueur, ce bouquin c’est son temple, il respecte donc les règles mystiques qu’il s’est fixé et c’est grâce à ça qu’il va revenir nous hanter une fois mort. Pour les autres aspects, dès que je parle d’un lieu ou d’un objet dans l’histoire, je l’ai soit visité, soit utilisé. Je suis très mauvais en imagination, je me suis donc beaucoup documenté pour écrire Nuit Noire ; les bouquins de Stéphane Bourgouin, les essais sur les tueurs en série, des témoignages. Je voulais en faire un tueur qui serait une synthèse du tueur en série. Tous les aspects qui font le personnage était déjà présents : les problèmes familiaux, les problèmes avec la mère, les fantasmes mystiques, la progression du fantasme des animaux vers les hommes, la construction du rituel, tout ça je l’ai tiré du monde réel. Le seul élément rajouté est le fait d’avoir rendu ses pensées plus « marrantes ». En général, les tueurs ne sont pas aussi imaginatifs, ils sont plus cons et leur symbolique plus lourde. Le mien, il délire sur des notions d’arbre de vie parmi d’autres. J’ai donc repris tous ces éléments en tentant de les rendre plus intéressants dans le cadre d’une fiction. La documentation sur laquelle je m’étais basée commence à dater et elle est depuis quelques temps remise en question. On voit désormais apparaitre la notion du tueur en série que l’on appelle « intégré ». La théorie dominante de l’époque montrait des hommes dans les marges, qui n’avaient pas les moyens de se marier ou de fonder une famille. Puis sont apparus les Émile Louis, les Fourniret qui ont réussi à fonctionner de façon tout à fait normale le reste du temps. Mais cette catégorie reste très minoritaire.
J’ai l’impression que tu emmagasines beaucoup de références, qu’il y a chez toi, un coté presque collectionneur.
Lors d’une récente interview au Nova Book Box, le chroniqueur a beaucoup demandé après mes références, mes inspirations, ma culture et je me suis rendu compte que je n’en avais pas. J’ai même dû pipeauter certaines de mes réponses et improviser. J’ai un vague vernis roman noir, un vague vernis SF des années 70, je lis pas mal de livres au hasard, des polars très classiques mais finalement je structure assez peu les choses. Ces lectures classiques me servent en termes narratifs. Si je veux écrire un polar, obtenir une intrigue qui se tiens, je vais en prendre une qui existe et qui est bien. Je suis complètement hors du coup d’une érudition qui déborderait à chaque page, je suis plutôt autodidacte, je me nourris du monde. Comme je ne n’avais pas de pognon au départ, je ne gardai pas les livres ce qui fait que j’ai énormément lu mais je ne sais pas quoi et qui. Je commence tout juste à me faire une bibliothèque. Je suis cultivé mais de façon sauvage et j’ai même du mal à dire d’où je viens. Mais je tente de me soigner, pour mon prochain cycle romanesque, j’ai une base de cinquante à soixante bouquins que je vais lire. Le problème c’est que si on en parle dans six mois, je ne suis pas sûre de m’en rappeler. J’ai une mauvaise mémoire, je ne garde rien ah, ah.
« Je voulais faire mon grand roman noir comportementaliste à la Jean-Patrick Manchette. »
Il t’arrive de te dégouter en écrivant ?
Non. Je ne mets aucune limite. La seule, c’est la vérité de l’histoire. Je ne fais pas de scènes chocs juste pour les faire. Pour moi la narration prime avant toute chose : elle détermine le style, l’ambiance, le choix des scènes etc. Au moment où j’écris, je me pose principalement des questions de rythme, de syntaxe, je ne suis concerné que par la forme, la scène je ne la lis plus. Le fond c’est avant, quand je réfléchis, que je prends des notes, que je balance des premiers jets. Je ne m’arrête sur rien qui me semble horrible. Si je m’engage sur tel ou tel sujet, j’y vais jusqu’au bout. Si je sens qu’en m’y engageant, je ne vais réussir à le terminer, alors je ne le fais pas. Je ne pourrai pas, par exemple, faire un livre qui traite du racisme, je deviendrai trop moraliste, mon antiracisme prendrait naturellement le pas et je n’arriverais surement pas à trouver la voix intérieure des personnages. Le film « Un français » réalisé par Diastème réussit là où je n’arriverai pas, puisqu’il fait le point sur un aspect qui m’a toujours fasciné : il raconte comment un mec lambda devient raciste et ensuite un militant contre le racisme. Les scènes de violence sont incroyables. On sent qu’il n’est pas cinéaste à la base puisqu’il filme ces scènes de façon presque documentaire. Ça m’a scotché, cette force, cette violence réelle, j’ai presque failli arrêter le film.
Je sais que tu as beaucoup lutté pour réussir à vivre de ton métier, est-ce qu’il y a une forme de catharsis dans tes écrits ?
Métaphysique est mon premier vrai roman publié mais c’est le dixième que j’écris. Je n’ai pas du tout de catharsis dans l’écriture. J’ai plutôt une catharsis sociale dans le fait de faire un boulot qui me plait. Bosser huit heures par jour pour une fiche de salaire me rendrait dingue. Je ne pense pas être fait pour ça ou alors j’ai laissé tomber ce mode de vie trop tôt et si je devais faire ça maintenant, je serai vraiment inadapté. Les thèmes que je brasse c’est parce que j’ai envie de les lire et qu’il me parait important de les évoquer. Je n’évacue pas ma propre merde, j’évacue plutôt celle du monde. Ma merde est ce qu’elle est mais j’essaie de ne pas trop comparer ma merde à celle de mes bouquins. Je suis plutôt témoin d’un caca ambiant. Si je regarde de trop près le mien, j’ai peur de casser la magie. Je suis comme Lynch qui ne veut pas faire de psychanalyse, j’ai la même superstition, si je lorgne trop sur ce qui vient de moi, ça me fait débander.
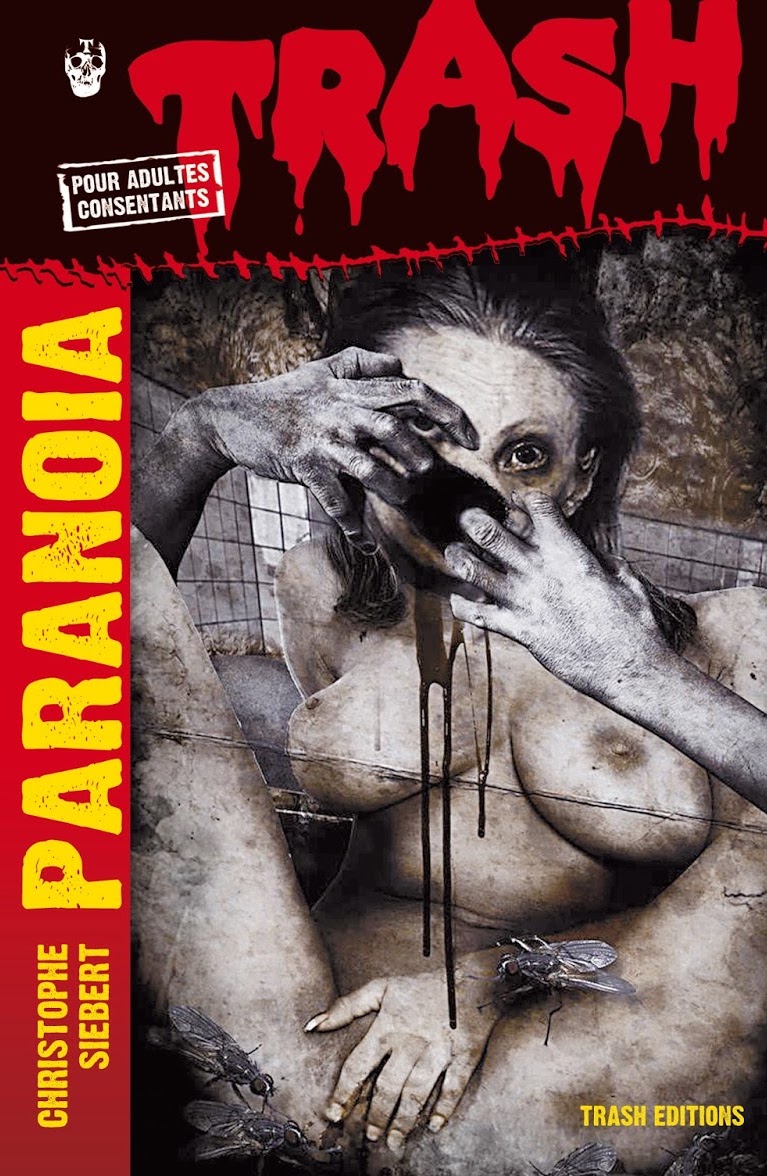
Comment arrive l’histoire de Paranoïa ?
Quand je me suis décidé, en 2009, 2010, je voulais faire mon grand roman noir comportementaliste à la Jean-Patrick Manchette, qui est une référence absolue pour moi. Le coté comportementaliste vient du fait que l’histoire est racontée à la troisième personne et que l’on n’a pas accès aux pensées des personnages, uniquement leurs actions, langage et réaction physiologique mais on ne sait jamais ce qu’ils se disent. C’est le contraire du roman omniscient, c’est antipsychologique. Historiquement, c’est un type de roman qui a été fabriqué à une époque où l’Amérique traversait une énorme crise morale et politique, un moment ou la confiance entre le peuple et les institutions se perdait. C’est un type de roman qui traduit cette défiance, en ne montrant pas ce que les gens pensent, en laissant planer un doute permanent, les faits et rien que les faits. Tu peux voir à quel point je me suis éloigné du projet initial. Je voulais que l’ensemble fasse le point sur des thématiques qui me travaillait à l’époque à savoir la Paranoïa et le Mystique. Quand je dis que je me nourris du monde, l’idée que tous les animaux ont des processeurs intégrés m’est venue d’une discussion que j’ai eu avec un schizophrène. Un pote de mon ex, alcoolique presque normal et qui pendant une crise de picole un peu excessive, se rend compte que les animaux sont des robots. Il se dit que ça craint, donc il rencontre Dieu et il a fait tout le chemin de St Jacques de Compostelle à genoux avec les pèlerins pour justement se rallier au mystique. Il l’a vraiment fait. Après je l’ai perdu de vue ah ah, mais cette idée m’a vraiment frappé. C’est le point de départ du roman. A la base, c’était un manuscrit excessivement long et l’éditeur de Trash avant que la structure ne coule, me tannait pour que je le lui fasse lire. Il l’avait adoré et c’est avec lui que nous lui avons donné sa forme définitive, en le réduisant en plusieurs temps et surtout en le montant différemment. J’avais essayé seul mais rien ne fonctionnait. C’est pour ça qu’il est remercié en ouverture. C’est de cette façon que l’on a quitté mon ambition de départ pour le faire devenir un bouquin d’horreur parano relativement simple, enfin compliqué à comprendre, mais simple dans sa lecture ah, ah. Je me suis rendu compte, en l’écrivant et en le ratant, que je ne savais pas faire de roman comportementaliste, que ce n’est pas mon truc. J’ai réussi dans deux ou trois nouvelles mais jamais dans un roman entier.
Avec ton livre, tu proposes une plaquette Fabrication d’un écrivain ou tu te racontes, de ta misère fondatrice au pari réussi que tu mènes aujourd’hui. C’est rare, pourquoi ce texte ? Pour montrer d’où tu viens et rassurer les lecteurs que le mec qui écrit tant de choses horribles n’est pas complètement barge ?
Quand j’ai signé au Diable Vauvert, j’étais tellement content d’atteindre une maison d’édition de ce calibre, que j’ai une qu’une envie : raconter ma vie. Je l’ai d’abord diffusé par épisodes sur Facebook pour me faire mousser un peu, pour donner du grain à moudre a des copains qui écrivent aussi mais qui galère, leur dire qu’on peut écrire des horreurs et sortir chez des gros éditeurs. Au Diable Vauvert, ils sont tombés dessus et ils ont tellement aimé l’idée qu’ils l’ont sorti dans un esprit de fanzine, en le tirant à 1500 exemplaires. Une fois que c’est sorti, la démarche et son côté vantard m’ont gêné mais finalement, on peut presque le voir comme un dossier de presse, une sorte de manifeste.

Tes autres écrits semblent branchés sur les mêmes registres, pourquoi en avoir fait une spécialité ?
Je ne vois pas ça comme une spécialité. C’est vrai que mes récits explorent les situations limites, les gens qui vont mal mais parce que je crois qu’il n’y a que cet aspect qui m’intéresse en fiction. Je m’en rends compte maintenant mais quand j’étais plus jeune, que je trainais dans les gares ou dans la rue, c’est toujours les mecs bancals qui me racontaient leurs vies. Je ne sais pas si je me suis nourri d’eux mais ils m’ont éduqué. Simenon interrogeait ce sentiment de belle façon. Il parlait de la recherche de l’homme nu, ce moment ou l’homme en situation de crise se révèle, débarrassé de ses oripeaux sociaux et psychologiques. Comme je ne me considère pas encore comme un écrivain très subtil et très doué, j’arrive avec mes gros sabots, mes tueurs en série, ces gens qui tuent leur femme. Mais je m’adoucie, j’ai volonté à être plus subtil au fur et à mesure des années, volonté d’écrire les mêmes horreurs mais qui plaisent à 100 000 personnes et non pas à 200. Le prochain roman, intitulé Chroniques de Mertvecgorod, est pour moi un pas vers cette subtilité. On a changé le titre parce que mes éditeurs n’arrivaient pas à prononcer le mot ah, ah. Ce sera donc Images de la fin du monde avec « Chroniques » en sous-titre. Il s’agit d’un immense cycle romanesque. Mertvecgorod est le nom de la ville ou se dérouleront toutes les histoires, c’est une énorme mégapole fictive très polluée située dans un tout petit pays qui fait tampon entre la Russie et l’Ukraine. L’intention de ce premier volume est de faire rentrer le lecteur en douceur dans ce monde et il y aura ensuite des romans qui seront tous indépendants. Je veux conserver l’aspect roman de gare, j’aimerai bien faire l’équivalence de La Compagnie des Glaces de G-J Arnaud mais chez les gothiques-nazis. J’use d’un présent alternatif, qui se veut être un commentaire sur l’époque actuelle en décalant l’écriture pour que ce soit plus marrant à lire. Si mes éditeurs suivent, je pense que je vais crever avant la fin. Pour moi, le roman de gare n’est pas un format mais un objet de finition ou la patine est grossière, brute. J’aime cet aspect, le fait de savoir s’arrêter avant une amélioration qui tendrait vers le trop littéraire, c’est un travail très technique. En musique, c’est pareil. J’aime quand ça joue un peu faux, quand la sono est merdeuse, que le mec n’a pas son texte ou que le batteur est bourré. Ça me touche plus. J’aime avoir la sensation d’assister à quelque chose qui ne se produira pas ailleurs. C’est pour la même raison que j’aime les bistrots et que je suis alcoolique. Les choses se passent, même si c’est insignifiant, même si c’est le vingtième mec de la semaine qui vomit dans la rue, ce n’est pas grave parce que chaque fois c’est unique, tout comme les conneries qu’il va raconter ensuite, elles n’appartiennent qu’à lui.
C’est quoi les expériences GoreZine/Violences ?
Violences est un fanzine édité par Luna Beretta. J’y ai publié un texte dans chaque numéro. C’est un zine qui est arrivé à point nommé : fabriqué par quelqu’un de jeune, elle a moins de trente ans, imprimé avec les moyens du bord, de la photocopie à l’ancienne, il m’a redonné goût aux revues. Violences, je trouve, est arrivé à un moment ou l’underground ronronnait un peu : plus de revue marrante à lire, sur internet l’âge d’or des auteurs fous qui hantaient les forums et Facebook était loin, alors quand Beretta a décidé de le faire, ça m’a redonné le moral. Si on considère le nombre d’auteurs, et quelques fois pas des moindres, qui se presse pour y écrire, il faut croire que je n’ai pas été le seul à accueillir ce zine comme une excellente nouvelle. Gorezine en revanche, est né d’un constat effectué par Beretta : elle recevait pour Violences, des textes qui lui plaisaient mais qui était trop axés horreur ou gore pour avoir leur place dans le zine. Elle a donc décidé de créer une autre publication et comme on voulait bosser tous les deux, nous l’avons conçu et édité ensemble. Deux numéros sont parus à ce jour (contre neuf pour Violences, le dixième est d’ailleurs en cours de préparation), le deuxième étant plus d’aspect semi-professionnel qu’un fanzine à proprement parler

Tu te dis performer aussi. C’est quoi l’idée ?
A la fin des années 90, j’écris beaucoup, sans trouver ni de public, ni d’éditeur. J’ai pas mal de potes qui sont proches de la scène Punk/Noise/Musiques expérimentales et j’ai profité des concerts pour écrire et lire mes textes face aux gens. Je le fais encore aujourd’hui, toujours dans des concerts du genre et à chaque fois en première partie. A mi-concert, c’est compliqué de me placer et à la fin, je suis bourré donc aucun intérêt ah, ah ! Au début, c’était une lecture de texte très inaudible, je lisais comme je parle et la musique n’apportait rien. Au fur et à mesure, j’ai étoffé et maintenant c’est vraiment devenu une activité en soi. Ça reste purement de la lecture, apprendre les textes et en faire un spectacle est un pas que je ne veux pas franchir. Cet aspect statique et froid de la lecture de texte fait que le public à un rapport très différent en comparaison d’une déclamation ou d’un spectacle. Pour moi le texte vit de lui-même et je ne suis là que pour la transmettre. Je veux mettre le lecteur dans les conditions de lecture dans son fauteuil donc je l’écrase de musique minimaliste, de lumières étranges et je parle avec une voix blanche pour le laisser seul avec le texte. D’ailleurs beaucoup de personnes dans le public ferment les yeux sur le moment. Ça m’est arrivé de mettre de la vidéo pour certaines lectures de Nuit Noire, des images en 35mm de cadavres glanés sur internet en fondu enchainé avec des arbres morts. La démarche fonctionnait bien, les gens m’ont dit avoir le sentiment de vraiment se nourrir de quelque chose mais de trop, parce que le fait d’avoir l’attention sur la vidéo leur faisait complètement oublier le livre. Je sais aussi que j’ai un charisme et une technique assez limité donc user de ces artifices aide le public à s’immerger.
Le futur, tu le vois toujours dans les mêmes registres ?
Oui mais avec la peur de tourner en rond. C’est une peur d’autant plus justifiée que je ne suis pas certain d’identifier le moment où ça arrivera. Pire encore, vu comme les choses se goupillent, il devrait coïncider avec le moment où personne ne sera en mesure de me le dire parce que je vendrai beaucoup et tout le monde me dira que ce que je fais c’est formidable ah, ah. J’ai 45 ans et je commence enfin à démarrer. J’ai mis mon temps, parce que je suis con et que je ne voulais pas faire autre chose. Comme pour faire une chaise ou du pain, j’ai appris de façon très laborieuse et il n’y a que le travail et la détermination qui m’ont permis de m’en sortir. Mon seul critère c’est avant tout : est-ce que je raconte des choses nouvelles ? Rester dans le même genre ne me fait pas peur, il s’agit surtout de savoir si j’injecte assez de matière intéressante pour ne pas lasser. J’en reviens à l’alcoolisme, au bistrot, à trainer dans les squats, à écouter tous ceux qui ont des histoires à raconter, eux normalement devrait me nourrir. Quand ma vie se résumera à aller au café de Flore en taxi, je me poserai la question. Bukowski a écrit plein de livres sur la question de comment ne pas devenir idiot. Lui devenait riche, célèbre, son milieu changeait, il buvait des verres très cher dans des bars très cher alors qu’au début c’était un clodo. Tout tient à cette question, devenir un idiot. Ne pas faire semblant d’écrire sur les crevards quand tu n’en es plus un, ne pas devenir un écrivain bourgeois pour les bourgeois, continuer à dire la réalité de ce que tu vois tandis que la réalité change parce que tu changes, cette transformation me fait flipper. Changer de registre, pourquoi pas. Faire de la SF mais pas comme construction de contre-utopie, comme Damasio peut le faire par exemple, ça ne m’intéresse pas. Je préfère ce que faisait Ballard, Dick ou Kafka, de la critique sociale, exotique.
« Ce qui fait bander ou mouiller dans le roman porno en littérature, c’est l’histoire, l’attachement aux personnage et l’intérêt pour la narration ».
Tu ne fais pas que dans l’horreur, tu fais aussi dans le porno. Comment es-tu arrivé directeur de collection chez Média 1000 ?
Encore une fois par hasard. J’avais un manuscrit qui tournait chez les éditeurs et il se trouve que c’est La Musardine qui l’a accepté. On s’est bien entendu et quand j’ai eu besoin de thunes, je me suis tourné vers eux. Je suis devenu rédacteur de fausses lettres de cul pour un canard et je faisais parfois un demi numéro à moi tout seul. Certaines lettres qui sont reçues sont tellement mauvaises qu’elles sont impubliables et que parfois il est préférable de faire appel à des pigistes pour nourrir le journal. Crises mondiale aidant, en 2008 je me suis fait virer du canard et j’ai alors écrit six romans porno pour Média 1000. Esparbec qui était l’ancien directeur de collection avait vraiment aimé mon premier roman, « J’ai peur ». La collection s’est arrêtée mais je suis toujours resté en bon contact avec eux. Il y a deux ans, j’avais besoin de bosser et ils m’ont branché sur meshistoiresporno.com qui est leur site de publications d’histoires amateurs et qui sert de produit d’appel pour acheter les bouquins de poche. Je gère ça, je fais l’éditing sur les histoires, la promotion etc. Quand il est devenu intéressant pour eux de relancer leur collection de poche, ils ont fait appel à moi. On a négocié un certain nombre de choses et on est communément arrivé à cette collection des Nouveaux Interdits. La question s’est posée de savoir si nous devions reprendre le catalogue existant avec la difficulté de reconquérir l’image de la collection en tant qu’inédit ou en faire une ex nihilo. C’est donc la deuxième solution qui a été choisi avec le gros enjeu de ne pas perdre leur lectorat de base, leur cœur, qui est important puisqu’on parle de 500 à 1000 lecteurs, tout en recrutant de nouveaux auteurs. Ils ont fait appel à moi parce qu’ils considèrent que l’ai le cul entre deux chaises : je ne vais pas faire peur au vieux et je vais réussir à ramener des jeunes. Je suis comme Mitterrand, je fais le changement dans la continuité !
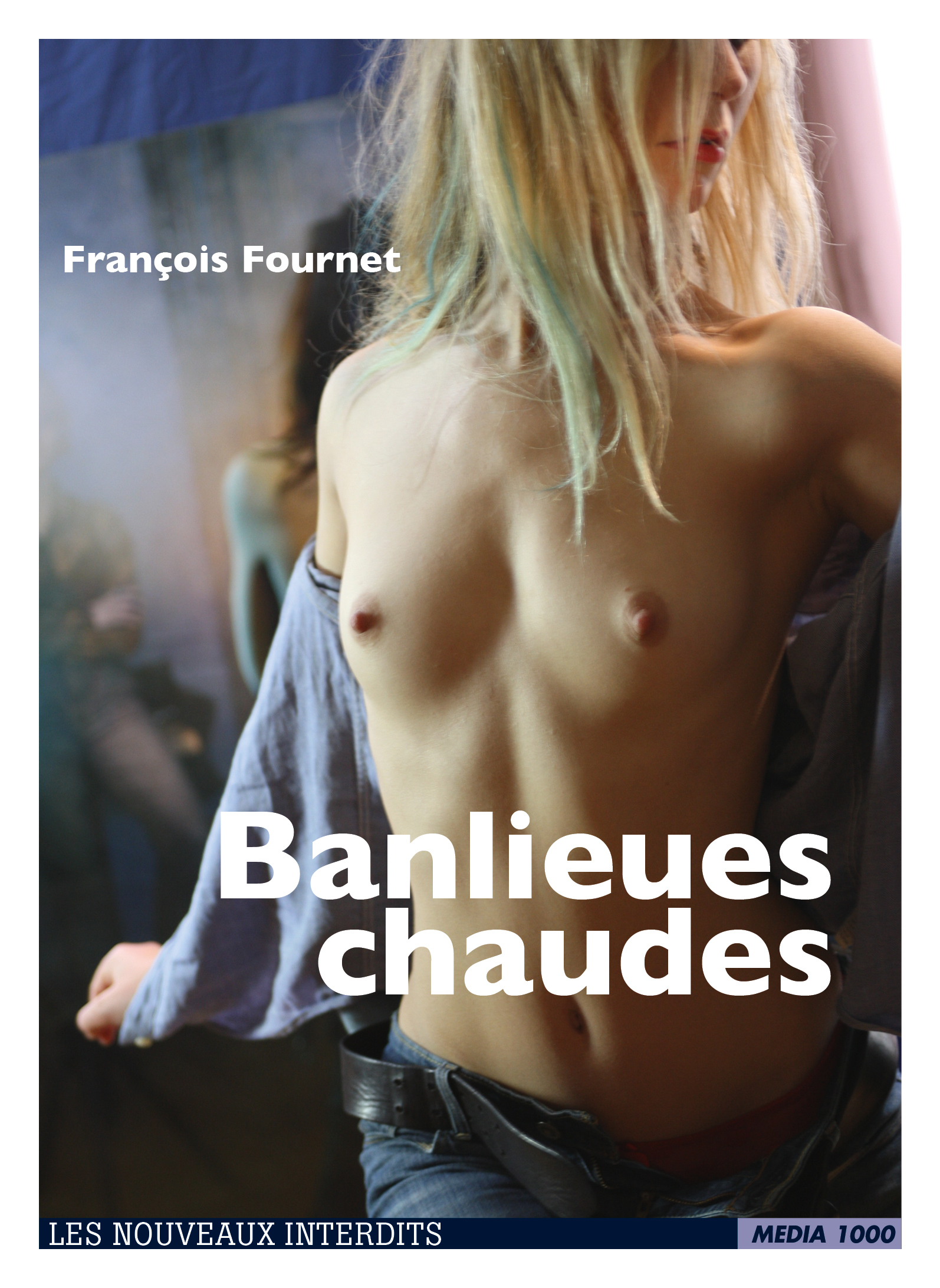
Ne penses-tu pas que les romans porno, à l’heure d’internet, c’est un peu dépassé, perdu d’avance ?
Perdu d’avance c’est possible. Dépassé non, au contraire. C’est ce que je raconte à mes auteurs qui ne comprennent pas pourquoi on devrait s’emmerder à raconter des histoires porno. Ce qui fait marcher le porno sur internet, c’est le fait que c’est réel, qu’on voit ce qui se passe. Ce qui fait bander ou mouiller dans le roman porno en littérature, c’est l’histoire, l’attachement aux personnage et l’intérêt pour la narration. C’est ce qui rend les scènes de cul excitantes. Tu peux faire des scènes de cul magnifiques mais si le sujet est sans intérêt autour, ça ne marchera pas. Le roman porno c’est juste du roman, du roman de genre ou tu remplaces les scènes d’horreur et de poursuite par des scènes de cul. Pour tout ça ce n’est pas dépassé par contre c’est mort pour des raisons économiques et sociales. J’aurai aimé que cette collection soit la série noire du cul mais ça n’arrivera plus. On la fait exister, on permet à des romanciers de sortir des bouquins et je suis extrêmement exigeant sur le travail du texte même si je ne perds pas de vue mon exigence de roman de gare. Une de mes envies est d’avoir plus d’auteurs féminins, de voir se raconter une sexualité plus féminine et d’avoir une parité plus importante. Je travaille avec une auteure en ce moment et nous sommes déjà à la quatrième version de son roman. On n’a pas la prétention de faire de grands livres mais de simples objets de distraction qui t’apprennent des choses sur le monde réel. Nous sommes peu distribués, sinon dans les relais H et à La Musardine, personne ne parle de nous sinon les amateurs de cul et nous sommes toujours considérés comme un genre marginal. Nous sortirons du ghetto dans lequel nous avons été enfermés quand les médias et les lecteurs se rendront compte qu’avant d’être des bouquins de cul, nos livres sont surtout de bons bouquins. J’aimerai bien rendre ses lettres de noblesse au genre, mais ce n’est pas simple, il faut réussir à le faire sans perdre les amateurs. Le jour où Les Inrocks ou Télérama diront que nos bouquins c’est de la merde, alors on aura gagné parce qu’ils auront conscience de notre existence et qu’on rentrera dans le game. C’est vraiment un combat d’arrière-garde mais faire de la littérature, c’est continuer à cultiver l’imaginaire et le conserver. Il faut passer par des bonnes histoires et des bons personnages pour donner l’envie aux gens de se branler.









2 commentaires
très bonne interview