« J’ai bâti ma vie entière autour de mon amour de la musique. Je passe mon temps à courir après ma prochaine chanson préférée. Mais jamais je n’arrête d’écouter mes compilations. (…) Les compilations conservent mieux les souvenirs que les tissus du cerveau. Chacune d’entre elles raconte une histoire. Rassemblez-les, et vous avez l’histoire d’une vie. » Rob Sheffield
J’ai fait ma première compile sur cassette en 1994, en rentrant de vacances dans le Vercors. J’avais le béguin pour un animateur du club des pré-ados et, comme j’avais treize ans, que je ne ressemblais à rien et que je ne parvenais que très difficilement à ouvrir la bouche sans me couvrir de ridicule, je n’avais jamais osé lui parler. La seule fois où il m’a tenu la main, c’était pour me relever après que je m’étais pété la gueule dans une grotte, en spéléo (malheureusement, j’ai dû me laver la main juste après ; elle était pleine de boue). J’avais passé ces quinze jours munie de mon walkman, épiant l’élu de mon cœur en actionnant les touches « rewind » et « FF » pour écouter des chansons qui, plus tard, resteraient à jamais associées à lui. Une fois rentrée à Paris, j’avais sélectionné ces chansons et les avais rassemblées sur une cassette, que j’intitulai « Compile Fabien ». J’ai commencé à prendre l’habitude de faire des compiles à propos de tout et n’importe quoi. Des compiles enregistrées d’après la radio allemande qu’on ne captait qu’en Moselle et qui passait de la musique des années 50, 60 et 70 (Stones, Kinks, Herman’s Hermits, Hollies etc.). Des compiles associées à chaque type dont je tombais amoureuse. D’autres, réservées à un usage précis (cassette à écouter dans le train, cassette pour quand ma famille m’a pris la tête, cassette pour faire une fugue, etc.). J’ai aussi envoyé par la Poste de nombreuses cassettes à mon premier petit ami, auxquelles j’apportais un soin méticuleux (Hole, the Breeders, the Kelley Deal 6000, ça vous dégoûte un homme). Mais la Rolls des compiles, celle que je fais encore à l’heure actuelle sous forme de playlist iTunes (la modernité, que voulez-vous…), c’est la compile de fin d’année. Quatre-vingt-dix minutes qui résument en musique toute l’année écoulée. Les écouter bout à bout revient à lire mon journal intime.
J’ignore si nous sommes nombreux à faire cela ; j’ignore si beaucoup de gens écoutent encore les cassettes de leur adolescence. C’est un sujet délicat, qu’on ne peut pas aborder avec tout le monde, c’est trop personnel. Une chose est sûre : Rob Sheffield fait partie de ces irréductibles nostalgiques qui, pour vivre, ont besoin de compiler des chansons. Comme le Rob Gordon de Nick Hornby qui, en plus de faire des cassettes à ses petites amies, classe ses disques par ordre autobiographique, c’est-à-dire dans l’ordre dans lequel il les a acquis (pour savoir où trouver tel disque, il lui faut se souvenir qu’il l’avait acheté pour telle fille, mais qu’il n’a jamais eu l’occasion de le lui offrir). Un type de classement jugé « rassurant » par son collègue disquaire. Au printemps 1998, sans avoir lu High Fidelity, j’avais moi aussi entrepris le classement autobiographique de mes disques. Est-ce une pathologie ?
Love is a Mix Tape
À en croire Rob Sheffield, non. Pour ce rock critic américain, « lorsqu’on enregistre une cassette, on écrit l’Histoire ». Dans son premier livre, Love is a Mix Tape — Life and loss, one song at a time, paru en France en 2009 sous le (mauvais) titre Bande Originale, Sheffield dresse une liste non exhaustive des diverses raisons d’enregistrer des cassettes : « Je te veux » ; « On couche ensemble ? Génial ! » ; « Tu aimes la musique, j’aime la musique, je sens qu’on va bien s’entendre » ; « Tu m’as brisé le cœur et fait pleurer et voici vingt ou trente chansons sur le sujet » ; etc. « Il y a des tas d’autres raisons d’enregistrer des compilations. La cassette pour prendre des drogues. La cassette pour les transports en commun. La cassette pour la vaisselle. La cassette pour la douche. Les plus grands succès de la pile de disques de votre partenaire, la nuit avant la rupture. Il y a des millions de chansons, et des millions de façons de les relier entre elles au sein d’une compilation ». Chaque chapitre de Love is a Mix Tape est introduit par une image du dos d’une cassette, sur laquelle on peut voir les titres qui la composent. L’auteur a rédigé ces lignes en écoutant la compile en question, laissant les souvenirs affluer. C’est ainsi qu’au détour d’une cassette datant de 1993, on découvre le Dur dur d’être bébé de Jordy, tapi entre Meat Puppets, New York Dolls, L7 et Buzzcocks.
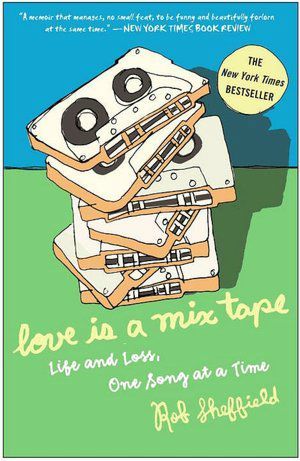
Rob Sheffield a 46 ans, et a grandi dans la banlieue de Boston, au milieu de quatre frangines fans de Duran Duran. D’origine irlandaise, il est catholique pratiquant (ou en tout cas l’a été pendant longtemps). Durant son adolescence, pour le carême, il a décidé d’abandonner la musique du diable, ce qui signifiait, pendant sept semaines, d’écouter la radio en se demandant quelles chansons étaient diaboliques et quelles chansons évoquaient simplement le diable. Selon ses critères, Sympathy for the Devil des Stones était « acceptable car elle était contre le diable », mais Friend of the Devil de Grateful Dead était « trop indulgente envers Satan ». Il s’est interdit d’écouter Walk on the Wild Side de Lou Reed parce qu’elle était « purement diabolique », et s’est fait une cassette spécialement tronquée de l’album « London Calling » des Clash, qui excluait le passage sur le type qui baise des nonnes. Il y a décidément un tas de bonnes raisons d’enregistrer des cassettes. La fin du carême a été pour lui un soulagement, et il s’est fait plaisir en écoutant Walk on the Wild Side le matin de Pâques.
Love is a Mix Tape est une quadruple déclaration d’amour ; à la musique pop tout d’abord. Aux cassettes, qui « seront toujours cool ». À la musique des années 90. Et surtout à Renée, sa femme, décédée trop jeune et brutalement en 1997.
Durant la première moitié des nineties, Sheffield et son épouse passaient leur temps à écouter de la musique, inventer des cocktails aux couleurs étranges, recevoir des amis, aller voir des concerts dans leur petite ville du Sud, Charlottesville, chroniquer des disques pour la presse rock, et s’enregistrer des cassettes compilant ce qu’ils aimaient à ce moment-là. Tous deux étaient fans de Pavement, L7, Nirvana et consorts. En avril 1994, à la mort de Kurt Cobain, Rob Sheffield aura cette phrase d’anthologie : « C’était sans doute le décès de rocker le moins surprenant de tous les temps. Kurt menaçait de se suicider depuis si longtemps que c’était un peu comme s’il jouait au Cluedo avec ses fans. À Rome, avec les cachets ? Non, à Seattle, avec le fusil de chasse. »
Life and loss
La mort de Renée, âgée d’à peine 31 ans, a été beaucoup plus surprenante, laissant Rob Sheffield seul et profondément malheureux. Son premier livre raconte son histoire d’amour, et la perte de la femme qu’il aimait, l’héroïne du roman. Leur rencontre, avec une chanson de Big Star en fond sonore. Les premières cassettes échangées. Leur vie commune, puis leur mariage, et l’arrivée du chien sudiste, nommé Duane comme Duane Allman des Allman Brothers. La découverte de Pavement, la sortie de Smells like Teen Spirit, une cassette pour faire la vaisselle intitulée la Zone de confort, et de longs passages très intéressants qui parlent de l’étrange sentiment d’impuissance que l’on peut éprouver quand on est jeune marié, engagé pour la vie avec une femme dont on est amoureux et qu’on ne laissera jamais tomber, quoi qu’il arrive, même si l’on a du mal à la protéger de tous les sales trucs dont on voudrait la mettre à l’abri. L’explosion du grunge, la teinture pour cheveux et les robes style empire. L’album posthume Unplugged in New York de Nirvana, qui, selon l’analyse de Rob Sheffield, ne parle pas des pressions liées à la célébrité, mais est composé de chansons d’amour. Du genre d’amour qu’on ne peut abandonner qu’en mourant, « jusqu’à ce que la mort les sépare ». Un album, donc, qui parle du mariage, avec la voix d’un homme marié. Marié et enterré. L’explication se tient, quand on la lit dans son intégralité, paroles de chansons à l’appui.
 L’histoire d’amour que nous raconte pudiquement Rob Sheffield est, bien sûr, ponctuée de musique, mais aussi d’innombrables anecdotes sur l’héroïne, ses manies, sa joie de vivre, ses côtés pénibles, ses lubies, sa créativité… En racontant la femme qu’il aimait, il arrive à nous la faire aimer. Alors qu’il se remémore toutes ces petites choses du quotidien pour la faire revivre dans les pages de son livre, il nous donne envie, à nous lecteur, de la connaître. Et nous fait regretter de n’avoir jamais eu l’occasion de la croiser.
L’histoire d’amour que nous raconte pudiquement Rob Sheffield est, bien sûr, ponctuée de musique, mais aussi d’innombrables anecdotes sur l’héroïne, ses manies, sa joie de vivre, ses côtés pénibles, ses lubies, sa créativité… En racontant la femme qu’il aimait, il arrive à nous la faire aimer. Alors qu’il se remémore toutes ces petites choses du quotidien pour la faire revivre dans les pages de son livre, il nous donne envie, à nous lecteur, de la connaître. Et nous fait regretter de n’avoir jamais eu l’occasion de la croiser.
Puis vient la mort brutale de Renée. Le refus d’y croire. La logistique des obsèques, la gentillesse des proches, le profond désespoir, et d’autres choses que les gens qui n’ont pas connu la perte d’une personne très proche n’iraient jamais imaginer. Dans la littérature « rock », voire même dans la littérature tout court, il y a peu de jeunes veufs. En tout cas, peu de jeunes veufs parviennent à écrire sur le sujet. Rob Sheffield, compilations à l’appui, raconte sobrement la perte, parvenant à rester drôle et émouvant, évitant le pathos. Par exemple, la sortie de la chanson Mmm Bop des frères Hanson le rend triste, car Renée aurait adoré cette chanson, mais elle n’a jamais eu l’occasion de l’écouter.
Un très beau récit sur la façon de surmonter le deuil, dans lequel on croise Jackie Kennedy, jeune veuve célèbre, ainsi qu’un « nain à nachos » qui travaille dans un restaurant de tapas, dont le job consiste à porter un sombrero dont les bords sont remplis de délicieux nachos et au sommet duquel se trouve une coupe pleine de salsa. Le nain à nachos invite les clients à se servir sur sa tête, suscitant l’opprobre d’autres nains qui, dépourvus de nachos, jugent ce boulot dégradant et insultant.
Love is a Mix Tape est aussi une ode à la musique des années 90. « C’était une époque ouverte, libre, pleine de possibilités, une époque de changements que nous croyions permanents. Il semblait inconcevable que les choses puissent redevenir ce qu’elles étaient dans les années 80, quand des monstres dirigeaient le pays et que les femmes n’avaient le droit de jouer que de la basse dans les groupes de rock indé. » Il est rassurant de constater que je ne suis pas la seule personne à qui le rock alternatif des nineties manque cruellement. J’avais fini par penser que ce sentiment de liberté, cette énergie qu’avaient à mes yeux les groupes indés des 90’s, surtout les groupes de filles, n’étaient qu’une impression due au fait que cette musique coïncidait avec mon entrée dans l’adolescence. Rob Sheffield m’a prouvé que ce n’était pas qu’une impression.
Ce grand livre sur l’amour et la perte est aussi, vous l’avez compris depuis un moment déjà, une déclaration d’amour aux cassettes, que l’on retrouve dans Tomber les filles avec Duran Duran, son deuxième roman. Sheffield y consacre même un chapitre entier aux cassettes deux titres.
Tomber les filles avec Duran Duran
Ce bouquin-là est une compilation à lui tout seul, la bande originale de l’adolescence de Rob Sheffield. Chaque chapitre porte le nom d’une chanson qu’il écoutait en boucle à un moment donné. Cela finit par constituer une playlist qui donne un aperçu de ce qu’était grandir dans les années 80, aux États-Unis.
Je ne connais pas le quart des chansons dont parle le livre ; je suis trop jeune pour avoir entendu ces tubes qui, pour la plupart, n’ont duré que trois mois avant de sombrer dans l’oubli. J’aurais pu aller les écouter sur YouTube et, par la même occasion, voir à quoi ressemblait le groupe ; mais j’avais fait ça quand je lisais le Fargo Rock City de Chuck Klosterman, livre dans lequel il parle de sa passion adolescente pour les groupes de heavy metal des années 80 — Klosterman a à peu près le même âge et le même parcours que Rob Sheffield, mais ils n’aimaient pas les mêmes groupes. Regarder ces vidéos s’était révélé être une fort mauvaise idée : loin de m’aider à comprendre la passion du journaliste pour ces improbables rockers permanentés en shorts cyclistes rose fluo, voir un clip du groupe Poison m’a tout simplement écœurée — ce qui est plutôt bon signe, à mon avis. Aussi, je préfère voir ces chansons à travers les yeux du gamin qui adorait ces groupes, plutôt que de les écouter en vrai. Sheffield, comme Klosterman, parle beaucoup mieux de la musique des années 80 qu’une vidéo qui a mal vieilli. J’ai donc choisi de laisser de côté les jugements esthétiques pour ne m’intéresser qu’à la seule chose qui ait réellement de l’importance : la façon dont l’auteur ressent la musique.
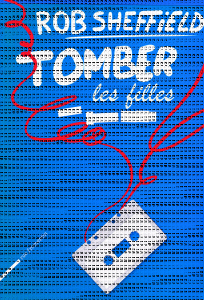
À l’instar de beaucoup d’adolescents, le jeune Rob Sheffield est fasciné par les filles. Pas une fille en particulier (il ne connaît pas encore Renée), non : juste les filles. À ses yeux, la gent féminine dans son ensemble possède son propre mode de fonctionnement, ses propres codes étrangers aux garçons. Avoir une petite amie est un but inaccessible, mais reste néanmoins une obsession. Aussi sa préoccupation principale est d’essayer de « comprendre le langage des filles ». Pour ce faire, il va s’appuyer sur la pop music. Il en résulte une analyse quasi sociologique des rapports différents qu’entretiennent filles et garçons avec la musique. Un exemple ? Alors que les garçons peuvent passer des heures à débattre pour savoir quel est le meilleur album des Clash, entre « London Calling » et « Sandinista », les filles, elles, disent simplement qu’elles aiment la chanson Stand by me, et se foutent complètement de savoir que son titre est en fait Train in Vain. Je suis d’ailleurs prête à parier que, sous cet article, nous trouverons au moins un commentaire d’homme nous donnant son avis sur le meilleur album des Clash. D’ailleurs, doit-on dire les Clash, ou le Clash ? Hein ? (Ah et au fait : j’ai longtemps cru que Train in Vain s’appelait Stand by me...)
En analysant la musique qui leur plaît et pourquoi cette musique leur plaît, il tente de comprendre le mystère des filles. Problème : il semble qu’à cette époque, toutes les filles sans exception étaient prises d’une vive passion pour Duran Duran. Passion incompréhensible pour moi, Française née en 1981, qui n’ai jamais eu l’idée extravagante de ne serait-ce qu’écouter une chanson de ces tarlouzes aux coupes de cheveux tout droit sorties du feuilleton Dallas. Pour moi, Duran Duran est l’un des quarante pires groupes de tous les temps* — et je n’ai jamais rencontré qui que ce soit qui soit fan de ce groupe, pas même une fille. Pas même ma mère, qui préfère Dire Straits. Pourtant, Rob Sheffield part du postulat que les filles aiment Duran Duran et n’ont jamais cessé de les aimer, fondant l’intégralité de son livre, titre compris, sur cette thèse controversée.
Heureusement, Tomber les filles avec Duran Duran parle aussi de Bowie, Paul McCartney (chapitre instructif sur le rapport aux femme et à l’amour du Macca, que l’auteur compare par ailleurs à une « grande sœur irlandaise autoritaire »), Morrissey, Roxy Music, Lita Ford… Et Madonna. Pour écrire ce livre, Rob Sheffield a dépoussiéré ses vieilles cassettes et les a « secouées un peu, pour voir quels souvenirs elles font remonter à la surface. Et, bien entendu, la plupart d’entre elles sont liées à des histoires d’amour, ou à (son) apprentissage de l’amour à travers la pop ». Bon, la musique des années 80 était vraiment pourrie, tout le monde s’accorde sur ce point. Restent ces fameux souvenirs, qui valent largement leur pesant de cacahuètes. Le récit d’une adolescence dans l’ordre chronologique, du premier bal à la rencontre de celle qui sera sa femme (Renée, donc), en passant par le premier festival rock, un échange en Espagne où il fréquente ses premières boîtes de nuit, l’arrivée de MTV, les premiers jobs d’été. À noter, le remarquable chapitre où il est ice-cream man, glacier ambulant dans sa camionnette pleine de délicieuses glaces, dans laquelle il déguste les produits en écoutant du rock. Vous apprendrez qu’il existe une vraie philosophie du glacier, et qu’il est indispensable d’avoir au fond de ses tripes le respect de la glace. Succulent.
Juste quelqu’un de bien
De ces deux excellents livres, deux choses ressortent : 1) les compilations sont un mode de vie, une façon de « prendre conscience du temps qui passe », comme le dit fort bien Élise Costa dans la préface de Tomber les filles avec Duran Duran. Et 2), Rob Sheffield est un type bien. Profondément. Un homme auquel, en lisant ces deux ouvrages, on s’attache. Un type comme vous et moi, avec ses doutes, ses faiblesses, ses guilty pleasures musicaux, et beaucoup d’humour. Un type qui n’essaie pas d’avoir l’air cool. Et surtout, un type dont on est impatient de lire les prochains livres.
Rob Sheffield // Bande Originale // Sonatine Éditions
Rob Sheffield // Tomber les filles avec Duran Duran // Éditions Rue Fromentin
* Lire, si ce n’est déjà fait, l’hilarant et indispensable article de Nicolas Ungemuth dans Rock & Folk, intitulé « les quarante pires groupes de tous les temps ».









2 commentaires
J’ai longtemps cru avoir considéré le rock des 90’s comme sacré à cause du fait que, tel un jeune chaton jouant pendant deux heures avec un papillon, je découvrais la « vraie » musique à cette époque que j’ai ressentie comme remplie de surprises et dénuée de lassitude. J’ai ensuite pensé qu’après avoir écouté (épluché même) des millions d’accords et de plans je suis devenu blasé (un peu). Mais j’ai fini par admettre il y a seulement une paire d’années (pour info je suis moi aussi du cru 81) qu’en effet il ne s’agissait pas d’un effet de l’adolescence, mais bien de la puissance et de la sincérité qui se dégageait de cette musique des 90’s.
Sinon, dans les années 80 il y avait du bon heavy metal. Et le meilleur album des Clash est bien évidemment London Calling.
Je voudrais pas avoir l’impression de pisser dans un violon (car je vais pas lancer de débat ni de sarcasme, etc.), mais j’adore ce papier !
Sylvain (qui se fout de savoir si « Stand by me » s’appelle en fait « Train in vain » ou l’inverse)
http://www.parlhot.com