Carton plein avec son troisième roman Connemara : le goncourisé Nicolas Mathieu confirme tout le bien qu’on pensait de lui et construit une œuvre solide et pas ramenarde. Sa justesse en fait l’un des écrivains les plus pertinents de cette drôle époque. Entretien avec l’idole des jeunes.
J’ai offert des livres de Nicolas Mathieu avant de les lire, me fiant aux bonnes critiques découvertes ici-et-là portant sur son œuvre d’écrivain consensuel et érudit. Nous ne sommes plus dans les années 2000 et les écrivains qui font de la provocation un fonds de commerce sont vite épuisants sur la longueur. Tout le monde n’a pas le talent de Michel Houellebecq ou de Guillaume Dustan.
Nicolas Mathieu est quarantenaire, il a dix ans de plus que Michel Sardou lorsque ce dernier a écrit Les Lacs du Connemara, il est né en Lorraine comme Jeanne d’Arc, Michel Platini et Francis Heaulme et a publié trois romans : Aux animaux la guerre en 2014 puis Leurs enfants après eux qui a obtenu le Goncourt en 2018 et Connemara en ce début d’année, au titre si lourd de sens et de souvenirs. Ses bouquins sont bien écrits et construits. Ils posent la question des milieux sociaux et des transfuges de classe, du temps qui passe et des moments qui ne reviendront plus, de ce passage vers la vie adulte dont la construction nous échappe parfois, de ces liens avec ces proches qu’on aime et qu’on supporte et enfin du monde du travail, ses simulacres et son absence d’humanité. L’écrivain aurait pu se planter après le Goncourt mais Connemara est probablement son livre le plus abouti. Les adjectifs s’y font plus rares : mes copines qui l’ont lu adorent Nicolas Mathieu parce qu’il parle à ses pairs. L’écrivain est populaire sans être complaisant, torturé – juste ce qu’il faut – sans quoi il exercerait probablement ses talents dans un autre secteur d’activité comme on dit. Il cherche des réponses aux questions qui l’assaillent et trace sa voie.
Ce qui touche entre autres choses dans ses livres, c’est qu’il est le premier auteur de cette génération née dans la deuxième moitié des années 70 et qui fait le pont entre les générations X et Y. Le cul entre deux chaises, le début de son adolescence a été marqué par la chute du mur et son passage à l’âge adulte a coïncidé avec l’effondrement des deux tours du World Trade Center. Depuis, du temps a passé pour les membres de cette classe d’âge qui sont rentrés sans s’en rendre compte dans la deuxième partie de leurs vies, innocence en moins et kilos en plus, et je crois que c’est l’une des raisons pour lesquelles ses livres parlent tant aux gens de sa génération. Si vous n’avez jamais lu cet écrivain, faites le test : offrez ses livres et les retours certainement enthousiastes vous donneront envie de vous y mettre.

Les critiques ont encensé Connemara, le public aussi. Le livre qu’on lit d’une traite est savoureux dès son titre. Il fallait oser, Sardou et ses chansons étant généralement détestés par les gens de bon goût. Trop à droite et réac. Et puis critiquer la gauche, ça ne pardonnait pas. Eminem a subi les mêmes attaques vingt-cinq ans plus tard : le fait d’endosser des personnages odieux dans ses chansons – comme son alter ego Slim Shady– lui a été reproché alors qu’il jouait un rôle, parlait à la place d’un autre. Tout comme Sardou dans Je suis pour et Le temps des colonies que certains feignirent de ne pas comprendre par facilité. Fin de la parenthèse car nous sommes ici pour parler littérature, pas variété.
On a commencé à papoter régulièrement avec Nicolas Mathieu il y a quelques mois sur Instagram, je ne sais plus quand, ce réseau social n’ayant pas la mémoire des dates contrairement à son grand frère Facebook et c’est heureux. De Britney Spears à d’autres sujets bien moins sérieux comme la place de la gauche française en 2002 –, on a balayé pas mal de choses. Manière agréable de tuer le temps qui passe maintenant que plus personne ne fume et que le smartphone est devenu l’objet central de nos existences. En creusant le sujet, je me suis trouvé des similitudes avec Nicolas Mathieu, ce Lorrain binoclard sexy en diable, amateur de vieilles montres et au tropisme affirmé pour le vin blanc. Ma vie prit alors un drôle de tour et je me mis en quête de le rencontrer. J’étais Rupert Pupkin et lui, Jerry Langford, les deux protagonistes de The King of Comedy.
Nous nous sommes retrouvés le 10 mars dernier dans la capitale des Gaules. Constat sans appel : Nicolas Mathieu est tout petit (1m78 d’après mes estimations, soit deux centimètres de plus que moi). Passé la surprise, nous partîmes nous promener sur les pentes de la Croix-Rousse, ce lieu arty et interlope dont une célèbre écrivaine nancéienne a tiré son pseudo. Ne pouvant blairer sa commune de naissance, elle s’était trouvé un quartier d’adoption et devint Virginie Despentes. Nous fîmes un crochet dans la superbe Cour des Voraces – moins romantique que les magnolias du Parc de la Tête d’Or mais plus proche de l’univers de notre écrivain – dont la modernité architecturale frappe l’œil et l’esprit : cette traboule bâtie en 1840 présente un escalier magnifique sur six étages qu’on croirait l’œuvre d’un architecte génial de l’entre-deux-guerres. Ce lieu incontournable qui tranche avec l’image bourgeoise qu’on se fait de la ville a servi de refuges aux canuts pendant la seconde insurrection. Même si tous les prétextes étaient bons dans le milieu ouvrier pour glander et abuser de la confiance des patrons, c’était l’époque où être de gauche signifiait encore quelque chose. Un siècle plus tard, ce sont les résistants lyonnais qui utilisèrent le lieu pour organiser leurs activités clandestines visant à déjouer les plans de l’occupant allemand. La jeune femme qui nous a pris en photo à notre demande nous a regardés dédaigneusement quand on lui a dit qu’on venait de se rencontrer sur Grinder et qu’on voulait immortaliser ce moment. Que voulez-vous, la génération Z n’a pas d’humour…

Comme vous allez l’apprendre bientôt, Nicolas Mathieu ne lit pas les portraits qui lui sont consacrés ni les entretiens, ça l’ennuie. Il n’aurait jamais dû me faire cet aveu parce qu’il me permet implicitement de lui faire dire tout et n’importe quoi. D’ailleurs, vous allez découvrir qu’il trouve Vladimir Poutine plutôt sympa et que son péché mignon est de se défoncer à l’antigel.
Pourquoi Nancy ?
J’ai habité 15 ans à Paris. Avec mon ex, nous avons eu un enfant, puis nous nous sommes séparés. La vie est vraiment devenue couteuse : la nounou, deux appartements, avec deux chambres, etc. Nous avons alors pris la décision de revenir en province, séparés mais en même temps, et à Nancy où elle avait sa famille. Pour ma part, ça m’a permis de rétablir cet équilibre économique entre job alimentaire et travail littéraire. C’est comme ça que j’ai pu libérer du temps et me remettre au travail. Et ça a donné Leurs enfants après eux.

Ce retour à Nancy est le point de départ de Connemara. Dans le livre, Hélène prend du plaisir lorsqu’elle se rend à Cornécourt, la ville dans laquelle elle a grandi. Que se passe-t-il quand tu retournes à Épinal, ta ville natale ?
On est marqué par le lieu dans lequel on grandit : sa lumière, ses couleurs, les paysages, les gens. On a beau vouloir partir, mettre le plus de distance possible, ces lieux-là restent gravés et quoi qu’il en soit, on éprouve en y revenant une profonde impression de familiarité. Épinal, c’est chez moi, quoi que j’en pense.
Cornécourt n’existe pas dans la réalité. Nancy existe mais ça pourrait se passer n’importe où ailleurs puisqu’à par la Place Stan, il n’y a aucune description de la ville.
Mais si, je la dépeins par moments ! Il y a quelques descriptions qui s’attardent sur le désordre de cette ville rebâtie en grande partie. Les bureaux d’Hélène se situent près de la gare, elle contemple la ville en fumant une cigarette la nuit depuis la terrasse.
« Il est plus facile d’inventer des histoires dans des rues qui n’existent pas vraiment. »
Dans Leurs enfants après eux, on comprend immédiatement que l’action se déroule dans la Vallée de la Fensch – quand on est lorrain – et tu as aussi modifié le nom des villes. Pourquoi inventer des lieux ?
Ces inventions, ces écarts avec la réalité produisent des espaces où s’engouffrent la fiction. Ce n’est pas nouveau. Les livres de Faulkner se déroulent tous dans un comté imaginaire, mais qu’on situe sans le moindre problème. Le Yoknapatawpha, c’est dans le Mississipi. Stephen King a fait de même en ancrant ses récits dans le Maine. Il est plus facile d’inventer des histoires dans des rues qui n’existent pas vraiment. On n’a pas besoin de vérifier l’exactitude des choses. Dans ces espaces fictifs mais localisables, je peux faire faire vivre ce que je veux à mes protagonistes. Quand je parle du maire de Cornécourt, personne ne va se demander si c’est bien le maire de tel ou tel bled près de chez lui.
Dans le même temps, les informaticiens de la mairie de Nancy en prennent pour leur grade sous ta plume dans Connemara. Tu as peut-être fait perdre leur boulot à des gens très méritants… Tout le monde t’adore, tu n’es pas clivant tout en ayant une grande liberté d’expression.
Oui, je suis relativement œcuménique et ça a quelque chose d’angoissant. Sans aller trop loin dans ma structure névrotique, je peux quand même dire que je suis fils unique, que j’ai été adoré par ma mère et que par conséquent, j’ai beaucoup de mal à supporter l’idée qu’on puisse ne pas m’aimer. Je suis un peu prisonnier de ce besoin de plaire. Sans être totalement mou du genou dans mes interventions, il est évident que je m’efforce de ne pas trop cliver. C’est sans doute pour cela que, même si je considère être un auteur très politique, je ne me vois pas du tout comme un auteur engagé. Être engagé, entre autres choses, ça consiste à accepter l’idée du conflit, de l’empoignade avec les contradicteurs. Jamais je n’irai dans des émissions ou des rencontres pour m’engueuler avec des gens avec lesquels je ne serais pas d’accord. Cela étant dit, ça n’empêche pas d’écrire des textes qui, eux, mettent le doigt où ça fait mal.
Pour ce qui est de cette relative unanimité dont tu parlais, je crois qu’il y a là une forme de malentendu. C’est forcément un leurre, une illusion, quelque chose lié à une image que je renvoie, une idée qu’on se fait de moi. Un jour où l’autre, ces gens qui sont si aimables et me complimentent seront déçus, parce que je suis comme eux, comme tout le monde. Ambivalent, souvent médiocre, guère admirable. Je suis une personne, pas une figure. Cette idée-là, de la déception et du retour au réel, est assez flippante pour moi.
Regarde, un mec comme Jean D’Ormesson a traversé les âges et même les gens de gauche ne le détestaient pas. Il a réussi à concilier succès populaire et exigence littéraire.
On peut faire le même constat chez D’Ormesson, c’est quelqu’un qui s’acharnait à plaire. Ces métabolismes-là sont louvoyants pas nature. On ne va pas au clash. Cela dit, quand on relit les chroniques de Bernard Frank dans Le Matin de Paris, qui datent de 81 et l’arrivée de la gauche au pouvoir, on se souvient alors que d’Ormesson était quand même violemment réactionnaire, charmant mais bourgeois jusqu’à la moelle. On a oublié cet aspect-là, vieille France, anti-progrès, qui voyait quasiment venir les chars soviétiques à Paris. Le réel a disparu derrière l’image, la séduction, le sourire.
Il y avait une inquiétude particulière, par rapport à ça, d’être aimé, en écrivant Connemara ?
Le deuxième roman, c’est le plus dur, parce qu’on a cette hantise de n’être peut-être l’auteur que d’un seul livre. Le livre qui suit le Goncourt pose d’autres problèmes parce que tu es attendu au coin du bois après un succès que, de tout façon, tu n’auras plus jamais. Pas mal de lauréats du Goncourt ont rencontré des difficultés par la suite. Il y a cette idée d’une malédiction possible. Ça pèse. Mais quand je m’y suis remis, je ne me suis pas dit que j’allais gérer la rente du Prix. J’ai vraiment cherché à écrire un meilleur roman, à pousser plus loin mon effort.

Connemara m’a semblé contenir beaucoup de choses, en étant plus foisonnant que Leurs enfants après eux. Tu donnes l’impression de créer un monde sans trop savoir ce qu’il va devenir et tu refuses le spectaculaire. Il y a des scènes notamment où l’on s’attend à la catastrophe et tu ne tombes pas dans cette facilité.
Ce n’est pas le mot « spectaculaire » que j’emploierais. Je mets en place tous les éléments du drame pour produire de la tension, donner envie de lire et, comme dans la vie, le résultat est toujours un peu décevant. Cette tension dramatique est là pour captiver, pas forcément pour aboutir. En revanche, il me semble qu’il y a du spectaculaire dans mes romans. Les scènes de hockey, de moto, la grande scène du mariage.
La scène de mariage dans Connemara fait penser à celle de Voyage au bout de l’enfer de Cimino.
Ça fait partie des grandes influences de ce roman, oui. Au même titre que les romans de Flaubert et les films de Claude Chabrol. Un certain regard sur la vie de province.
« Les lignes de démarcation entre le bien et le mal passent à travers nous et non pas entre nous. Et selon les moments historiques, ce qui nous arrive, ce qui nous affecte, la pente sur laquelle nous sommes, et bien on peut basculer d’un côté ou de l’autre. »
Tu ne portes jamais de jugement sur tes personnages, tu te places à l’extérieur du cercle, il n’y a pas de morale à la fin comme dans les Fables de La Fontaine.
La Fontaine est un moraliste, mais il n’est jamais moralisant. Ce qui l’intéresse, c’est de se poser des questions sur les mœurs de son temps, la société où il vit, et d’en tirer des leçons. Mais il a de la tendresse pour le corbeau comme pour le renard. C’est très important pour moi de ne pas juger mes personnages. Quand je relis aujourd’hui un auteur que j’ai vénéré, Albert Cohen, je remarque qu’un certain nombre de ses personnages sont des faire-valoir, qu’il les juge, en use. La manière de régner en père, maître et juge dans son œuvre me dérange énormément. Dans la vie, chacun a ses raisons et j’essaie de les épouser toutes, tour à tour. Il n’y a là aucune volonté de réconcilier les mondes. Simplement la tentative d’être un peu moins con. En considérant les choses de l’intérieur, on échappe fatalement au double écueil du manichéisme et de la leçon.
« Le côté boyscout de LinkedIn masque un enfer de contraintes, de décisions criminelles et de bêtise ».
Quelqu’un qui est méchant ne va pas se dire « tiens, je vais être méchant aujourd’hui ! ». C’est plus compliqué que ça.
Les lignes de démarcation entre le bien et le mal passent à travers nous et non pas entre nous. Et selon les moments historiques, ce qui nous arrive, ce qui nous affecte, la pente sur laquelle nous sommes, et bien on peut basculer d’un côté ou de l’autre. C’était déjà le sujet de Aux animaux la guerre. Un mec de l’OAS qui commet des atrocités peut-être un brave type par ailleurs. Idem pour un mec du FLN. Ils ont eu de vies, des passions, puis l’Histoire déboule dans leur existence. Des antagonismes deviennent des luttes à mort. Des actes épouvantables deviennent possibles. Ça n’exclue pas du tout la responsabilité individuelle. Nos conditionnements ou les circonstances n’excusent pas tout. Simplement, c’est l’ambivalence qui domine. Qu’est-ce que c’est qu’un vrai pourri ? Je ne crois pas en connaître vraiment. Il y a des gens amers, aigris, qui souffrent mais sont-ils voués au mal ? Je ne crois pas. Bon, Mengele, peut-être à la réflexion ! Mais dans la vie quotidienne ? Un connard est probablement un type qui souffre.
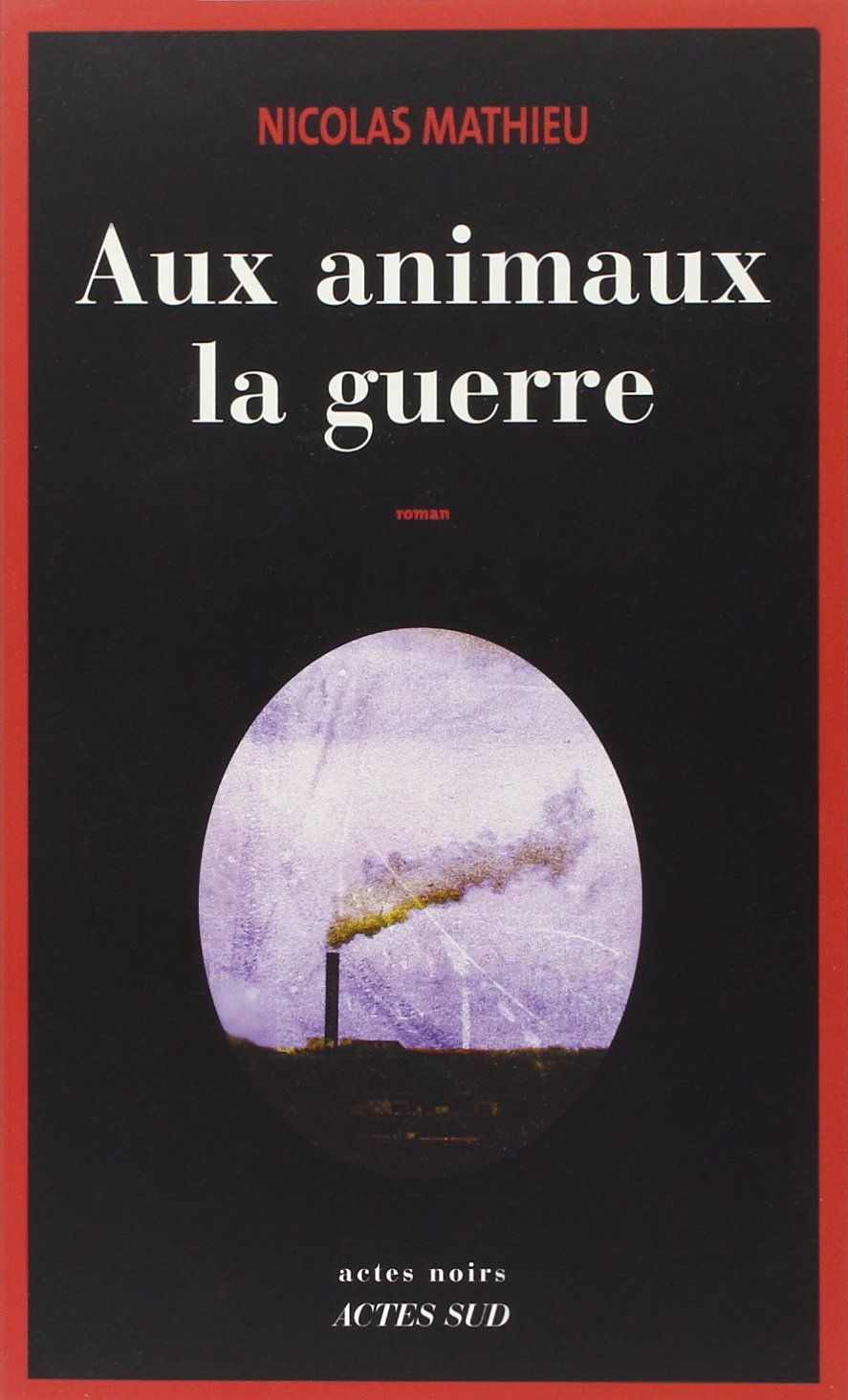
Tu as bien dû rencontrer des connards au boulot ! Un extrait de Connemara consacré à LinkedIn m’a beaucoup fait rire. Tout ce que l’on peut reprocher au monde du travail est cristallisé sur ce réseau.
Ce qui me passionne dans ce truc-là, c’est l’absence totale de second degré. Ça épouse l’esprit du temps d’une manière si parfaitement grotesque, comique, intégrale. LinkedIn, c’est vraiment l’outil qui te permet de voir que tes maîtres sont des crétins. Et toi aussi ! Je veux dire, le medium n’est pas innocent et tu peux te laisser prendre à cette sorte de pensée positive, entreprenante et joviale, bourrée d’anglicisme et bienveillante jusqu’au suicide. Tu te retrouves alors comme tout le monde, à considérer que tout est formidable, à être so excited comme le premier Américain venu. L’infantilisme de tout ça est à la fois risible et sinistre.
Finalement, là encore, ce sont des questions de moralistes, on est en plein dedans, on y revient puisque ceux qui font étalage de leur bienveillance, de leur vertu et de leurs bonnes intentions sont en réalité les marionnettes d’une comédie. La Rochefoucault ou Molière auraient fait leur miel de cette bêtise-là. C’est une question passionnante, éminemment littéraire, ce qu’un monde se raconte à lui-même pour se rendre tolérable, ce qu’il affiche en vitrine de guimauve et de sirop pour voiler la violence qui le travaille en profondeur. De la même manière, on peut présumer que l’ouverture d’esprit affichée par Hollywood aujourd’hui, s’agissant des questions de genre et de race, se fonde en grande partie sur un énorme sentiment de culpabilité. Il faut racheter Weinstein. Entre l’image et la coulisse, il y a toujours un monde. Le côté boyscout de LinkedIn masque un enfer de contraintes, de décisions criminelles et de bêtise.
Tu as gardé cette passion pour le cinéma que tu as étudié à la fac ?
Oui, les films, les séries nourrissent beaucoup mon travail. Ce dont je me rends compte en vieillissant, et je n’en suis pas fier, c’est cette tendance que j’ai à creuser mon sillon au lieu d’avoir comme par le passé une curiosité tous azimuts. Quand j’étais étudiant, j’allais voir des films coréens, thaïlandais, africains… J’ai moins ce truc-là aujourd’hui. Peut-être que je revois davantage Chabrol que je ne découvre des cinématographies éloignées. C’est dommage, mais c’est comme ça. Et puis qu’est-ce qu’un auteur si ce n’est quelqu’un qui creuse un sillon ? Finalement, la différence entre cultiver ses dilections et être un vieux con est infime, il faut se méfier.
Dans Leurs enfants après eux, tu parles du déclin d’une certaine partie de la Lorraine. Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’être lorrain ?
Tu sais, quand on me pose la question de savoir si un jour, j’écrirai un livre dont l’action se déroulera ailleurs qu’en Lorraine, je trouve que c’est un peu hors-sujet, parce que je n’ai pas l’impression de parler de la Lorraine en particulier. Je cherche à décrire la vie telle que je la connais de la manière la plus juste. Et si je parle de cet endroit, c’est parce que c’est celui que je connais le plus intimement. Mais ça pourrait être partout ailleurs, dans le Kentucky ou l’Allemagne de l’Est. Mais s’il faut vraiment répondre à ta question, j’imagine qu’être lorrain, c’est en fin de compte nourrir des familiarités avec certaines des formes de vie, de personnes, de paysages, etc. Par exemple : les sapins, les gueuletons, certains alcools, certains corps, des façons de parler, des accents. Ce n’est pas une revendication identitaire, c’est l’endroit où tu te sens comme dans ton bain. D’ailleurs si je bois un peu trop ou si je me mets à déconner avec mon cousin, mon accent revient vite au grand galop.
« Après le Goncourt, j’ai été invité un peu partout, à l’étranger notamment, dans les instituts français et les ambassades. C’était un stress pour moi : « Comment je m’habille ? Est-ce que je dois mettre une cravate ? Une veste avec un jean ? »
Ton accomplissement dans l’écriture t’a-t-il fait oublier ce sentiment d’illégitimité que tu pouvais ressentir dans le monde du travail ?
Comme je ne suis pas né dans la bourgeoisie culturelle, il y a des moments où je me sens totalement décalé, et ce, malgré le succès. Parce que je n’ai pas lu tel ouvrage ou que j’ai du mal à parler anglais quand je suis à l’étranger. J’ai peur d’être habillé comme un plouc si je dois me rendre dans certains endroits. Après le Goncourt, j’ai été invité un peu partout, à l’étranger notamment, dans les instituts français et les ambassades. C’était un stress pour moi : « Comment je m’habille ? Est-ce que je dois mettre une cravate ? Une veste avec un jean ? » Ces sentiments d’illégitimité, d’impostures, ils remontent très vite à la surface. J’étais à NYC récemment pour recevoir un prix. Je me retrouve avec une dame assez snob à qui j’explique qu’avant le prix je n’avais pas eu beaucoup l’occasion de voyager. Elle me répond : « Mais enfin, il suffit d’être débrouillard, ça n’a rien à voir avec l’argent. » Et je me suis senti tellement con. Alors qu’elle actualisait dans notre discussion des choses que je connais à fond : le sentiment de naturalité des habitudes bourgeoises, le fait qu’on croit qu’il suffit de vouloir pour pouvoir, etc. Pourtant, j’étais incapable de lui répondre, de démonter son discours. Parce qu’elle était bien assise dans son monde et que j’y étais un nouveau venu.
Houellebecq s’emmerde moins que toi sur ces questions…
Oui mais il est originaire d’un milieu bourgeois. Le père est ingénieur, la mère médecin. Ça n’a rien à voir et il a fait Agro. Houellebecq parle des classes moyennes mais nous ne sommes pas du tout nés au même endroit.
« J’écoutais récemment les entretiens de Jean-Claude Fasquelle, ancien patron de Grasset, dans À voix nue : le plus dur, avançait-il, ça n’est pas pour ceux qui n’ont jamais eu de succès parce qu’on peut toujours espérer qu’ils en vendent un jour. Non, le pire, c’est pour les gens qui ont connu la réussite et qui ne parviennent plus à vendre parce qu’une fois que ce déclin-là survient, la situation ne peut plus s’inverser ».
Tu t’es affranchi de ce milieu ?
En grande partie. J’allais dire que je suis un électron libre mais le terme est impropre car il laisserait penser que c’est une position enviable et ça n’est pas le cas. Le lieu où je m’ancre, c’est dans le travail. Prendre des vacances est une tannée pour moi : je ne sais jamais où aller, je ne suis bien nulle part. Je me sens à ma place quand je lis un bouquin, que je regarde un film ou que j’écris. Ces activités constituent le lieu que je me suis fabriqué pour me sentir à peu près à mon aise.
Tu n’es jamais plus malin que le lecteur.
J’essaie qu’il n’y ait pas d’opacité dans l’écriture, que ça soit fluide, qu’on ne sente pas injurié par le niveau de langue. Ce qui n’empêche ni style, ni montée en puissance. C’est une démarche politique d’être accessible à tous, mais surement pas un truc d’épicier : être ouvert à la clientèle la plus large. Par ailleurs, je n’essaie pas d’inventer des choses ou d’être en rupture avec la tradition. Les vieilles lunes de la modernité me font plutôt marrer. Étudiant, je trainais beaucoup avec des gens des Beaux-Arts et je voyais comme ils étaient encore plein de ces idéologies des avant-gardes. Faire du neuf. Injurier l’histoire. Rompre. Être absolument moderne. Je ne ressens pas du tout ces exigences et beaucoup de ceux qui pensent s’inscrire dans ce genre de geste révolutionnaire se contentent bien souvent de faire n’importe quoi. Moi, j’essaie de rendre avec justesse, c’est tout. Je m’intéresse au monde, au temps, aux gens. J’essaie de raconter ça, comment nous sommes des corps qui jouissent et meurent. Et je fais en sorte que ma mère puisse lire mes livres.
Tes modèles écrivains, quels sont-ils ?
Flaubert d’abord, très très fort. Céline a compté, pas existentiellement, mais dans son écriture. Pialat auquel je m’identifiais tellement. Il est le dernier de sa génération à percer. Ça a produit chez lui une immense frustration, une grande colère. Réussir à 40 ans quand tous les gens de votre âge tiennent le haut du pavé depuis 10 ans, c’est un truc difficile à encaisser. Sa volonté de dire le réel comme une vengeance, voilà un truc où je me retrouve. Une manière de dire aux autres : « Allez-vous faire foutre ! ». Moi aussi, j’avais ça très fort en moi.
Ce qu’il a fait à Cannes en 1987 debout sur scène et le poing en l’air après qu’il a reçu la Palme d’Or.
Un geste qui témoigne d’une bonne dose de paranoïa et d’une d’extrême sensibilité. Il ne retenait que ce qui n’allait pas. Je m’identifie beaucoup à lui.
Et la musique alors ?
Je suis une bille en musique. Je n’ai pas lu sur le sujet par exemple, j’ai l’oreille assez faible et mon goût est assez primaire. Cela ne me manque pas tellement. J’en écoute quand je fais autre chose : en conduisant, en préparant la bouffe ou en faisant le ménage par exemple.
J’écoute rarement de la musique quand j’écris et si j’en écoute, je dois mettre des boules Quiès pour me tenir à distance. Il y a des moments où j’écoute de la musique à dessein, pour me fouetter. Par exemple, j’ai réécrit cinquante fois la scène de mariage à la fin de Connemara en écoutant le tube de Sheila dont il est question à ce moment-là.
On devine sans que tu le dises explicitement qu’il s’agit de Spacer, écrite Nile Rodgers et Bernard Edwards de Chic.
Je voulais rendre la sensation que produit ce titre là, sur un corps à ce moment-là, par l’écriture. C’est une scène assez triste mais qui manifeste une grande exultation des corps. Les modèles, c’étaient La Merditude des Choses ou Belgica, ces films qui représentent la fête pour ce qu’elle est vraiment. Pas seulement un divertissement, un plaisir, une tentative de communion, mais aussi un moment de pure dépense, comme la guerre, quelque chose d’orgiaque et de terrible, où toutes les ressources sont dépensées, jusqu’à épuisement, jusqu’à la honte et la ruine. Des scènes de boisson jalonnent tous mes livres. C’est un grand et sombre plaisir qui occupe pas mal de place dans ma vie. Cette jouissance magnifique du premier verre. Depuis mon adolescence, je suis aux prises avec ça. Je le domestique comme je peux : éviter de boire l’apéro tout seul par exemple. Je suis incapable d’y renoncer. Le problème c’est que j’ai une nature addictive, excessive. Au moins, ça ne me rend jamais agressif.
Tu as été salarié longtemps, tu as souffert d’un burnout. Maintenant, tout cela est derrière toi.
C’est un luxe énorme de me dire que je ne serai plus jamais salarié. J’ai gagné plus d’argent avec le Goncourt que mes parents ont pu en mettre de côté en toute leur vie. Ma mère pense que je cours à la ruine quand elle voit les impôts que je paye ! C’est assez bizarre, ce que produit la société : elle donne la possibilité à l’un de ses membres de ne plus dépendre d’elle. Elle sécurise la position de quelqu’un qui lui crache dessus. C’est tellement singulier comme phénomène. Il faudrait que des anthropologues se penchent là-dessus, de la même manière qu’ils analysent les rituels magiques d’une peuplade lointaine. Ce type de statut est tout de même sidérant. On n’a même plus à être utile. On peut mordre la main qui vous nourrit et tout le monde trouve ça formidable. C’est Houellebecq, encore lui, qui disait que le poète est un parasite sacré. Il a fallu construire cette sorte de place forte, autonome, à l’abri des pouvoirs de l’argent et du travail. Il y a sans doute une histoire sociale des fonctions de ce type (fonctions qui n’ont d’ailleurs pas tous les droits). Mais il me semble qu’il y a là quelque chose de plus profond, archaïque. Peut-être qu’il existe dans toutes les sociétés des places de cet ordre, préservées, pour les fous, ceux qui tiennent le miroir ou le chronomètre. Mais peut-être que je fabule.
T’impliques-tu dans les adaptations de tes bouquins au cinéma ou à la télévision ?
Des réalisateurs ou des productions nous contactent, proposent des projets, et on décide avec Actes Sud de vendre les droits à tel ou tel. On me propose parfois de m’impliquer dans l’écriture du scénario, et c’est ce que j’ai fait pour Aux animaux la guerre (Série d’Alain Tasma). Mais sur les deux derniers romans, j’ai préféré décliner. Trois ans à les écrire, presque deux ans à en parler derrière pour la promo à répéter tous les soirs la même chose. On en peut plus. On a envie de passer à autre chose.
Comment tu expliques le fait d’être à la mode comme ça, en ce moment ?
Je pense que ce que je fais est en adéquation avec l’époque, ce qui est différent d’être à la mode. C’est comme un phénomène de coïncidence entre des préoccupations intimes, personnelles, et ce qui traverse collectivement notre société. Cela dit, je ne suis pas le seul et ce succès aurait très bien pu tomber sur quelqu’un d’autre. Le Goncourt a beaucoup compté dans la propagation de mon travail, et je suis convaincu à 1000% que ça n’allait pas de soi. Je ne me suis jamais dit « c’est bien mérité ». Il a fallu pour cela des circonstances, la chance et le hasard, le soutien des libraires, avoir la bonne maison d’édition, un bon papier dans un journal, au bon moment, etc. Pour vivre ça, avoir du succès quand on écrit, il faut que tellement de trucs s’alignent. C’est presque flippant. Je me dis qu’un coup de vent, et il en aurait été tout autrement.
Par ailleurs, je ne vois pas ça comme un acquis, un truc qui durera toujours. Je ne suis pas du tout sûr que je bénéficierai d’un tel engouement dans quinze ou vingt ans. J’ai ça très fort à l’esprit. Ce que je vis, c’est un moment. Et un éventuel déclin ne serait pas forcément la conséquence d’un affadissement de mon travail, d’une créativité qui se tarit, parce qu’on peut ne plus intéresser les lecteurs alors même que les bouquins sont encore meilleurs. Il suffit que ce qu’on a à donner ne soit plus en adéquation avec ce que l’époque attend. Et la lune de miel prend fin. J’écoutais récemment les entretiens de Jean-Claude Fasquelle, ancien patron de Grasset, dans À voix nue : le plus dur, avançait-il, ça n’est pas pour ceux qui n’ont jamais eu de succès parce qu’on peut toujours espérer qu’ils en vendent un jour. Non, le pire, c’est pour les gens qui ont connu la réussite et qui ne parviennent plus à vendre parce qu’une fois que ce déclin-là survient, la situation ne peut plus s’inverser. Ça n’est pas une question de qualité, c’est tout simplement l’époque qui n’a plus besoin de toi. Ce moment que je suis en train de vivre, qui aura une fin, ne m’est pas dû et il est en partie le fait de la chance et du hasard.
Le titre de ton dernier bouquin est musical. Sardou est l’un des artistes fondateurs d’une certaine culture qui nous lie tous avec Johnny et Claude François et dans trente ans, il est possible qu’on entende ces chansons en soirée.
C’est vrai que des gamins les connaissent, elles se transmettent. Cela dit, on constate quand même un morcellement des cultures, chaque pays fonctionne de plus en plus comme une juxtaposition de bulles. On a parfois l’impression que les paysages s’uniformisent, que toutes les villes finissent par se ressembler, mais dans le même temps, les mondes sociaux s’autonomisent. Les grandes institutions unificatrices, type chemin de fer, école, armée, ne brassent plus comme avant : chacun vit dans sa bulle algorithmique, lit ses potes, se fait son idée de la vérité et de ce qui est bien culturellement.
Tu as démarré le prochain ?
Après trois romans, je me rends compte qu’il y a une sorte de système qui se met en place d’un livre à l’autre : je reprends des personnages, les transplante, et ils sont rejoués ailleurs, différemment, d’autres histoires se déplient à partir de là. Et je sens bien quels sont les personnages de Connemara qui continuent à me travailler. Quand j’y pense, quand on m’en parle, ça me serre. C’est surement eux qui vont revenir.

Et tu travailles comment ?
J’écris dans mon lit ou mon canapé, mille mots chaque jour. Mon téléphone portable n’est jamais loin.
Instagram et le reste ont remplacé les Stratégies Obliques inventées par Brian Eno et qu’ils utilisaient avec David Bowie quand ils étaient bloqués sur une idée en studio. Nos smartphones nous permettent de nous aérer brusquement la tête avant de reprendre une activité sous un autre angle.
J’avoue que je regarde mon téléphone sans arrêt, toutes les dix minutes à peu près. C’est comme une respiration. Mais un tic aussi. J’y écris pas mal de texte, des textes courts, denses, mais qui ne sont pas vraiment des poèmes. Ça m’arrive d’écrire des poèmes, mais je trouve que ma poésie est médiocre, c’est assez frustrant. Je me sens un peu comme quand j’essayais d’écrire des romans, de la fiction, et ne faisait encore qu’imiter les ainés, les modèles. Peut-être que je n’y arriverai jamais.
« La nostalgie c’est dire : c’était mieux avant, il faut que ça revienne. Moi j’essaie juste de rendre sensible le temps qui passe en mettant en scène des rapports entre présent et passé. »
Peut-être n’es-tu pas totalement objectif ? On existe qu’à travers le regard des autres.
Oui, on n’est pas seul maître à bord. Une œuvre est co-crée par sa réception. Raison pour laquelle ça m’intéresse de lire les critiques, d’écouter les lecteurs. En revanche, je ne regarde pas mes entretiens ni les portraits. Même mes photos, je n’aime pas trop ça.
C’est comme entendre sa voix sur bande, c’est désagréable.
Je redoute cet effet miroir et je me méfie de l’image que les gens se font de moi. Je me dis que si j’en suis trop conscient, je pourrais être tenté de coïncider avec cette fiction. Cela ne m’intéresse pas et je continue mon truc. J’essaie de ne pas me prendre pour Nicolas Mathieu ! Pour le moment, ça va : je vis en province, je fréquente globalement les mêmes gens. Cela dit, c’est faux. Il y a dix ans, je ne connaissais à peu près aucune des personnes avec lesquelles je corresponds aujourd’hui, ou dîne quand je suis de passage à Paris. C’est un milieu professionnel nouveau, composé d’autres auteurs, de journalistes, de lecteurs avec lesquels je vais papoter et on devient copains. Je ne crois pas du tout à la séparation auteurs/lecteurs. Si on m’interpelle, je réponds volontiers.
Es-tu nostalgique des périodes que tu décris dans tes livres, comme les années 90 ?
Je ne suis pas nostalgique mais j’ai un sens très aigu du temps qui passe. Je ne voudrais revivre ces années-là pour rien au monde mais, dans le même temps, c’est à ce moment-là que j’ai aimé le plus fort de toute mon existence, que mes parents étaient jeunes, etc. Je vois bien que ce qui a été ne sera plus. Ce sentiment du « ça ne sera plus » me hante, je ne pense qu’à ça tout le temps : je vois mes parents vieillir, mon fils grandir et l’issue n’est pas très favorable. J’essaie de mettre en place des dispositifs littéraires qui rendent cette impression. Il n’est pas question là-dedans de nostalgie, mais de mélancolie.
La nostalgie c’est dire : c’était mieux avant, il faut que ça revienne. Moi j’essaie juste de rendre sensible le temps qui passe en mettant en scène des rapports entre présent et passé.
Tu as un certain talent pour restituer cette période qu’est l’adolescence, avec lucidité.
C’est une période charnière de ma vie, les sensations, les objets, la manière d’aimer : tout remonte pendant ces moments d’écriture. Il y a des choses alors qui me reviennent, et dont je ne serais pas foutu de me souvenir dans une conversation. C’est l’écriture qui rend cette mémoire possible, et qui n’est pas documentaire. Je n’effectue pas de recherches. Ça revient spontanément.
Avais-tu du succès avec les nanas à cette époque ou étais-tu un polard à lunettes ?
Pas du tout, aucun succès et j’avais un motif amoureux très ancré : j’étais toujours attiré par celle avec laquelle c’était le moins possible. Une bonne adolescence de merde.
C’est comme ça que ça marche, il ne faut pas que ça soit trop facile.
C’est la fameuse phrase de Groucho Marx « Je ne voudrais jamais être membre d’un club qui m’accepte comme l’un de ses membres » ! Mais on en revient…
L’entretien terminé, nous rejoignîmes le plateau de la Croix-Rousse à l’atmosphère si particulière et qui semble se soucier du reste de la ville comme d’une guigne. La librairie « Vivement Dimanche » qui servit de cadre à la rencontre entre Nicolas Mathieu et ses lecteurs qui, ô surprise, comptaient plus de profs et de sociologues que de chauffeurs routiers. Pourtant, ses livres mériteraient de passer de main en main, c’est dommage car il est un grand auteur populaire. Nous finîmes tard et joyeux après une de ces soirées qui donnent le sourire pour plusieurs jours, comme l’a si justement décrit Maya Flandin, propriétaire de la librairie, notre hôte d’un soir.









3 commentaires
j’en ai rien à foutre de la fiction et toi le paumé tu ferais mieux de faire pareil.
+ vous vous petez les yeux sur vos bouquins de merde
+ cet auteur a récupéré une oeuvre millenaire ecrit par qqun d’autre ya des milliers d’annees,quelquepart dans les 7 cycles d’apocalypses.
Qqun(un vieux boomer) m’a dit une fois que Mick Jagger etait con comme un pied,qu’il avait fait une soirée avec lui,il avait du mal à comprendre comment il avait pu ecrire toutes ces chansons.
Il a été seduit par ma theorie sur l’apocalypse.
soyez aware sans ces romans de mes couilles.
ça alors, J-Claude qui se fait critique littéraire !! Les bras m’en tombent. Jeffarde n’a qu’a bien se tenir !
Très bon entretien ceci dit ! Furieuse envie d’imprimer sa sentence sur LinkedIn et de la coller sur ma porte au boulot.