Le 17 mai 2013, deux robots retournent leur veste et découvrent qu’elle est doublée de vison : à l’intérieur, un album unique à bien des égards. Pas seulement pour la qualité de ses singles ou de ses stratégies marketing héritées de l’époque « Thriller », mais parce que « Random Access Memories » restera dans l’histoire comme le seul disque ayant été capable de relier en pointillés, via les genres brassés et les artistes invités, un demi-siècle musical. L’équivalent d’un film en accéléré à 24 carats par seconde et qu’il est possible, dix ans plus tard, de revisionner avec une émotion terriblement humaine, après tout.
« Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende ! ». A l’heure internet, tout le monde ou presque connait désormais la célèbre citation extraite de The Man Who Shot Liberty Valance de John Ford. Même pas besoin d’avoir vu le film. Dans un monde connecté, tout est désormais accessible. L’information. La musique. La connaissance. Alors oui, cette phrase, nous l’avons déjà tous lu. On a compris l’idée, et nous ne sommes pas les seuls : dès le début de l’histoire Daft Punk germait l’idée que les masques – de chiens comme de robots – seraient plus efficaces que deux visages de mecs blancs au physique radiophonique. Et quant à savoir comment deux Français sont parvenus à transformer un problème logistique (délaisser les home studios d’appartement à cause des enfants en bas âge) en un album record (3 millions de copies vendues rien que pour 2013 et 5 Grammy Awards), il y a un monde que même ChatGPT ne saurait imaginer.
Au départ donc, il y a deux mecs souhaitant écrire un classique. Un second, si l’on compte « Discovery » (question de goût). Un classique donc, mais avec rien en poche ou presque. Nous sommes alors en 2008, les deux approchent doucement mais surement de la fin de leur trentaine et la barre est haute : non seulement le dernier album studio en date (« Human After All », 2005) n’a pas laissé un souvenir impérissable, mais la B.O. écrite pour le film Tron en 2010, aussi emphatique soit-elle, n’a pas réussi à faire oublier celle composée par Wendy Carlos pour le film original. Pendant quatre ans, soit la période nécessaire à l’accouchement de « RAM », Bangalter et Guy-Man vont peut-être même sans le savoir ruminer ces grands questionnements : comment marquer les esprits une seconde fois quand votre nom est déjà sur toutes les lèvres, que des photos de vous décasquées pullulent sur Google Image et que vos plus vieux fans ont pris un crédit maison sur 20 ans depuis votre premier tube ? Comment se redonner l’envie d’avoir envie, pour citer Johnny ? Et comment marquer ce panier à 100 points qui permettrait de vous hisser au niveau de goldies comme les « Dark Side of the Moon » de Pink Floyd, « Sgt. Pepper’s » des Beatles ou « Thriller » de Michael Jackson ?

La jouissance du quadragénaire
Arrivé en haut de l’échelle la machine Daft Punk cale, un peu. On a tous connu ce moment un peu trouble, le sentiment de faux plat dans une relation de couple ou dans son boulot en CDI. On n’en voit plus la fin, on ne sait plus trop comment mettre des paillettes sur ces jours qui s’enchainent comme autant de copiés-collés. Dans le cas de Guy-Man et Bangalter, c’est pareil mais tout de même un peu différent : devenus millionnaires, ils n’ont plus grand-chose à perdre. Et en conséquence, plus rien à gagner.
A cheval sur Tron (drôle de phrase), des maquettes prennent alors forme au studio Gang, à Paris. Les deux ont vieilli depuis Da Funk. Et puis les appartements étant désormais remplis d’enfants, il y a besoin de prendre le large ; un peu comme on partirait au bureau pour oublier le bruit. Nait alors cette idée de « faire un album, comme si internet n’avait jamais existé », comme ils l’expliqueront plus tard à Nile Rodgers (vous savez, le mec avec des dreads qui sourit tout le temps et qui inspiré des vocations aux pires guitaristes funk de la planète). Le déclic ? L’enregistrement de la B.O. de Tron, justement, pendant lequel les deux robots ont bossé pour la première fois avec de vrais humains musiciens. Pire que ça même : ils étaient une centaine à leur disposition. Disney, la multinationale du divertissement, a sorti le carnet de chèques infini. Pour les punks pourris, c’est une révélation : leur quatrième album se fera en studio, comme à l’époque où Daniel Bangalter, père de Thomas, dépensait des sommes astronomiques dans la confection du sien, en plein Paris.

Pour Guy-Man et Thomas, l’avenir est plus à l’Ouest. Après Gang, direction les États-Unis pour poursuivre, loin du domicile familial, l’enregistrement de ce qui n’est pas encore « RAM ». Comme les totems sont à Daft Punk ce que les décolletés sont à Nicki Minaj, il sera enregistré au Electric Lady studio de Jimi Hendrix, là même où Chic posa les pierres de son premier album. C’est ici que le guitariste les rejoint la première fois, et c’est presque à croire que le pape du groove agit sur les Daft Punk comme un brumisateur Air Wick : exit les sons agressifs et la solitude à tripoter des boutons (il doit vraiment faire chaud sous ces casques), bonjour la jouissance, le confort et les rondeurs.
Sur la ligne d’horizon, les deux se remémorent l’insouciance heureuse de la fin des années 70, les disques d’Eagles, Fleetwood Mac ou Steely Dan ; une certaine vision de l’Amérique grandiloquente qui patinait vers le futur sans trop se soucier de la guerre froide. « RAM » sera donc l’inverse exact d’un tas de ferraille ; on y trouvera de vrais musiciens, des pointures sorties du placard. Et puis surtout, ce qui manque aujourd’hui tant aux Américains quand il est question de faire des disques américains : un sentiment de grandeur magnifié par des arrangements tout sauf lourdingues, et que des Français exilés comme Michel Colombier parviendront partiellement à raviver dans les studios californiens grâce à cette French touch avant l’heure. Il suffit à ce propos de réécouter attentivement Horizon (Japan CD) sur la réédition de « RAM » pour entendre un bel écho au Holidays de Michel Polnareff. Des Français loin de chez eux tentant de réinventer les disques de leur enfance pour se cajoler à l’intérieur ; voilà le propos foncièrement nostalgique servi par « Random Access Memories ».
L’importance du casting
L’histoire aurait pu s’arrêter là. On aurait placé de vieux requins au centre du studio et on aurait fait vroum vroum. Il y aurait eu le bassiste Nathan East (reconnu pour parties derrière Stevie Wonder, Michael Jackson), le batteur Omar Hakim (Miles Davis, Bowie, Chic ou Michael Jackson) et le guitariste Paul Jackson jr. (Herbie Hancock ou Michael Jackson) et les deux Français s’amusant à roter des mots en autotune – il est d’ailleurs toujours aussi troublant d’entendre « we are all Mexicans » sur le refrain de Get Lucky. Ca aurait peut-être suffi, en fait. Mais non. Le génie de Daft Punk, si tant est que le mot ne soit pas galvaudé, c’est d’avoir réussi à transformer un triste et classique quatrième album – souvent prémisse à un best-of de fin de contrat suivi d’une séparation du groupe – en Agences Tous Risques du BPM. Et au-delà de ça, à avoir anticipé que les cinquante glorieuses de la pop music arrivant à leur terme, cet album serait le dernier instant possible pour réunir sur deux faces d’un vinyle cet arc-en-ciel de stars intergénérationnelles.
« C’était comme un film sans camera, mais avec des micros. Nous étions des réalisateurs d’un film sonore mais nous n’avions pas de scénario » (Thomas Bangalter, France Inter)
Rétrograde, « RAM » l’est évidemment. Les ombres du I feel love de Donna Summer comme du Freak de Chic planent au-dessus. Mais le talent de cette réunion d’étoiles improvisée, c’est d’être parvenu à transformer ce qui aurait dû être un EHPAD du dancefloor en cohabitations heureuses où chacun des colocataires dispose de sa propre chambre. Faisons un rapide tour du propriétaire pour mieux comprendre comment les Daft Punk ont hacké la timeline du temps pop.
Moroder : né en 1940, 73 ans au moment de la sortie de « RAM »
Quand Giorgio by Moroder est enfin publié, cela fait déjà un paquet d’années que le héros de la disco sucre les fraises. Son dernier grand album remonte à 1982, et encore, c’était pour la B.O. de Cat People avec l’immense version interprétation du titre éponyme par Bowie. Et depuis, plus rien ou presque – voir à ce sujet cette interview de l’Italien sur sa vie dans les années 80 et 90. Bien conscients de cet état de fait, Bangalter et Guy-Man lui proposeront donc de ne pas toucher un clavier et de simplement raconter l’histoire qu’on entend sur l’album, et qui inspirera quelques années plus tard cet énorme track à Soulwax, Close to paradise, où le même principe du témoignage musical est repris pour raconter l’histoire d’Ibiza. Dans le cas de Moroder, le retour de hype offert par les Daft n’aura pas suffi à le relancer sur le circuit des vieilles bagnoles ; son album « Déjà-vu » publié en 2015 portait hélas très bien son nom.

Paul Williams : né en 1940, 73 ans au moment de la sortie de « RAM »
Autre dinosaure présent dans le vaisseau intergalactique des Daft, Paul Williams est un choix-coup-de-génie. Parce que moins connu du grand public que Moroder, parce que grand bonhomme du show-business américain (malgré sa taille : 1m57), parce que légende du soft rock des années 70 et figure emblématique du Phantom of the Paradise de Brian de Palma, où il campe le producteur satanique nommé Swan. On peut donc écrire sans trop trembler que la présence de Williams relève davantage d’une envie artistique que d’une tentation commerciale. Au final, Touch deviendra l’une des pierres angulaires de « RAM », coincée dans l’angle mort entre les autres featurings.

Nile Rodgers : né en 1952, 60 ans au moment de la sortie de « RAM »
On a fini par l’oublier mais en 2012, tout le monde avait oublié Nile Rodgers. Moins ringards que Moroder ou Williams dans l’esprit du grand public, Nile dispose alors d’une encore solide réputation, hélas pas convertis en grands enregistrements depuis des plombes – on le retrouve même en sideman derrière Cheb Mami en 2001 ! Moralité : cette participation inespérée sur plusieurs titres de « RAM » permettra à Rodgers de sortir de la boite démonstrateurs de guitares pour tuto YouTube où il s’était peu à peu empêtré. Avec, à la clef, une belle revanche pour celui qui vécut en direct la terrible soirée Disco Sucks où les disques du genre furent brulés dans un stade, le 12 juillet 1979. So Get Lucky is the new Let’s dance.

Gonzales : né en 1972, 40 ans au moment de la sortie de « RAM »
Chilly et les Daft, c’est une longue histoire. On arrive ici aux musiciens invités issus de la même génération que les deux Français, et le résultat de cette improvisation (« ils m’ont laissé joué du piano pendant des heures et ont finalement pioché ce qu’ils voulaient là-dedans », dixit), c’est Within, la seule ballade du disque en low tempo où les accords de Gonzo se marient à merveille au vocodeur.
Todd Edwards : né en 1972, 40 ans au moment de la sortie de « RAM »
Un choix couillu que celui de Todd Edwards pour chanter sur Fragments of Time. Primo : hormis les fans qui l’ont déjà entendu dix ans plus tôt sur le Face to face des Daft (« Discovery », 2001), personne ne le connaît. Secundo : on peut saluer la fidélité de Bangalter et Guy-Man pour qui le concept de discographie rime aussi avec amis. Au final, avec cette composante soul et ces fantastiques parties de guitar steel, Fragments of Time deviendra l’un des plus beaux moments de l’album et accessoirement le meilleur titre à écouter en voiture (ce que disent d’emblée les paroles du morceau : « Driving this road down to paradise, Letting the sunlight into my eyes Our only plan is to improvise »).

Pharrell Williams et DJ Falcon : nés en 1973, 39 ans au moment de la sortie de « RAM »
Dans le cas du premier, c’est la logique commerciale qui justifie sans doute sa présence sur l’album. Et même si Happy sera publié a posteriori, l’Américain est un historique faiseur de tubes. Sa partie vocale sur Get Lucky, posée à Paris en plein jetlag en une seule prise, en atteste. A noter que l’envie d’une collaboration était réciproque, Pharrell ayant avoué plus tard avoir proposé ses services aux Français dans une soirée organisée par Madonna, « et ce même si c’était pour jouer des tambourins ».
Dans le cas du second, DJ Falcon, on le retrouve discrètement sur le titre de clôture, Contact. Belle manière de doublement refermer les années French touch, et ainsi en finir sans le savoir avec l’histoire même des Daft, débutée 20 ans plus tôt.
Julian Casablancas et Panda Bear : nés en 1978, 34 ans au moment de la sortie de « RAM »
Ce sont les « jeunes » de la bande. Sans dire que leur présence soit le résultat d’un calcul marketing, Casablancas et le leader d’Animal Collective ont de quoi rassurer le marché indie américain sur un tracklisting composé de plusieurs vieux débris inconnus des nouvelles générations. Le témoignage du chanteur des Strokes, diffusé à l’occasion de la réédition de « RAM », est à ce titre d’une sincérité désarmante quant à la manière de bosser en studio avec les deux maniaques : « ils m’ont d’abord fait écouter deux chansons. Il s’avère que l’une était le futur refrain d’Instant Crush, et l’autre, son couplet. Je ne sais pas si c’était intentionnel de leur part, mais l’idée était inspirante ».
Étonnamment, aucun des protagonistes n’est mort dix ans plus tard. « RAM » agirait-il comme un élixir de jouvence sur ceux qui l’ont enfanté ? Possible. Une chose, au moins, est certaine : hormis peut-être McCartney avec son récent album collaboratif (« McCartney III Imagined », avec Anderson .Paak, Beck, Damon Albarn ou encore St. Vincent), il devient aujourd’hui impensable d’imaginer un tel casting allant des années 60 à 2010 sur un nouvel album. La faute au temps qui passe et décime les rangs des dernières icônes des années 60, évidemment ; la faute aussi à une industrie qui privilégie toujours un peu plus les formats courts et les singles, dans un contexte de Tiktokisation de la musique.
Sacré casting que celui de « Random Access Memories », donc. Qui permet dans un ricochet de séduire plusieurs générations d’auditeurs d’un coup d’un seul ; autant les boomers à platines vinyles que les gamins de clubs ramenés devant une paire d’enceintes. Le succès commercial de l’album s’explique également par l’empilement des noms issus de la grande frise chronologique. Et à cette équipe pas très sauvage aurait même pu se rajouter Stevie Wonder, un temps pressenti sur l’album. Une rumeur d’autant plus alimentée par la présence de l’Américain sur la scène des Grammys en 2014, et depuis confirmée indirectement par Casablancas dans la vidéo promotionnelle à regarder ci-haut.
Qu’aurait donné Get Lucky par l’auteur de Superstition ? On ne le saura jamais ; pas plus qu’on n’entendra ce mystérieux album de Wonder que les Daft auraient pu produire en 2016 – rumeur, again. A la place, les deux robots bosseront successivement avec The Weeknd et Parcels ; ces derniers s’inspirant grandement des méthodes de production et arrangements de « RAM » pour leur double album « Day/Night ».
Du fétichisme au marketing
Dix jours seulement après la sortie de la réédition 2023, il s’était déjà écoulé 40 000 copies de « RAM » aux USA, lui permettant ainsi de revenir dans le Billboard 200. Etonnant, non ? En fait, non. Car ça aussi, on l’a appris dans les écoles de marketing : le besoin latent du client est un besoin non exprimé mais qui est susceptible de le devenir à tout moment.
/2019/04/12/daftpunkramdeluxe.jpg)
En offrant dès 2012 un disque de studio composé à grand renfort de billets de dollars, et ce au moment même où Internet et la musique Soundcloud s’imposaient around the world, Bangalter et Guy-Man prenaient la tendance à contre-pied. C’est le luxe des riches ; pouvoir se payer un sens inverse sur l’autoroute. Et cette posture, historiquement ancrée dans le storytelling de chaque sortie des Daft Punk, est doublée d’un retour vers des influences qu’on n’imaginait plus entendre en 2012 : sur « RAM », on entend bien évidemment le « Thriller » de Michael Jackson (c’est presque marqué en gros sur la pochette), mais d’autres se planquent plus habilement çà et là. On pense à Supertramp ou au Rosanna de Toto (qui croyez-le ou non s’enchaine très bien avec Get Lucky dans une playlist) ; ce qui finalement n’est pas un hasard puisqu’on retrouve Jeff et Steve Porcaro aux crédits sur « Thriller ».
A cette obsession de la grandeur radiophonique américaine des eighties s’en rajoute une autre, liée au rapport très personnel des deux Français au fétichisme et à l’adoration de la musique comme totem visuel. Des exemples ? Oui, trois.
Quand Nile Rodgers est convoqué en studio pour l’enregistrement de ses parties, il lui est demandé d’amener ses deux guitares fétiches, celle en plexiglas (celle que les Daft regardaient à la télé quand ils étaient gamins), ainsi que la « Hitmaker », dite la faiseuse de tubes.
La signature de l’album « RAM » ne n’est pas faite n’importe où : c’était chez Columbia. Un choix stratégique plastronné dès le teasing de l’album, et qui tend à prouver qu’avoir choisi la maison où furent publiés les grands albums des 70’s (« Hotel California » des Eagles, « Aja » de Steely Dan, « Rumours » de Fleetwood Mac) était tout sauf un hasard pour les deux collectionneurs.


Un dernier exemple, enfin, avec la campagne de promotion de l’album, débutée à l’ancienne avec des billboards sur les voies rapides américaines. Un choix délibéré pour le duo, qui se ramena en réunion marketing de pré-lancement avec le livre Rock ‘n’ Roll Billboards of the Sunset Strip de Robert Landau. Il est évidemment plus facile de créer le désir par l’objet plutôt qu’avec une vulgaire campagne de pub digitales. Dès lors, la machine était lancée et la diffusion surprise du teasing Get Lucky à Coachella, suivi d’une liste des contributeurs sur le disque, ne ferait qu’enfoncer le clou. Un clou si profond que même dix ans après, on ne voit pas très bien quel autre groupe aurait su faire mieux pour imprimer son nom dans la rétine des fans aveuglés.
« Franchement, ils ne vont pas faire un « Get Lucky 2″ qu’ils vont promouvoir sur TikTok en faisant des chorégraphies habillées en robot ». (Antoine Ressaussière, ancien collaborateur des Daft Punk en charge de l’un des premiers concerts du duo aux Transmusicales de Rennes en 1995, pour Society)
Revisiter le territoire
Passéiste par endroits, nostalgique même dans sa conception, « Random Access Memories » offre en 2023 un coup final à ceux qui souhaiteraient le faire tomber de son piédestal. Avec sa réédition « surprise », il donne une double occasion de regarder en arrière, comme dans une mise en abîme de lui-même grâce aux 25 minutes de musique inédites qui permettront non seulement aux deux robots de se payer de nouveaux circuits imprimés, mais aussi de redécouvrir certains titres sur lesquels on aurait pu passer un peu trop vite ; éclipsés qu’on était par l’esbroufe arpeggiatorée du Giorgio by Moroder ou l’efficacité absolue de Get Lucky.
Ainsi en est-il de Touch, le titre précité avec Paul Williams, dont on redécouvre encore plus clairement les trois parties dans l’épilogue instrumental du disque bonus. La légende raconte même, à propos de ce titre, que le fétichisme de Daft Punk les aurait poussé à faire reconstruire à l’identique le studio de Swan dans Phantom of The Paradise. Wiliams, éberlué par tant de débauches de moyens, n’y aurait même pas posé une seule note.
Ainsi en est-il aussi de GLBTM (l’ébauche de Give Life Back to Music) avec ses handclaps dignes d’un flamenco, et qu’on n’avait à l’époque pas clairement entendu. Et même des 30 secondes de la early take de Get Lucky sur un Wurlitzer, encore non pourvue de la guitare de Rodgers. Et que dire du seul inédit, Infinity Repeating, qu’on débute avec une moue (« Julian Casablancas, ENCORE ? ») et qu’on découvre dans une posture inédite, miaulant son texte d’été sans fin, avec carte postale de soleil couchant façon Miami Vice.
Mais preuve en est que « RAM » reste un grand disque, ladite réédition des dix ans, au-delà de l’excitation générée par cette bombe marketing encore une fois préparée silencieusement, est décevante. Comme incapable de surpasser ce qui, voilà déjà dix ans, sonnait comme un adieu définitif. Il faut attentivement réécouter le dernier titre de la version originale, Contact, avec l’impression de voir et surtout entendre une fusée décoller vers l’espace. Pas une fusée SpaceX capable de revenir sur Terre, non, plutôt celle du 2001 de Kubrick, quand David Bowman, lâché comme les Daft par les machines, finit le voyage en solitaire et s’explose aux confins de l’espace-temps. C’est cette même déflagration que (re)donne à entendre cette réédition de « Random Access Memories », un disque qui au-delà des clins d’œil (aux barrettes mémoires des premiers ordinateurs comme au groupe de McCartney) se revisite en trois dimensions, commentant autant sa propre création que les 60 années écoulées puis résumées en seulement 13 titres.
Soixante ans, c’est aussi le temps qui sépare Tchaïkovski de la naissance des Beatles [1] et pourtant, personne n’aurait imaginé les Beatles invitant le Russe derrière Le Lac des cygnes sur le toit des studios Apple en 1969. C’est ce geste artistique, ce grand écart temporel, que propose « Random Access Memories ». Et si l’on peut déjà être sûr que cet a priori dernier album des Daft Punk résistera mal au temps long – voir le groove pataud du titre Prime avec batterie pyrotechnique à la Phil Collins – on peut néanmoins être certain qu’il permettra aux générations futures de redécouvrir les sonorités du vingtième siècle, à la manière du Golden Record, ce disque embarqué en 1977 sur la sonde Voyager avec des bouts d’Humanité rythmiques gravés dessus, de Mozart à Chuck Berry. Peut-être un jour, des robots d’ailleurs tomberont dessus et eux aussi, tomberont à la renverse. Mais pas sûr qu’une intelligence artificielle parvienne un jour à écrire des paroles aussi humaines que celles de Touch, et qui résonnent dix ans plus tard comme une épitaphe pour ce grand album pensé par et pour des êtres humains :
Touch, sweet touch
You’ve given me too much to feel
Sweet touch
You’ve almost convinced me I’m real
[1] Tchaïkovski est mort en 1893 ; McCartney a rencontré pour la première fois George Harrison dans un bus scolaire en 1953.
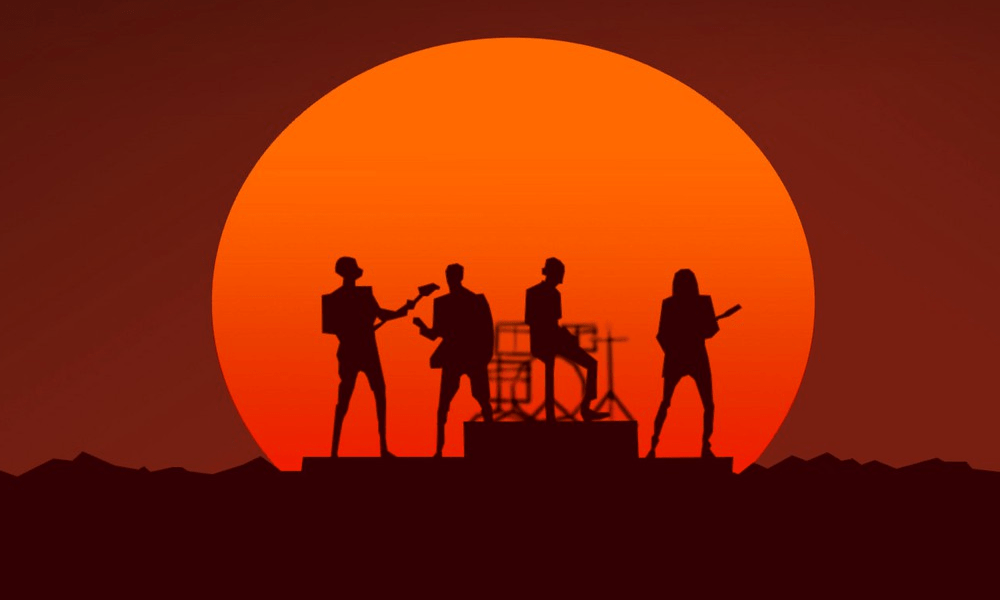








11 commentaires
minute de silence
decivilization D decibelles
tina vs murat
jak tati bollocks
& teenage jesus & the jerks de l’autothune!?
T celine dion ou marsseillais ?
cinEma baudruche!!!!!!!
@perpignan quand tu crie chômeurs, tout le monde se return et ce n’est pas une insulte.
dernier grand album de la pop culture ?
Ouaip ça serait bien
Ça nous ferait des vacances