Quand on est critique d’art, on espère toujours tomber sur LE chef-d’œuvre qui va rassasier pour un bon moment notre soif de plaisir esthétique. Malheureusement c’est (un peu) comme le grand amour, ça n’arrive pas tous les 4 matins. Pour se consoler de la déception de n’avoir vu aucun très grand film, voici pour vous un compte-rendu du FIFLR en 8 variations sur l’art de faire et de voir du cinéma, entre réel et fiction, propos nazis et attaque contre la culture américaine de masse.
 L’art de l’incipit officiel (3/6)
L’art de l’incipit officiel (3/6)
En bon professionnel, j’arrive pile poil pour la soirée d’ouverture du 46e Festival International du Film de La Rochelle au grand théâtre de La Coursive, où Dogman de Matteo Garrone est présenté en avant-première et en grandes pompes. Pour rien au monde je ne raterais les discours officiels, qui emmerdent autant ceux qui les font que ceux qui les écoutent, mais c’est comme l’oral du BAC, il faut y passer…
La déléguée générale du festival, le co-délégué général, le maire de La Rochelle JFF, les gros partenaires comme la Région Poitou Charentes.. Toutes ces belles paroles s’enchaînent sans trop de surprises jusqu’à.. jusqu’à l’arrivée de gens pas vraiment habitués aux protocoles officiels et là, et là on se décrispe enfin. La productrice du film, pour le coup vraiment à l’ouest: « Je pensais La Rochelle dans le sud de la France, et me voilà à l’Ouest.. Je suis désorientée mais heureuse d’être là ». Heureux d’être là lui aussi, l’acteur principal du film Marcello Fonte, gringalet souriant élevé dans un théâtre-squat italien qui improvise une vanne pour détendre l’atmosphère: « je me demandais.. C’est un théâtre ou un cinéma ? ». Même son réalisateur Matteo Garonne qui le connaît pourtant très bien est sur le cul : « je suis sûr que c’est la première fois que quelqu’un fait cette remarque, ahahah ». Trêve de plaisanterie, place à un débrief’ des films aussi impitoyable qu’un « tops & flops » de Pierre Menes.
« Du Zola à la sauce moderne, la coke remplace l’alcool »
Dogman (2018) : L’art de coiffer des chiens. (4,5/6)
https://www.youtube.com/watch?v=LI2JE_xjAaY
Le sud de l’Italie, une ville pourrie où les habitants vivent dans la crasse et la misère. Du Zola à la sauce moderne, avec la coke qui remplace l’alcool pour se buter et oublier sa vie de merde. Oui, c’est bien en Calabre qu’on se trouve, une région où l’on dégote de la poudre aussi facilement qu’une bouteille de lait demi-écrémé. Marcello, anti-héros et toiletteur pour chien (si si je vous jure) vend de la « C » lui aussi entre deux brushings canins, pour arrondir ses fins de mois. Un décor comme vous l’aurais compris idyllique, où tout le monde vit dans la paix et l’amour.. Évidemment, non : un accro à la cocaïne à moitié SDF commence à foutre le bordel en pétant la gueule à tout le monde pour avoir sa dose, jusqu’à défoncer ce pauvre Marcello qui était le dernier à le soutenir. Mauvaise idée : il plonge dans la merde avec le fou du village pour l’avoir couvert, tout le village les rejette violemment. Seul solution pour se racheter : buter son ancien « pote » et espérer être pardonné par ses anciens vrais amis. Une fin au suspense haletant que je ne vous spoilerai pas par conscience professionnelle. Actuellement dans toutes les bonnes salles
Au Poste ! (2018) : L’art du bordel (4/6)
Soirée SNCF oblige, le nouveau de Quentin Dupieux aka Mr Oizo aka l’artiste le plus tordu de sa génération nous sort un film qui part dans toutes les directions. Et comme avec la Société Nationale des Chemins de Fer Français, on angoisse en se demandant si on va bien arriver à destination sain et sauf. La faute à Benoit Poelvoorde, fatigué au début du film et qui retrouve son sens du n’importe quoi total dans la suite de l’histoire, en réussissant par exemple la prouesse de recracher la fumée de sa cigarette non pas avec sa bouche comme tout le monde, non pas avec son nez comme certains, mais via un trou dans son pull en laine déchiré.
Le second rôle joué par un Grégoire Ludig en feu n’est pas non plus en reste, qui bouffe des huîtres toutes entières, la coquille avec, affamé alors que l’enquête du commissaire Poelvoorde n’avance pas d’un millimètre. Complètement à côté de ses pompes, il essaye de résoudre l’histoire elle-même incompréhensible d’un cadavre retrouvé sur le trottoir dans une mare de sang, un fer à repasser à ses côtés. Histoire de nous paumer encore plus dans ce grand bordel narratif, Dupieux multiplie les ellipses entre présent, passé, futur, si bien qu’au bout d’1h on ne comprend absolument plus rien à ce qui se passe devant nos yeux. Mais qu’importe ? Ce film qui n’en est pas vraiment un est un prétexte pour faire fuser les dialogues et les punchlines insensées, comme celle d’Orelsan, qui fait un caméo d’Orelsan: « je veux me suicider, à part ça tout va bien t’inquiète ». Dupieux ne se refuse rien et le pire c’est que ça marche : le public est plié en deux durant 1h face à l’absurdité total de cet OVNI filmique qui commence dans un champ avec un chef d’orchestre à poil’ et se termine sur les planches d’un théâtre parisien comme si Dupieux s’était foutu de notre gueule depuis le début. L’idée de cinéma « comédie dans la comédie » est géniale, malheureusement la limite n’est jamais loin entre foutoir tordant et bordel (trop) incompréhensible. Actuellement dans toutes les bonnes salles
« Pourquoi travailler pour vivre quand on peut vivre sans travailler ? »
Le pickpocket (1959): L’art de voler (5/6)
Minimaliste et noir, ce film de Robert Bresson raconte la vie de Michel, être seul, énigmatique et célibataire qui ne veut pas travailler pour vivre. Alors il vole, encore, encore et encore, jusqu’à devenir un véritable pro de la rapine. Tout est si facile pour notre héros qui vit dans une planète située à 10000 au dessus du système socio-économique classique. Sous la pression de quelques rares amis, il tente d’arrêter à plusieurs reprises : impossible. Pourquoi travailler pour vivre quand on peut vivre sans travailler ? Alors Il continue à voler, tel un héraut d’une forme d’existentialisme hors-la-loi. Après Paris, direction Milan, Londres.. Plus rien n’arrête notre anti-héros amoral qui se paye des vacances tous frais payés et se shoote quotidiennement au vol tel un camé avec sa drogue : le plaisir est trop bon. Jusqu’au jour où, forcément, Michel se fait douiller par la patrouille.. Mais la fin n’est pas là, attention, ça serait trop facile pour le Marquis de Sade du cinéma français Robert Bresson, spécialiste des films profanes (Le Diable Probablement, Les Anges du Pêché) qui veut éviter à tout prix la morale basique du « voler, c’est mal ». Las de questionner ces questions économiques qui au final font chier tout le monde, il sort de son chapeau une épitaphe visuelle absolument incroyable où notre bad boy sans foi ni loi tombe finalement amoureux de Jeanne la belle blonde qu’il convoite depuis le début, au moyen d’un roulage de pelle torride et interdit par les autorités qui se passe justement à travers les barreaux en fer rouillé de la geôle. En vente en DVD dans l’espace culturel de votre centre Leclerc
Mes 17 ans (1996) : L’art de boire du Coca-Cola en pleine salle (0/6)
Le film de Philippe Faucon est commencé depuis à peine 5 minutes quand une personne âgée de 70 ans commence à grogner à mon encontre d’imprescriptibles « hum humm ». Motif de l’agacement : je bois du coca-cola en pleine de salle de cinéma et, pire encore, je bois directement au goulot, à la sauvage, provocant une poussée extraordinaire de 8,5 décibels. Mais que fait la police? C’en est trop pour cette septuagénaire visiblement altermondialiste et surtout méga-relou qui ne supporte absolument rien, et surtout pas qu’on se désaltère en faisant tourner l’économie du pays de l’oncle Sam.
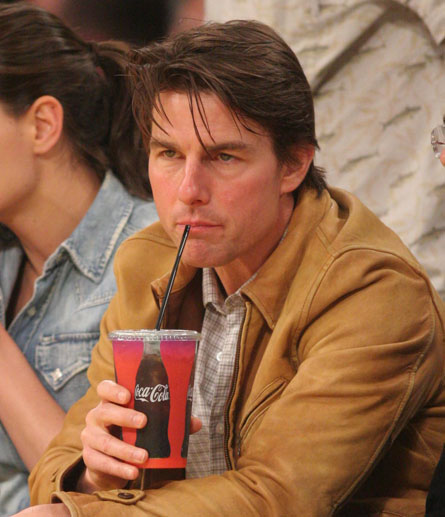
Le genre de personne qui ne supporte pas quand on éternue, qu’on tousse et qui tire la gueule quand on va aux chiottes en pleine salle parce qu’on a une envie pressante. C’est tout juste si on a le droit de respirer, si bien que je n’ai pas pu me concentrer durant toute la durée du film, tiraillé entre l’envie de lui jeter ma bouteille de coca-cola en pleine tête et celle de la calmer en citant notre grand poète moderne Vianney : « Si je vous gêne, ben c’est la même. ». Dans ces conditions, je n’ai absolument rien pigé au film, à part peut-être qu’une jeune meuf a chopé le VIH parce qu’elle a eu la bonne idée de se faire dépuceler par un séropositif toxicomane. (Rien d’autre à signaler)
The House That Jack Built (2018) : L’art de tuer (5,5/6)
Encore un film de Lars Von Trier qui va faire jaser dans les chaumières. Dans les années 70 aux USA, on suit l’épopée solitaire de Jack, architecte raté qui voue un culte sans borne à Jean-Sébastien Bach et accessoirement à son génial interprète Glen Gould. Terriblement frustré de n’être pas devenu lui-même un génie en architecture, ce psychopathe amateur de l’art pour l’art va se consoler dans une autre discipline : le meurtre. Tel le héros malsain de La Corde d’Alfred Hitchcock, Jack envisage le crime comme une véritable œuvre d’art et orchestre chacun de ses meurtres avec le plus grand soin. Maniaque maladif de la propreté, il ne laisse jamais traîner une goutte de sang et nimbe chacun de ses crimes d’une véritable dimension artistique :
- deux femmes mortes placées côte à côte sur un canapé et photographiées au Polaroid avec une mise en scène sordide faisant croire à une soirée pyjama entre amies.
- sa copine dont il découpe les seins après en avoir rigoureusement tracé le contour à l’aide d’un feutre rouge velleda, exaspéré par les femmes qu’il considère comme des « êtres stupides ».
- comble de l’immoralité, il tue sa famille toute entière au cours d’un massacre surréaliste organisé telle une battue familiale. Après avoir dégommé pas mal d’animaux, il achève ses 2 enfants avec un fusil d’assaut sous les yeux d’une mère évidemment en larmes qu’il tue juste après en comptant jusqu’à 12 après lui avoir gentiment demandé de choisir un chiffre. Rien n’est laissé au hasard, pas plus que l’oeuvre d’art grandeur nature qu’il cadre en utilisant la vingtaine de cadavres, formant un véritable tableau, avec en toute logique les 3 membres de sa famille à l’intérieur.
 Junkie du meurtre, Jack exulte après chaque crime sur fond de punk-funk malsain à la Talking Heads avant de replonger peu après, double phase jouissance/sevrage justement illustrée ici par la métaphore du lampadaire lumière/ombre qui l’oblige à repasser à l’acte inlassablement, enfilant les meurtres sanguinaires et esthétiques comme des perles, jusqu’à l’œuvre d’art finale de notre artiste de la mort, à savoir une splendide maison de vacances construite avec la cinquantaine de corps accumulés depuis des mois dans une chambre froide, métaphore de la maison de campagne que notre architecte raté n’a jamais terminée, le tout après avoir enfin accompli son rêve ultime de psychopathe : tuer 4 personnes en ne tirant qu’une seule balle. Si William Burroughs visait la pomme en voulant imiter Guillaume Tell dans un délire surréaliste, Jack visait vraiment les têtes.
Junkie du meurtre, Jack exulte après chaque crime sur fond de punk-funk malsain à la Talking Heads avant de replonger peu après, double phase jouissance/sevrage justement illustrée ici par la métaphore du lampadaire lumière/ombre qui l’oblige à repasser à l’acte inlassablement, enfilant les meurtres sanguinaires et esthétiques comme des perles, jusqu’à l’œuvre d’art finale de notre artiste de la mort, à savoir une splendide maison de vacances construite avec la cinquantaine de corps accumulés depuis des mois dans une chambre froide, métaphore de la maison de campagne que notre architecte raté n’a jamais terminée, le tout après avoir enfin accompli son rêve ultime de psychopathe : tuer 4 personnes en ne tirant qu’une seule balle. Si William Burroughs visait la pomme en voulant imiter Guillaume Tell dans un délire surréaliste, Jack visait vraiment les têtes.
Soulagé d’avoir enfin terminé sa maison (cf le titre du film), notre anti-héros assoiffé de sang n’a plus qu’une envie : en finir avec lui-même. Il se présente aux portes du paradis, qu’il peut atteindre seulement après avoir contourné l’immense trou noir des enfers. Une scène finale d’une beauté formelle à couper le souffle où Von Trier décide de la conclusion idéologique de son histoire. Grand provocateur devant l’éternel qui nous offre une fois encore de splendides références aux camps de concentration nazis, ce grand torturé de Lars va-t-il oser faire rentrer un être aussi mauvais au Paradis ? La morale finale de cette ode à l’ultra-violence et à la libération totale des pulsions les plus destructrices, que je me garderais bien de vous dévoiler.. Un grand film sur la mort, un poil en dessous du chef-d’œuvre sur la dépression Melancholia. En salles le 18 octobre dans les salles les plus obscures de France
Le départ (1967) : L’art de ne jamais partir. (3/6)
Une soirée placée sous le signe de la Pologne avec pour se mettre gentiment l’eau à la bouche un concert de kraut-jazz acoustique qui reprend librement toute une série de thèmes composés par l’auteur de musique de films polonais Krzysztof Komeda, au CV long comme le bras avec pas moins de 40 BO en 11 ans dont 9 signées pour son compatriote Roman Polanski incluant celle du cultissime et anxiogène Rosemarys baby, des partitions free-jazz du genre exaltées directement inspirées du Be-bop américain des années 40-50 et écrites par un énième furieux de vivre des fifties-sixties qui a donné toute sa sève artistique en une décennie avant de mourir en 68 complètement cramé sur les hauteurs du Los Angeles hippie après une soirée trop arrosée: « Le mec est mort en tombant d’une falaise, complètement bourré. Il s’est réveillé et a dit « tout va bien », en fait ça allait pas du tout il est mort 3 jours plus tard », raconte le pianiste du groupe jouant devant moi qui fait donc aussi office de biographe et offre une intéressante fusion entre free jazz et krautrock, un musicien de jazz pur jus qui avoue « adorer le rock’n’roll ».

Komeda, Polanski, et donc Jerzy Skolimowski, jeune metteur en scène polonais qui débarque en 66 en Europe de l’Ouest, attiré comme une abeille par la ruche du Swinging London et de la Nouvelle Vague qui fait exploser tous les codes artistiques et sociétaux. Pour son premier essai de cinéma libre, il ne se prend pas la tête et pique 2 acteurs fétiches de Godard, Jean-Pierre Léaud et Catherine Duport qui viennent tout juste de briller dans Masculin/Féminin, bijou et film pionnier de la new-wave frenchie. Malheureusement ce casting « Nouvelle Vague » 5 étoiles ne suffit pas et la mayonnaise du polonais ne prend jamais vraiment dans ce film totalement improvisé selon la méthode de « non-scénario » du cinéma direct d’avant-garde. Pourtant tout est là.. Les pitreries géniales ou ridicules d’un Jean-Pierre Léaud en roue libre totale, la BO free-jazz survoltée et un scénario de 3 lignes qui part rapidement dans le grand n’importe quoi: un jeune inconnu passionné de vitesse mais sans argent tente de trouver par tous les moyens possibles 15000 euros et une Porsche pour s’inscrire à une course automobile.

De là à s’embarquer dans une suite de gags totalement surréalistes il n’y a qu’un pas, que JP Léaud franchit allégrement, en ratissant la ville entière et en essayant tout un tas de jobs pourris dans lesquels il n’est évidemment pas du tout crédible : coiffeur, voiturier.. C’est drôle et la fin encore plus puisqu’après avoir finalement réussi à s’inscrire il ne se réveille pas le jour du départ (ahaha) mais Skolimowski ne maîtrise pas encore tout à fait l’art du cinéma réel et cette suite d’improvisations ne fonctionne pas ici à la perfection, au point de lasser le spectateur. La productrice du film qui assurait en début de séance que le DCP du film était resté caché sous son lit des années durant tel un trésor aurait mieux fait de le laisser dans la poussière. Tout le contraire de « Deep End » chef-d’œuvre pop sur le Swinging London réalisé par le même Skolimowski 3 ans plus tard et ressorti de l’ombre récemment. Nouveau départ dans les salles le 24 octobre
Jeux d’été (1951) – L’art de la déprime post-adolescente (5/6)
C’est l’histoire d’une héroïne déprimée, étoile filante de la danse qui regarde déjà sa jeunesse en arrière à 28 ans. Alors forcément, elle part dans une fuite en avant en courant tous les mecs qu’elle rencontre, prenant bien soin de rejeter les anciens amants et allant même se faire draguer par son oncle, vieux loup de campagne goguenard qui fait des avances à sa nièce tellement son mariage raté le déprime, tout comme l’âge qui le rattrape lui aussi.. Alors il boit, finissant torché sur le vieux piano où il déplia dans un temps reculé de si belles mélodies.
Plutôt que de répéter « Le Lac des Cygnes » dans lequel elle doit tenir comme toujours le premier rôle, elle préfère s’isoler au bord d’un véritable lac où elle flirte avec un fils de classe populaire, comme pour retrouver l’innocence des premières séductions adolescentes. Un noir et blanc au ton désabusé typiquement scandinave, entrecoupé de très belles scènes de danse qui viennent apporter de la poésie dans un récit glacial: « Si il y a un dieu je le hais, je le pourchasserai jusqu’à ma mort. ». La vie n’a pas de sens mais il faut la vivre quand même, et cela même si la jeunesse et la célébrité sont en train de quitter irrémédiablement notre sublime Marie, ancienne reine du bal et séductrice impétueuse jouée par une Maj-Britt Nilsson au top, tranchante et ultra performante en star déchue façon Marylin Monroe.
 Ingmar Bergman signe ici un très beau film sur le temps qui passe et (surtout) la jeunesse qui s’envole, un réalisme noir qui ornera une bonne partie de son œuvre en bicolore, avec ici une photographie et des paysages splendides captés dans le grand nord de notre vieille Europe. Renaissance dans les salles « art et essai » ce 26 septembre en version restaurée.
Ingmar Bergman signe ici un très beau film sur le temps qui passe et (surtout) la jeunesse qui s’envole, un réalisme noir qui ornera une bonne partie de son œuvre en bicolore, avec ici une photographie et des paysages splendides captés dans le grand nord de notre vieille Europe. Renaissance dans les salles « art et essai » ce 26 septembre en version restaurée.
Shadows In Paradise (1986) – L’art de l’a(rt)bsurde (5,5/6)
Je me suis gardé le meilleur pour la fin avec Shadows in Paradise de l’absurde finnois Aki Kaurismaki, un sketch cinématographique de 1h15 qui se révèle assez jouissif, où le côté cruellement banale de l’existence est tiré jusqu’à l’absurde. La vie est assez chiante, Aki l’a très vite compris et pousse le bouchon de l’ennui intersidéral jusqu’au bout, via une science du dialogue sans fioritures assez légendaire:
« -Tu t’ennuies ?
-Oui, mais ça va c’est pas si mal ce soir »
ou encore :
«-Tu viens ?
-Je vais me changer.
-D’accord ».
C’est bien simple, il ne se passe absolument rien durant 1h15, à part quelques choses incroyables comme :
- des gens qui fument des cigarettes
- des gens qui écoutent du rock à la radio
- des gens qui boivent des cafés
- des gens qui vont au travail
Ajoutez à cela Nikander, un personnage principal anti-héros total, éboueur, moche et pas très loquace, et vous obtenez un film qui fera sans nul doute rêver les gosses en mal de modèle à suivre. Aki lui a d’ailleurs construit une vie bien trépidante, son seul loisir étant d’aller dans un local assez bizarre pour apprendre les langues en discutant avec un ordinateur, un secret finlandais très bien gardé.. Pour couronner le tout il se met en couple avec une caissière de supermarché, un duo ouvrier ultra-ordinaire en fin de compte hyper attachant, à la vie tout aussi respectable que celle d’un trader ou d’une rock-star, et c’est ce qui fait la beauté de ce film qui choisit de raconter la vraie vie plutôt que de vendre des rêves en carton à des pauvres gens qui ne les vivront jamais. Une exploration honnête et tendre du monde ouvrier qui traverse une bonne partie de son œuvre, avec notamment « Crime et Châtiment », « Calamari Union » ou « Ariel », des histoires de pauvreté qui riment presque toujours avec rock’n’roll.

Le plus drôle est que face à ce spectacle d’une extrême banalité (l’existence, NDR) on ne s’ennuie pas une seule seconde. Mieux : on jubile. L’auto-dérision en forme de remède face à l’absurde inutilité de la vie. Tout est clair, simple, sans aucune surprise.. Même à l’hôpital, alors que Nikander est à moitié mort parce qu’il vient de se faire péter la gueule, il s’en tape. Kaurismaki s’en tape visiblement d’à peu près tout. Mais attention il ne se fait pas chier pour autant. Il aime se faire chier.
Le sens du rythme est génial, si bien qu’on reste jusqu’à la dernière seconde du générique de fin, sans se forcer. Je dis « on » parce que j’ai maté ce film à côté d’une grand-mère pour le coup très marrante, qui résume parfaitement les obsessions d’Aki : « y’a toujours 4 trucs dans ses films : le rock, les auto-radios.. et puis le reste j’ai oublié ahaha ». Le voyage en absurdie continue même après le film, avec ensuite un micro-dialogue d’anthologie devant l’ascenseur :
- La grand-mère : « vous prenez l’ascenseur ?
- Moi : Oui, pourquoi ?
- LGM : Je pensais que vous cherchiez les toilettes »
//Dispo en DVD dans toutes les bonnes boutiques de cinéma
Voilà c’est fini, je ressors à la fois sonné et content, avec cette sensation si agréable d’avoir tout compris à l’existence mais de m’en foutre. Pour continuer à vous en foutre en matant des films, c’est par ici.









