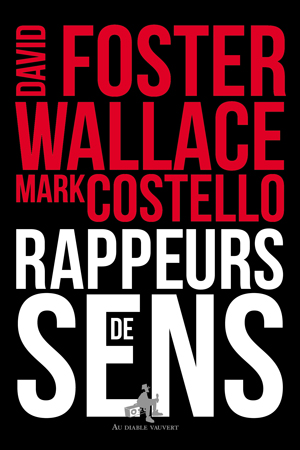 Quand même un mot sur cette préface, écrite en 2013 et que vous pouvez sans problème lire in situ dans la librairie (lire dans une librairie, Wow !), soit une petite trentaine de pages qui valident absolument la réussite de ces cursus de creative writing dont l’Amérique a le secret. Bien pesé, bien envoyé et, surtout, totalement attendrissant. Sur le fond biographique, il faut renvoyer à « Every love story is a ghost story » (D.T Max, éditions de l’Olivier, 2016) qui raconte par le menu la vie de celui qui oscillait entre la volonté d’impressionner et le dégoût que de tels réflexes provoquaient en lui et qui a fini par mettre fin à ses jours en attachant un tuyau d’arrosage au pot d’échappement de sa voiture avec son bandana.
Quand même un mot sur cette préface, écrite en 2013 et que vous pouvez sans problème lire in situ dans la librairie (lire dans une librairie, Wow !), soit une petite trentaine de pages qui valident absolument la réussite de ces cursus de creative writing dont l’Amérique a le secret. Bien pesé, bien envoyé et, surtout, totalement attendrissant. Sur le fond biographique, il faut renvoyer à « Every love story is a ghost story » (D.T Max, éditions de l’Olivier, 2016) qui raconte par le menu la vie de celui qui oscillait entre la volonté d’impressionner et le dégoût que de tels réflexes provoquaient en lui et qui a fini par mettre fin à ses jours en attachant un tuyau d’arrosage au pot d’échappement de sa voiture avec son bandana.
Mais, pour ce qui relève de cette soudaine obsession pour le hip hop, moyen comme un autre de régurgiter cette soi-disant culture populaire dont David Foster Wallace se gorgeait, il faut prendre le livre comme un témoignage encore imbibé par cette écriture post-moderne qui pense pouvoir sérieusement faire acte de subversion en critiquant et en parodiant des shows télé (ce dont les auteurs ne se privent pas); dernier rempart derrière lequel se cache le message satanique du capitalisme. Heureusement Wallace a retenu d’autres choses de ce début des années 90 où flotte encore la présence fantomatique de Jacques Derrida, et notamment cet art de la note de bas de page auquel il finira par donner de nouvelles lettres de noblesse.
Pour le reste, et l’échange avec Costello tend à le confirmer, il est assez étrange de constater à quel point l’Amérique des années 90 ressemble à celle d’aujourd’hui. Comme Reagan hier, Donald Trump apparaît comme une espèce de double maléfique qui punit et en même temps valide cette philosophie du matérialisme extraverti ( owning and flauting, dit Mark) qui plaît tant aux rappeurs. Dans ce qui pourrait ressembler à un manuel d’économie politique pour rire, les deux auteurs consacrent ainsi de longues pages à discuter si oui ou non cette rusticité du rap incarne l’ultime posture subversive encore viable dans un monde condamné à subir le pire de l’industrie du divertissement ou si, à l’inverse, il ne fait qu’en surcoder la déroute, Costello prenant soin de nous rappeler que Kanye West n’a pas vu de contradiction entre son soutien à Trump et à Black lives matter et que le fils de Martin Luther King – lui non plus – n’a pas vu où était le problème lorsque certains se sont émus d’apprendre qu’il se faisait payer pour faire des selfies avec Trump.
Ce qu’a bien vu Wallace, en revanche, et que son vieux pote n’avait pas forcément bien discerné, c’est l’aspect « société secrète » du hip hop qui d’une certaine façon reprend les codes de l’establishment, de certaines grandes universités et des country clubs exclusivement réservés aux blancs. Imitation vs miroir dénonciateur, toujours la même dialectique, tradition/subversion que l’auteur n’hésite pas à trancher en faveur du second sous prétexte que le rap, c’est intéressant.
Grand fan de Schoolly D, il est terriblement abattu lorsqu’il comprend que cette musique ne prêche finalement qu’aux convertis (closed music ). Et de décrire cette scène lors d’un concert où il réalise qu’il ne pouvait même pas croiser les yeux des autres spectateurs, le regard de ces derniers les traversant sans les voir (« their gaze was fixed on what was behind us »). Costello rapporte que le petit David en a été tout retourné. Suit un passage assez marrant dans lequel Wallace raconte leur difficulté à obtenir des informations auprès des professionnels ou disquaires qui définitivement ne les prennent pas au sérieux, et leur choix in fine de se déguiser en intellos des années 60 – pull col roulé, cheveu sale et brillant, verres épais, veste avec coudière en cuir – pour attirer l’attention de quelques uns qui enfin ont répondu à leurs questions comme des adultes polis répondent à l’interrogation d’un enfant, en espérant qu’elles cessent un jour (on n’est pas loin de la position d’un Moby à la même époque lorsqu’il se gausse de fréquenter les dance floor du New York de la black-music).

Wallace, c’est finalement l’histoire d’un type qui démarre un essai sur le cinéma porno puis le laisse tomber pour travailler sur le hip hop et qui, pour ce faire, est obligé de s’habiller comme son propre père, en professeur de philosophie. On comprend qu’il ait choisi un peu plus tard d’appeler un de ces recueils Un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas.
Sur la musique elle-même, il se révèle souvent brillant, fin observateur du dispositif général qui annonce déjà la perversité pop contenue dans le rap. Ainsi, dans cette tension contrapunctique entre la célébration de la liberté dans l’espace par la musique et la rhétorique du confinement (le ghetto), le rap est le premier genre pop à intégrer et refléter un désespoir américain particulièrement moderne vis-à-vis duquel la musique populaire ne peut plus agir en tant que palliatif… Et cette remarque, parce que la signification n’a pas besoin d’être déterrée comme une truffe par des chercheurs avides de sens, le rap usurpe (naturellement) la fonction interprétative ordinairement dévolue aux critiques dits sérieux. Totalement engagé dans son sujet, l’écrivain finit par subir un peu du syndrome de Stockholm voyant par exemple d’un très mauvais œil la prétention de groupes blancs tels les Beastie Boys réclamant leur part du gâteau. Des propos qui, aujourd’hui, ne passeraient pas sans doute pas, parce que c’est plus compliqué, et qu’au delà du hip-hop, il semble que le début des années 90 soit surtout marqué par un bouillonnement créatif qui a trouvé un débouché naturel grâce à des technologies bon marché et la possibilité de sampler librement n’importe quel extrait musical.
https://www.youtube.com/watch?v=6VpZk9dGXGA
Au delà, et c’est un point sur lequel a fini par insister Mark Costello lorsque je le tannais avec mes histoires du capitalisme hip hop et de son bling bling trumpien, c’est le côté splitté de l’Amérique, cette façon d’être une nation en mille morceaux depuis toujours. « There is simply no one American reality. The country that elected Trump also elected Obama. It’s a collage not a picture, and the pieces move around to produce new pictures ».
Bref, c’est plus compliqué, mais n’est-ce pas un bon moyen de comprendre qu’une pure musique de genre, une musique aux accents racialistes comme le rap, ait pu devenir à la fois l’ADN de la pop et demeurer la musique des pauvres noirs et même des pauvres en général (comme a pu l’être à un certain moment… la folk music ?). Si l’on revient à Trump et au To make America great again, on peut voir le lien entre le hobo de base – le Jesse Pinkman de Breaking bad – et l’envie de croire au rêve américain où se retrouvent l’entrepreneur et le gangster, le petit délinquant et l’américain moyen. Dans son (pas si chouette) film American Honey (prix du jury du Festival de Cannes en 2016), la réalisatrice Andréa Arnold joue avec cette idée en filmant la ruée vers le Midwest d’une bande de jeunes blancs défoncés en charge de vendre des abonnements magazines aux victimes consentantes des bonnes vieilles techniques de vente en porte à porte. Et, en effet, non seulement ça marche mais on finit par se convaincre que ces braves gars sont bien les vrais Américains, ceux qui font le lien entre Bob Dylan et Kanye West. Pas sûr que cet ultime coup de théâtre eut provoqué une quelconque érection chez notre écrivain inconsolable.








