Il y a 30 ans, Talk Talk sortait Laughing Stock, un album d’une intensité rare et qui passa relativement inaperçu lors de sa sortie. Le réalisateur Gwenaël Breës propose aujourd’hui une série de sept articles reconstituant le parcours mutant de Talk Talk. Ce cinquième épisode revient sur « l’évaporation » du groupe, un terme utilisé par Mark Hollis en 1998 pour qualifier la séparation de Talk Talk en 1991, mais jamais officialisée jusque-là. C’est dans cette latence que vont naître plusieurs “albums-thérapie”, selon l’expression de l’ingénieur du son Phill Brown.
➔ Publié à l’occasion de la diffusion du film In a Silent Way à Musical Ecran (le 7 septembre à Bordeaux) et au FIFIGROT (les 22 et 26 septembre à Toulouse), ce cinquième article de notre série esquisse une généalogie musicale de l’après-Talk Talk. Les 4 premiers épisodes sont à (re)lire ci-dessous.
➔ L’intro du feuilleton : Talk Talk revisited
➔ Épisode 1 : Mark Hollis, en réaction (1955-1982)
➔ Épisode 2 : Changements de personnalités (1983-1986)
➔ Épisode 3 : L’enfer de “Spirit of Eden” (1987-1988)
➔ Épisode 4 : “Laughing Stock”, drôles d’oiseaux (1989-1991)
Il n’existe pas de récit de la séparation de Talk Talk qui soit communément partagé par ses anciens membres. Dans les faits, ce nom associé à cinq albums parus entre 1982 et 1991 n’a été abandonné qu’en 1998 lorsque Mark Hollis décida de publier sous son nom le dernier disque qui le liait contractuellement avec une firme de disques. Mais humainement, l’évaporation du groupe s’est produite bien avant, un peu comme une étape obligée d’une trajectoire qui avait commencé par un âge sombre et incertain avant une mise en orbite tumultueuse puis une recombinaison des éléments qui avait donné naissance à des objets sonores de plus en plus lumineux, ne laissant manifestement d’autre choix à ses composantes que de se distendre à jamais. “Il n’y a jamais eu de décision d’arrêter”, dit le batteur Lee Harris. À lire entre les lignes les rares explications et silences exprimés par les quelques protagonistes qui ont cheminé ensemble durant cette décennie, on devine que les sessions intenses de Spirit of Eden et Laughing Stock les ont poussés dans des limites psychiques, relationnelles et créatives que rien n’a permis de surmonter, d’autant moins que le groupe n’avait plus aucune existence en dehors des moments de studio et que les procès avec EMI avaient quelque peu refroidi leurs ardeurs.
Si Hollis semble avoir dépassé sans trop de séquelles les mois d’intensité qu’il a largement contribué à mettre en place pour l’enregistrement de ces albums, il n’en va pas de même pour ses principaux partenaires. “Il y a eu un divorce, des dépressions. Je suis horrifié par le chaos et le carnage autour de ces albums”, témoigne l’ingénieur du son Phill Brown, pourtant très fier de cette expérience d’un point de vue créatif.
Le divorce auquel Brown fait allusion, c’est celui qu’a vécu le producteur Tim Friese-Greene, manifestement lié à son implication dans le processus très exigeant de Laughing Stock. L’intéressé dit pourtant avoir été relativement épargné par la “surcharge psychologique massive” qui a atteint le bassiste Paul Webb après Spirit of Eden, puis Lee Harris et Phill Brown au terme de Laughing Stock. Néanmoins, Friese-Greene s’étonne encore, des années plus tard, qu’EMI et Polydor aient successivement laissé Talk Talk aussi longtemps dans l’obscurité du Wessex Studio sans se soucier ni des conséquences psychiques pour les musiciens ni des coûts financiers qui en découlaient. L’éternel “membre officieux” de Talk Talk, mais maillon essentiel de ses principaux albums, est connu pour avoir un caractère bien trempé. Il explique avoir quitté Talk Talk “avant d’avoir de sérieuses raisons d’en vouloir à Mark ou Keith”, le manager. Artistiquement, c’est au milieu des sessions de Laughing Stock qu’il dit avoir compris que le voyage était arrivé à son terme, au moment où Hollis enregistrait un solo d’une seule note sur un variophone défaillant : “Après une note, il n’y a plus de note. Je ne voyais pas comment aller plus loin, or j’avais envie d’aller plus loin. Mark n’était pas content de cela, mais il n’avait pas le choix”. Pour sa part, Hollis dira que la collaboration avec celui qui a été son proche producteur et co-compositeur pendant huit ans s’acheva en raison d’une crainte partagée de se répéter artistiquement. Mais leur relation s’est vraisemblablement soldée par un dissensus suffisamment profond pour qu’ils arrêtent durablement de se parler.
“Vous connaissez ce tableau de Van Gogh, avec les corbeaux dans un champ de blé ?”, poursuit Friese-Greene. “Le chemin sur lequel tu es se divise en trois, mais ils s’achèvent tous au milieu de nulle part. C’est une œuvre hautement psychotique et je l’ai toujours aimée. ‘Laughing Stock’ m’y fait penser. On a suivi les chemins et on a compris qu’on ne pouvait pas aller plus loin.”

Du milieu de nulle part, les quatre anciens collaborateurs d’Hollis, marqués à vie par l’expérience de Talk Talk, vont chacun connaître des passages à vide et des errances qui vont les amener à former une constellation d’albums et d’expériences artistiques diverses, de la lo-fi au dub tribal, du blues au rock, sans jamais capitaliser commercialement sur leur succès passé, ni se répéter, en maturant le plus souvent leurs œuvres loin de Londres, dans des studios qu’ils montent eux-mêmes, et en préférant toujours des processus de production indépendants à la tutelle des majors. Mais au début de la route il leur faut d’abord atteindre un passage incontournable, celui qui leur permettra de se réajuster, de lâcher prise, d’ouvrir d’autres imaginaires, de retrouver un désir de musique.
Retour au monde réel
Après Laughing Stock, Tim Friese-Greene ressent directement la nécessité de tourner la page de ses huit années de connivence artistique avec Hollis. Cela lui demande un sérieux repositionnement. Il lui faut d’abord “retourner dans le monde réel”, résume-t-il, ce qu’il va faire en poursuivant dans un premier temps ses activités de producteur. En 1992 et 1993, il produit les albums de deux groupes de rock indépendant, Ferment de Catherine Wheel puis Broooch de Sidi Bou Said. En 1995, le voilà dans un tout autre registre aux côtés de Nick Cave avec qui il compose et enregistre la chanson There is a Light pour la bande originale du film Batman Forever.
En parallèle, Friese-Greene s’est installé en solitaire dans une petite cabane sur une île dans l’Essex, au nord-est de Londres, cherchant à se ressourcer en enregistrant ses idées musicales à l’aide d’un petit quatre pistes. Décidé à se consacrer désormais à sa propre musique, il investit ensuite une ancienne usine dans le Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre, où il construit son propre studio. Il y enregistre un premier album… qu’il jette aussitôt à la poubelle, le jugeant “trop dérivé” de son travail avec Talk Talk. Car outre un désir d’altérité avec le rock et la pop conventionnelle, l’une de ses ambitions est “d’éviter de ressembler au groupe” avec lequel il vient de passer huit ans. En 1997, il finit par trouver un point de mise en orbite satisfaisant avec quatre morceaux qu’il sort sous forme d’un EP intitulé Creosote & Tar, du nom d’une famille de goudrons utilisés comme pesticide pour la conservation du bois. À partir de là, il va autoproduire quelques disques, parfois sous son nom et parfois sous celui d’Heligoland, signifiant “terre sacrée” en Allemand ancien et désignant aussi une petite île de la mer du Nord. Particulièrement éclectique comme le fut sa carrière de producteur, sa production personnelle (notamment Heligoland en 2000 et Pitcher, Flask & Foxy Moxie en 2006) va se charpenter autour d’une lo-fi évolutive où il joue la plupart des instruments, s’intéressant parfois à l’un d’eux en particulier, chantant lui-même de sa voix rocailleuse, et dessinant un univers lyrique et iconographique basé sur la simplicité, le bricolage et le collage, convoquant notamment des éléments cinématographiques, naturalistes, industriels, chimiques, historiques ou encore architecturaux…
« Si rien ne semble se passer, tout s’arrangera avec le temps »
Pendant ce temps, secoués par l’intensité des sessions de Laughing Stock, Lee Harris et Phill Brown avaient chacun démarré une thérapie. Après le dernier jour passé en studio avec Talk Talk, l’ingénieur du son n’était pas allé bien loin : il n’avait eu qu’à traverser la rue pour rejoindre l’appartement qu’il occupait pour l’occasion en face du Wessex Studio. Se sentant incapable de recommencer à travailler sur un autre album, et même de retourner vivre avec sa famille dans la campagne du Sussex, il y passera plusieurs mois à décompresser. “Ma famille, c’était devenu Talk Talk”, explique-t-il. Mais soudain, mardi 30 avril 1991, chacun était reparti de son côté sans même aller boire un verre pour célébrer la fin du disque qui avait pris sept mois à se faire. La famille allait se décomposer dans le silence, sans plus se donner de nouvelles une fois les instruments et les éléments d’éclairage remballés par Tim, Mark et Lee.
“Et puis un jour, j’errais près de New Hampton Church et je suis tombé sur Lee”, reprend Brown. “Il ressemblait à un clochard avec ses mocassins. Je l’ai invité à boire un verre chez moi.” Nous sommes en novembre, presque sept mois se sont écoulés depuis la fin de Laughing Stock. Les deux hommes discutent pendant des heures et se rendent compte qu’ils partagent un mal-être similaire depuis la fin de l’album. “On s’est dit que ça pourrait être amusant de faire un disque ensemble. On ressentait le même besoin de faire quelque chose de joyeux, de frais et différent.” Dans les jours suivants, ils se réunissent avec Paul Webb, avec qui Harris a récemment recommencé à enregistrer de la musique sur un petit DAT, sous le nom d’Hypersanity. Depuis son départ de Talk Talk après Spirit of Eden, Webb n’avait pas réussi à rejouer de la basse et il semble passer une partie de son temps à sortir en club.

Harris, Brown et Webb veulent montrer qu’il est possible de réaliser un bon disque pour un petit budget, rapidement et en s’amusant. “Talk Talk c’était sérieux, mais Lee, Paul et moi, on est des hippies beaucoup plus frivoles que Mark ou Tim”, poursuit l’ingénieur du son. Ils trouvent rapidement un local dans un ancien bâtiment industriel de Tottenham (Londres). Ils mettent leur matériel et leurs économies en commun pour le louer et y installer leur propre studio. “On a tout repeint, pour que ce soit lumineux”, se souvient Brown avec un brin de nostalgie. Six mois après la rencontre fortuite entre Phill et Lee, le lieu est aménagé. Comme un sanctuaire primitif. “Comme si on était isolés sur une île déserte, sans règles” dit Webb . Décidé à prendre son temps, et du bon temps, Harris baptise le studio The Slug – en français : La Limace. Brown a installé des micros partout. Harris a rempli les murs de collages influencés par l’art mésoaméricain, et affiché dans la salle de contrôle une phrase extraite du manuel d’une console Yamaha DMR 8 disant : « Si rien ne semble se passer, tout s’arrangera avec le temps ». Il y a aussi le stroboscope, le projecteur à huile et les lampes disco qui avaient servi au Wessex Studio pour Spirit of Eden et Laughing Stock, un sofa, des chaises, un écran de télé avec un lecteur vidéo, un frigo, une petite cuisine.
“Roulons un pétard, trouvons un rythme et envoyons-le dans le système de sonorisation, branchons quelques micros, enregistrons et faisons la fête”, lance Harris. Webb et lui ont ramené des tas d’instruments exotiques achetés notamment au gré des tournées dans les années 1980, qu’ils se mettent à utiliser sans vraiment savoir en jouer. « On est comme des enfants avec de nouveaux jouets », s’amuse Webb. C’est dans ce foisonnement et cette spontanéité que le bassiste redécouvre la possibilité de jouer dans une atmosphère détendue, et que la section rythmique de Talk Talk se recompose sans l’influence créative et exigeante d’Hollis, ni sa voix en ligne de mire. Keith Aspden, le manager de Talk Talk, accepte de s’occuper des affaires de ce nouveau groupe de “hippies frivoles” qu’il a, dans un premier temps, du mal à prendre au sérieux.

Les trois compagnons décident de laisser de côté les morceaux d’Hypersanity. Dès juin 1992, des musiciens sont invités à les rejoindre au Slug. Certains rencontrés grâce à Talk Talk, tels l’harmoniciste Mark Feltham, le percussionniste Martin Ditcham, le pianiste Phil Ramacon et le bassiste Simon Edwards, se mélangent à d’autres amis comme Matt Johnson (The The), Graham Sutton (Bark Psychosis), ou encore Beth Gibbons (qui vient de former Portishead) et Colette Meury (originaire de Southend-on-Sea comme Lee et Paul), lesquelles vont marquer l’ensemble de leurs chants possédés. Ensemble, elles et ils enregistrent de longues jams égrainées sur des semaines, pendant lesquelles chacun passe librement d’un instrument à l’autre dans une forme de lâcher prise collectif où le port de masques est encouragé afin d’atténuer le poids de l’identité et de l’ego… « Les musiciens expérimentés se sentent sous pression pour faire quelque chose, mais après 20 minutes, ils entrent dans l’ambiance et se libèrent de l’obligation d’impressionner”, se réjouit Harris.
Les deux hommes ont manifestement beaucoup appris de leur expérience avec Hollis et Friese-Greene. Ils reproduisent même la technique du synthé dont le son est repassé par un ampli, et le font avec le Jupiter 8 utilisé sur It’s My Life et que Webb a gardé. Mais cette fois, ils sont aux commandes, ils ont changé les règles et tentent que l’aspect ludique et instinctif prenne le dessus sur le perfectionnisme et le purisme. Au Slug, les bandes tournent en permanence, mais les musiciens sont le plus souvent enregistrés en même temps et aucune répétition ne précède les sessions. “Avec Talk Talk, les morceaux ont été plus ou moins conçus en dehors du studio, et même si c’était quelque chose de très libre, il y avait un début et un commencement à chaque morceau. Tout était planifié lors des répétitions, mais on a supprimé cela avec O.Rang”, détaille Webb.

Le groupe hésite d’abord entre les noms de Shwaa et de Moratorium, auquel Lee va finalement préférer celui d’O.Rang en référence aux orangs-outans. Comme s’il s’agissait de prendre à rebrousse-poil le cheminement de l’évolution humaine. “Nous ne sommes pas séparés de la nature mais intrinsèquement liés”, dit le batteur en ajoutant : “En Asie, il n’y a pas de distinction entre les singes et les hommes.” Leur premier album, publié en 1994, s’intitule Herd of Instinct (“le troupeau de l’instinct”). Un EP intitulé Spoor paraît dans la foulée. On pourrait qualifier leur musique de sculptures sonores, très physiques, mélangeant dub psychédélique et influences tribales inspirées par les rites vaudous, où toute préoccupation mélodique est secondaire. On y ressent tant l’influence renouvelée de CAN, que celle du label On-U Sound et particulièrement d’African Head Charge. « Talk Talk a toujours été très occidentalisé, or nous on écoutait d’autres types de musique du monde”, précise Webb pour expliquer cette évolution, rappelant qu’Harris et lui sont des amis d’école qui ont démarré leur carrière dans un groupe de reggae avant de rejoindre Talk Talk, lui-même ayant à l’époque Lee Scratch Perry pour “héros musical ultime”.
Au cours des enregistrements, Lee et Paul ont aiguisé leur intérêt pour l’aspect visuel. “On avait adopté une attitude libre, ‘tout essayer’ à l’égard de la musique, et il nous a donc semblé naturel d’appliquer la même méthode à l’aspect visuel de notre travail”, explique Webb. Pour concrétiser ce désir, ils rencontrent le graphiste illustrateur touche-à-tout Martin “Cally” Callomon, qui va d’ailleurs participer aux sessions d’enregistrement en projetant des diapositives sur les murs pour inviter les participants à y réagir musicalement. À trois, ils vont concevoir un livret pour accompagner l’album, composé de 24 pages de peintures à l’huile, de collages et autres photos de sculptures ou de masques créés par leurs soins ou par les nombreux musiciens invités.

Mais le processus de production, censé être spontané et rapide, s’avère être lent et chronophage. Lors du montage de la matière musicale, Harris est devenu “totalement obsessionnel”, selon Brown : le batteur découvre la technologie numérique et endosse le rôle de producteur qu’il était censé partager avec Brown, restant scotché des journées entières devant ProTools à composer des boucles et à vouloir maîtriser la moindre milliseconde de son. “Lee est devenu un second Mark Hollis. Comme s’il avait quelque chose de personnel à lui prouver”, dit Brown, effrayé par les réminiscences avec l’expérience de Talk Talk. Ce changement d’attitude va se traduire en 1996 par Fields and Waves, le second album d’O.Rang, où Brown ne sera plus de la partie. Davantage contrôlé et technique, spirituel et électronique, largement composé cette fois, faisant appel à beaucoup moins de contributeurs, cet album semble consacrer O.Rang comme le projet de Lee Harris.
Le batteur a pris les commandes jusque dans les moindres détails. Devenu principal administrateur du site web du groupe, il l’alimente avec des visuels traduisant, comme le titre de l’album, son intérêt pour la physique quantique, les champs de particules et les ondes électromagnétiques, la géologie, la topographie ou encore l’apparition des OGM. Sous le nom The Superculture Gaming Company, il invente et fabrique même de ses mains un jeu de dés appelé Go:Rang dont il dotera un tirage limité de l’album… Entretemps, les loyers s’étant envolés à Tottenham, The Slug a quitté Londres pour s’établir à la frontière de l’Essex, là où Paul et Lee se sont installés à 20 kilomètres l’un de l’autre, chacun avec sa famille naissante. “C’est bien de changer tout le temps” assène Webb, qui paraît moins investi sur Fields and Waves. En dépit des envies d’Harris, O.Rang ne se produira jamais en concert. Et malgré le succès d’estime des deux premiers albums, le troisième, dont Harris annoncera la sortie pendant des années, ne verra pas le jour.
« Se rappeler ce que c’est de s’amuser ! »
Brown, qui fuit désormais les processus trop contrôlés, poursuit sa “thérapie” ailleurs. Il a repris son travail d’ingénieur du son et enregistrera dans les années 1990 des artistes aussi variés que Dido, Tricky, Throwing Muses, Robert Plant ou Faithless. En 1997, entre deux sessions “professionnelles”, il décide de passer du temps avec les musiciens Simon Toulson-Clarke et Alastair Gavin, tous deux issus de Red Box, un groupe pour lequel Brown enregistra des démos entre 1982 et 1983 et dont il fut éjecté lorsque le groupe fut signé par Warner Brothers, suite à une divergence artistique avec le A&R du label. Red Box eut deux tubes pop en 1985 et en 1986, tandis que Brown avait du mal à digérer sa mise à l’écart.
Une décennie plus tard, son amitié avec certains musiciens du groupe reprend le dessus et voilà les trois compères s’installant dans une maison de Muswell Hill (Londres), sans aucun autre projet que de prendre du bon temps. Adepte des studios volants et des studios mobiles permettant d’enregistrer dans une maison ou dans un champ (ce qu’il fit notamment avec Robert Palmer ou Murray Head), Brown y installe un petit studio. Simon Toulson-Clarke est au chant et à la guitare. Alastair Gavin aux synthés. Brown installe des lecteurs VHS, CD et de cassettes, afin d’alimenter les improvisations des deux musiciens avec “des sons de tous les jours, des trucs du monde réel” qu’il a soit enregistrés sur son walkman, soit extraits de sa collection de CD et VHS. “On démarrait un rythme, puis j’introduisais des éléments aléatoires et puis le claviériste reprenait et jouait dessus.” Ces éléments sonores tournent notamment autour de l’humoriste américain Bill Hicks, contempteur du capitalisme et de la société de consommation, dont Brown était “complètement accro” à l’époque et qui est ainsi devenu la principale source d’inspiration du trio.
“Et on a fait un album”, s’étonne presque Brown. Intitulé SPA (pour “Simon-Phill-Alastair”), c’est un album léger, atmosphérique et joyeux, dédié à la mémoire du comédien américain, mort en 1994. “J’ai fait 300 disques ou quelque chose comme ça dans ma vie, mais faire un album dans lequel tu es impliqué et l’avoir dans un CD fini, c’est étrangement excitant. C’était beaucoup plus rapide à fabriquer que Talk Talk, et avec une attitude plus triviale. C’était pour se rappeler ce que c’est de s’amuser !”, rigole-t-il. “Talk Talk était génial mais il y avait une telle intensité à propos de tout. Alors Tim, Mark, Lee, Paul, tout le monde a eu ensuite besoin de quelque chose d’autre dans lequel mettre son énergie. C’étaient tous des albums-thérapie. Le mien, c’était ‘SPA’ !”

« Le temps passé à ne pas travailler
sur la musique est tout aussi important
que le temps que l’on y consacre ».
(Paul Webb aka Rustin Man)
Si Tim Friese-Greene a rompu les liens avec les anciens musiciens de Talk Talk, et si Mark Hollis a eu peu de contacts avec son ancienne section rythmique, Webb et Harris eux sont restés proches, géographiquement et humainement, même après O.Rang.
Réconcilié avec la musique, Webb est décidé à continuer à expérimenter et à apprendre sur le tas. Musicien autodidacte qui n’a eu l’occasion de composer qu’un seul morceau dans Talk Talk (Another Word sur le premier album), le voilà embarqué dans une période de six années consacrées à écrire, enregistrer puis tourner avec son amie Beth Gibbons, qui s’est mise en pause de Portishead pour l’occasion. Leur collaboration donnera Out of Season (2002), un album flirtant avec le sacré, porté par la voix profondément mélancolique de Gibbons qui évoque par moments celles de Nina Simone ou de Laurie Anderson. Webb, qui officie désormais sous le pseudonyme de Rustin Man, y délaisse son instrument habituel au profit des claviers, des percussions, de l’accordéon ou encore de la guitare. C’est Simon Edwards, qui a participé à Spirit of Eden et Laughing Stock, qui reprend la basse. Parmi la quarantaine de musiciens présents sur l’album, on retrouve aussi Lee Harris qui a ressorti les peaux de batterie utilisées sur Laughing Stock, Mark Feltham à l’harmonica, Neil MacColl de The Bible à la guitare, Adrian Utley de Portishead à différents instruments… et Phill Brown au mixage.
« Out of Season », qui connaît un joli succès public, est suivi d’une tournée mondiale en 2002-2003 avec un line-up de sept musiciens dont deux comparses de Portishead et trois de Talk Talk. Les anciens camarades de classe Webb et Harris n’étaient plus montés ensemble sur une scène depuis le dernier concert de Talk Talk en 1986. “Seize ans que je n’avais pas joué sur scène, j’ai eu l’impression que cela faisait seize jours !”, s’enthousiasme le batteur . Après cette tournée, Beth Gibbons va ensuite renouer avec Portishead, qui prendra plusieurs années avant de sortir un nouvel album. Harris, lui, va enchaîner avec une tournée du trio norvégien Midnight Choir. Quant à Webb, il va se faire discret pendant plusieurs années, s’essayant au rôle de producteur pour des albums du chanteur écossais James Yorkston (The Year Of The Leopard, 2006), du duo belge Dez Mona (Hilfe Kommt, 2009) et du groupe suédois The Tiny (Gravity & Grace, 2009).

En parallèle, Webb commence à fabriquer un studio dans l’ancienne grange entourée de ruches qui est devenu sa maison, qu’il décore et remplit d’instruments et d’objets afin d’y créer “une atmosphère d’un autre monde”, à l’instar des deux derniers Talk Talk et des albums d’O.Rang qui furent en quelque sorte enregistrés comme des performances. Loin de l’image de “Douggie” le clubber un peu flambeur qu’il était au début des années 1980, “l’homme-rustine” va y passer seize années à travailler sur deux albums avec six micros, de vieux préamplis, et la complicité occasionnelle de Brown à la technique et d’Harris à la batterie ou au sitar.
Sa philosophie semble désormais reposer sur la patience et la lenteur, et sa relation avec Brown n’y est pas étrangère : “Phill m’a dit un jour que l’une des choses qu’il aimait dans l’enregistrement et le mixage sur de vieux magnétophones était de devoir attendre que la bobine revienne au début de la piste ou de la section sur laquelle il travaillait. Il a dit que cet arrêt, le retard de début de son flux de travail dû au rembobinage de la bande, lui donnait un temps important pour réfléchir à ce qu’il faisait et à ce qu’il allait essayer ensuite. Ce concept m’est toujours resté en tête, car avec les merveilles des équipements d’enregistrement numérique modernes, l’époque du temps de réflexion imposé en studio est révolue. (…) J’ai découvert que lorsque l’on écrit de la musique, le temps passé à ne pas travailler dessus est tout aussi important que le temps que l’on y consacre. (…) Plus le processus est long, plus l’atmosphère des chansons est déplacée et sans racines culturelles, ce qui est exactement ce que j’aime dans la musique.”
Le résultat de cette lente maturation donnera corps à deux albums sortis à un an d’intervalle, Drift Code (2019) et Clockdust (2020). Webb y joue de nombreux instruments et y devient aussi chanteur. Lui qui s’était contenté jusque-là de faire les chœurs dans Talk Talk, assume à 57 ans une voix oscillant quelque part entre Robert Wyatt et David Bowie, au service d’une musique luxuriante, en apesanteur, inspirée d’artistes des années 1940 comme les Mills Brothers et Cab Calloway, et qui avec ses ambiances baroques très cinématographiques s’épanouirait pleinement sur la scène du Bang Bang Bar de Twin Peaks. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 mettra un coup d’arrêt au retour scénique de Rustin Man, prévu fin 2020 en compagnie des musiciens belges de Dez Mona.
Lee Harris et le “pétrole brut non fumeur”
Harris, de son côté, n’a pas reformé de projet musical durable après O.Rang. Mais il a continué à jouer de la batterie et des percussions, tantôt avec la chanteuse américaine Toni Childs (The Woman’s Boat, 1994), tantôt avec des groupes inspirés par la dernière période de Talk Talk tels Midnight Choir (Waiting for the Bricks to Fall, enregistré et mixé par Phill Brown en 2003), Boymerang (Balance of the Force, 2004) et Bark Psychosis (Codename: Dustsucker, 2004), ces deux derniers étant menés par son ami Graham Sutton, ancien complice d’O.Rang. En 2012, Harris a aussi participé à Evolver de Magnetik North, “une expérience visant à brouiller les distinctions entre le mécanique et l’organique” et menée avec le touche-à-tout Ian Tregoning (fondateur de Do-It Records et ancien collaborateur de Yello, Adam & The Ants, Fela Kuti) et Jaki Liebezeit, ancien batteur de CAN dont Harris a toujours énormément admiré le jeu et la créativité.
Depuis O.Rang et ses collages, photos et autres masques, il est aussi devenu manifeste qu’Harris recèle d’aspirations artistiques bien plus diverses que ses talents musicaux. On sait par exemple qu’en mai 2002, il a conçu dans le plus grand secret une installation à la Curfew Tower, construite en 1817 dans un village d’Irlande du Nord. Destinée originellement à enfermer toute personne trouvée en train de flâner après l’heure du couvre-feu, cette tour a été achetée 176 ans plus tard par Mark Manning et Bill Drummond, membres du groupe techno-pop The KLF (Kopyright Liberation Front), dans l’intention d’y séjourner régulièrement afin de laisser leurs esprits créatifs s’épanouir loin de l’agitation des villes. Mais, se rendant compte qu’ils n’y passaient finalement que peu de temps, ils décidèrent d’en faire un lieu de résidence accessible gratuitement à tout artiste travaillant dans n’importe quelle discipline, à la seule condition d’y laisser une œuvre réalisée sur place. Au bout des deux premières années d’occupation, Drummond fit l’inventaire des œuvres accumulées et considéra qu’elles ne méritaient rien d’autre que d’être brûlées. Un fait qui n’étonnera pas les connaisseurs de KLF et de sa démarche situationniste, qui a notamment mené le groupe à brûler en 1994 un million de livres sterling en coupures de 50 livres, soit le solde de leurs droits d’auteurs perçus pour les ventes de leurs disques au début des années 1990… Titillé par la démarche de Drummond à la Curfew Tower, Lee Harris se sentit attiré par un séjour sur place. “Mais j’étais mal à l’aise à l’idée que toute œuvre produite pendant mon séjour soit brûlée si elle n’était pas jugée assez bonne”, écrit-il dans une lettre à Drummond. Il décida donc d’intervenir sur la tour elle-même, en songeant que “pour des raisons évidentes, Drummond n’était pas prêt à mettre le feu au bâtiment”.
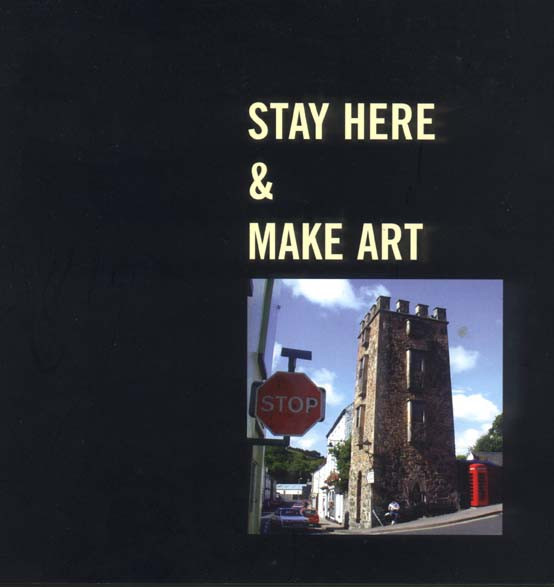
Harris obtint une résidence de quelques jours dans la tour par l’entremise de son ami Martin “Cally” Callomon, rencontré à l’occasion du premier album d’O.Rang. Il ne dévoila toutefois ses intentions ni à ce dernier, ni aux propriétaires du lieu. Une fois sur place, il se fit livrer tout un tas de matériaux, dont une grande quantité de verre découpé, une pompe et 1500 litres d’encre d’imprimerie noire… “Alors que je soulevais le premier couvercle de boîte de conserve du liquide noir, je me suis vu sourire largement dans le reflet du miroir”, poursuit-il, en se rappelant avoir été apprenti imprimeur dans sa jeunesse. Il achemina le tout, au prix de plusieurs jours et plusieurs nuits de sueur, dans une pièce de 18.318 mètres cubes située au quatrième étage de la tour, où il construisit… une “boîte” de verre entièrement remplie d’encre, d’un mètre d’épaisseur et d’un poids de près de deux tonnes, dotée d’une passerelle reliant l’entrée à une zone centrale d’observation ! “L’encre agit comme un miroir qui reflète la vue depuis chaque fenêtre et le reste de la pièce”, explique l’artiste. “Lorsque vous regardez à l’intérieur, vous voyez le plafond apparaître comme le sol, mais en dessous de l’endroit où vous vous trouvez. Vous avez l’impression de flotter dans la pièce. Vous voyez une image 3D en mouvement devant vous, lorsque vous vous déplacez pour élargir votre vue. De même, les qualités acoustiques ont changé de façon spectaculaire, l’espace semble désormais silencieux en permanence, à l’exception de votre propre respiration. Le panneau sur la vitre indique ‘Pétrole brut non fumeur’.” L’histoire ne dit pas comment Drummond a réagi en recevant la lettre d’Harris ni combien de temps l’œuvre est restée…
Mais ce n’est pas tout. Lee a également développé des aptitudes pour la magie. Il est d’ailleurs devenu membre d’une société de prestidigitation. Simon Edwards se souvient qu’il a régulièrement montré ses dons de magicien aux musiciens qui accompagnaient Rustin Man et Beth Gibbons lors de la tournée Out of Season, en leur faisant des tours dans le bus qui les transportait d’une ville à l’autre… Harris est plus que probablement doté de multiples autres facettes et de nombreuses ressources que ces anecdotes donnent envie de connaître, mais malheureusement pour nous la discrétion de Lee est légendaire.

Des chemins sans lignes droites
Plusieurs années après Laughing Stock, Talk Talk s’est vu affubler de l’étiquette de “groupe le plus sous-estimé des années 1980” – malgré tout de même neuf compilations et un album live pour à peine cinq albums studios ! Spirit of Eden et Laughing Stock ont résisté au temps et aux classifications, rejoignant la catégorie des disques existant dans leur propre monde, quasi en autarcie, comme In A Silent Way de Miles Davis ou Astral Weeks de Van Morrison. La notoriété des derniers albums de Talk Talk, considérés comme des échecs au moment de leur sortie, n’a cessé de croître par le bouche à oreille et l’envoûtement continuel de nouveaux auditeurs. Il en va de même pour leur influence musicale. Il est fréquent de lire qu’ils ont ouvert la voie au post-rock et de citer, pêle-mêle, Elbow, Radiohead, Blur, voire même Alan Wilder de Recoil (ex-Depeche Mode) ou Jeff Ament de Pearl Jam. Mais il serait bien trop fastidieux de dresser une liste de ces influences. Car si ces deux albums ont “fait école”, c’est sans avoir donné naissance à un quelconque courant identifiable mais plutôt en innervant les inspirations de musiciens innombrables et extrêmement variés.
La notoriété rétrospective et croissante de Spirit of Eden et Laughing Stock a aussi ouvert de nouvelles portes à certains des musiciens qui y ont participé… À l’image de Simon Edwards, invité à jouer sur plusieurs albums d’Alain Bashung dont son plus expérimental, L’imprudence (2002), puis embauché par Dominique A sur Tout sera comme avant (2004). Pour Dominique A, Laughing Stock représente “une musique inépuisable, dont on ne fait jamais le tour”, “un soufflet permanent envers l’arrogance et la vulgarité de la pop mainstream contemporaine et ses mouvements de mentons perpétuels.”
Phill Brown a lui aussi été approché par différents groupes, tel Midnight Choir, inspirés par son implication dans l’organicité du son de Talk Talk. Cela a relancé sa carrière dans une nouvelle direction… Dans les années 2010, Brown a définitivement arrêté de travailler pour des majors. “Quand Universal a racheté toutes les autres maisons de disques, cela a mis fin au métier”, enrage-t-il. La multinationale, détenue par le groupe français Vivendi, partage désormais 70% du marché du disque avec ses concurrentes Sony et Warner. Depuis, Brown continue à collaborer avec des musiciens sur des productions indépendantes. Il est aussi le seul qui ait continué à graviter autour de tous les ex-membres officiels ou non de Talk Talk. En 2009, il a ainsi mixé l’insaisissable Ten Sketches For Piano Trio enregistré par Tim Friese-Greene avec un vieux piano acheté sur un marché aux puces.

Souffrant d’acouphènes, Friese-Greene a quasiment abandonné la production au début des années 2000, exception faite pour le groupe folk Firefly Burning (Skeleton Hill enregistré par Phill Brown en 2015, et Breathe Shallow en 2019). Il est réapparu comme musicien en 2020 dans Short-Haired Domestic, un duo mené avec sa compagne Lee Howton, chanteuse et guitariste du groupe Pavlova et autrefois de Riot Grrl et de Sidi Bou Said. Sur l’album éponyme, chacun des neuf morceaux est chanté dans une langue différente. “J’étais intéressé par une sorte de funk lourd et ralenti, avec pas mal de bruits abstraits, et en général par la saleté et l’imperfection”, explique Friese-Greene. “J’ai eu l’idée vers 2017 de faire un album de funk lent, mais je ne voulais pas m’embarrasser de batteurs ou de programmation de batterie, alors j’ai pris neuf boucles de breakbeat sur des vinyles de DJ des années 1990 qui traînaient. À peu près à la même époque, Lee (Howton, NDR) et moi prenions des cours d’italien et j’ai été frappé par la facilité avec laquelle elle adoptait les nuances de la langue.”
D’où l’idée étonnante de cet album kaléidoscopique, doux et provocateur où l’on trouve par exemple une chanson en espagnol adressée aux hommes qui conduisent de grosses voitures, une chanson en japonais sur l’importance d’essayer les choses avant de s’engager, une chanson en danois dans laquelle il y a beaucoup de mécontentement, ou encore une chanson en latin sur l’importance des chaussures confortables, laquelle évoque l’importance “de toujours porter ses propres chaussures et de choisir son propre chemin, car les chaussures des autres ne conviennent jamais”, selon les précisions de Lee Howton.
À peine ce disque sorti, Friese-Greene a mis à profit la période de confinement de la pandémie Covid-19 pour installer un studio rudimentaire au dernier étage d’une école temporairement vide et y réaliser un autre projet à l’aide d’un huit-pistes, d’un vibraphone, d’un mélodica et d’une batterie jouée avec des fouets souples. Un processus d’une grande simplicité qui était censé être l’enregistrement le plus rapide de sa carrière… jusqu’à ce qu’il se mette en tête d’y ajouter la contribution d’un ensemble à cordes de vingt musiciens devant tenir dans la même pièce tout en respectant les mesures de distanciation physique.
« L’héritage et le véritable esprit de Talk Talk »
Trente ans après “l’évaporation” de Talk Talk, ses anciens membres semblent avoir fidèlement respecté ce qui peut s’apparenter à un vœu de silence plus ou moins conscient autour de cette période, sans doute pour “laisser la musique parler pour elle-même” comme ils le disent, peut-être pour ne pas remuer des sentiments ambivalents à certains égards, peut-être tout simplement par respect pour Mark Hollis, qui n’a pas donné une seule interview depuis son album solo en 1998.
Lee Harris semble ne pas avoir adressé la parole à un journaliste depuis 1986, mais il n’a jamais été un grand bavard. Keith Aspden et Tim Friese-Greene sont revenus sur Talk Talk dans de rares interviews, ce que Friese-Greene refuse obstinément depuis le début des années 2010. Une des dernières fois qu’il le fit, il affirma ne jamais avoir écouté l’album solo d’Hollis. Seul Phill Brown s’est toujours montré ouvertement dubitatif sur ce silence et sur l’aura mystérieuse qu’il crée. Il ne s’est jamais refusé d’évoquer le processus de Spirit of Eden et Laughing Stock, notamment dans son livre de mémoires Are We Still Rolling? paru en 2011.
Quant à Paul Webb, il est redevenu accessible dès 2019 pour parler des nouveaux disques de Rustin Man, tout en restant peu loquace dès que ses interlocuteurs essaient de le faire parler de Talk Talk. Depuis lors, il prend néanmoins un plaisir manifeste à publier régulièrement de petits textes sur les réseaux sociaux, évoquant des pensées actuelles ou des souvenirs choisis. Tel ce post consacré à Harris, au moment où sont organisés en Angleterre des concerts hommages à Talk Talk : “Comme moi, Lee n’a pas voulu s’impliquer dans les concerts d’hommage à Talk Talk. Mais je suis sûr que quoi qu’il fasse ensuite, il ne va pas revenir sur de vieux terrains, pour aller de l’avant, chercher de nouvelles et intéressantes façons de s’exprimer dans la musique. Ce qui, à mon avis, maintient l’héritage et le véritable esprit de Talk Talk bien vivant.”
➔ Épisode 6 : “Mountains of the Moon”, ou l’art de déjouer les attentes (1991-1998)
Sources :
- Interviews de Phill Brown (2016-2018), Martin Ditcham (2016), Simon Edwards (2016)
- Lee Harris sur le forum du site O.Corner, 13 août 2002
- Interview de Tim Friese-Greene par John Clarckson, Penny Black Music, 24 mai 2006
- “Lost Paradise”, Jim Irvin, Mojo, mars 2006
- Interview de Tim Friese-Greene, Mugram Thesic, 1999, Bombay Arts Review
- “A Game without Rules”, Fifteen Questions, octobre 2020
- “Are We Still Rolling? Studio’s Drugs & Rock ‘n’ Roll. One Man’s Journey Recording Classic Albums”, Phill Brown, 2011
- Page Facebook de Rustin Man, 1er décembre 2020
- “Substation Zero”, Matt Ffytche, The Wire, août 1996
- “Of Masks and Men”, Dave Robinson, Future Music Magazine, octobre 1994
- Lee Harris sur le forum du site O.Corner, 12 octobre 1999
- Page Facebook de Rustin Man, 26 octobre 2019
- Page Facebook de Rustin Man, 30 août 2021
- “Storm Static Sleep: A Pathway Through Post-Rock”, Jack Chuter, Function Books, 2015
- Lee Harris sur le site O.Corner, 26 octobre 2002
- “No Rush for Recording Rustin Man”, Steve Harvey, ProSound, 1er février 2019
- Page Facebook de Rustin Man, 23 octobre 2020 et 2 août 2021
- Lettre de Lee Harris à Bill Drummond reproduite sur le site O.Corner, 21 mai 2002
- “Mark Hollis”, Dominique A, Comment Certains Vivent, 28 février 2019
- “First Listen: Short-Haired Domestic”, Ryan Martin, Jammerzine, 22 avril 2020
- Page Facebook de Rustin Man, 2 août 2020









14 commentaires
se taire!
Merci!
çà ta sauvé?
Thank you, I really enjoyed reading that! Greetings from The Netherlands
sors la PELLE!
raoul, les a, petites!?
« L’homme-rustine » est un jeu de mot ne pouvant marcher qu’en français, Rustin Man voulant en fait dire l’homme qui se désagrège sous le poids des ans (rust = rouille).
Rust never sleeps…