Produits par Philip Glass et auteurs de chansons new wave à décoiffer les plus vieux de nos chauves lecteurs, ces New-Yorkais auraient pu – et dû – être ce glaçon qu’on attendait tous pour rafraîchir cette année tiède. Le hic, c’est que Polyrock a commencé sa carrière en 1978 et l’a terminé quatre ans plus tard dans une relative indifférence. Comment vécurent-ils sans la gloire, et pourquoi sont-ils morts sans les honneurs ? Retour en arrière sur un groupe en avance.
C’est l’histoire d’un groupe qui, dès le départ, s’est tiré une balle dans le pied et qui, à force d’anticiper les modes sans même le faire exprès, a raté l’essentiel, hormis la musique. Les plus belles injustices faisant souvent les meilleures histoires du rock, celle de Polyrock est devenue, en deux albums et demi, l’un de ces cas d’école qu’on devrait enseigner dans les cours élémentaires pour dissiper les malentendus.
Lesson one : to be at the right place at the right moment
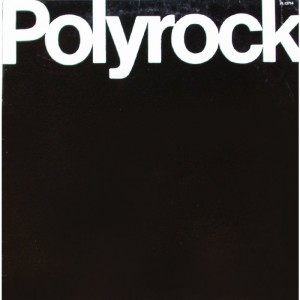 Dès le départ, l’Amérique de Billy et Tommy Robertson, les frangins fondateurs de Polyrock, ne ressemble pas à celle de leurs compatriotes. Nous sommes en 1978, année zéro. C’est le chant du cygne pour Sid et ses Pistolets, la naissance du disco à l’échelle mondiale, et accessoirement — selon certains puristes — le dernier sursaut des Stones avec « Some Girls », déjà en retard sur son époque. Bref, c’est tout sauf une année pour lancer un groupe de Mr Nobody ayant pour objectif d’inciter la jeunesse blanche à déhancher son bassin de cadre moyen des trente glorieuses. La première place du podium étant de toute façon déjà prise par le « Saturday Night Fever » des Bee Gees, pas besoin de sortir du Studio 54 pour comprendre que Polyrock s’est, avant même la sortie de son premier album, trompé d’époque.
Dès le départ, l’Amérique de Billy et Tommy Robertson, les frangins fondateurs de Polyrock, ne ressemble pas à celle de leurs compatriotes. Nous sommes en 1978, année zéro. C’est le chant du cygne pour Sid et ses Pistolets, la naissance du disco à l’échelle mondiale, et accessoirement — selon certains puristes — le dernier sursaut des Stones avec « Some Girls », déjà en retard sur son époque. Bref, c’est tout sauf une année pour lancer un groupe de Mr Nobody ayant pour objectif d’inciter la jeunesse blanche à déhancher son bassin de cadre moyen des trente glorieuses. La première place du podium étant de toute façon déjà prise par le « Saturday Night Fever » des Bee Gees, pas besoin de sortir du Studio 54 pour comprendre que Polyrock s’est, avant même la sortie de son premier album, trompé d’époque.
Le physique des Robertson brothers ne semble même pas être une caution suffisante. Pas vraiment beaux, ni vraiment dans l’air du (contre) temps, rien de plus que des Tony Micelli du Connecticut avec le cul entre deux chaises — le punk et la dance music — entre lesquelles Billy et Tommy refusent de choisir. Cette schizophrénie entre la tension et le relâchement s’illustre parfaitement avec le nom choisi par les frérots : « poly » pour l’avant-garde et les synthétiseurs, « rock » pour les groupies et la Rickenbacker. Un drôle de groupe transgenre qui peine à trouver chaussure de danse à son pied. Même époque circa 1979, et alors que les deux Américains peinent encore à entrouvrir la porte des maisons de disques avec leur rock poli, le déjà très en vu Philip Glass publie un disque de musique contemporaine nommé « Dance » qui a bien dû satisfaire la cinquantaine de paumés qui peuplaient la planète Bizarre. Voilà l’affaire. D’un côté, des rockeurs à peine dignes d’une première partie au CBGB’s, de l’autre un musicien d’avant-garde que rien ne prédestine à produire ces cousins éloignés de Tom Verlaine. Et c’est pourtant ce qui arrive lorsque Polyrock parvient enfin à sortir son premier album éponyme chez RCA. « Marquee Moon » est sorti trois ans plus tôt, il n’y a visiblement pas de place à New York pour un groupe du même acabit. Et pourtant…
On ne va pas prendre quatre chemins pour l’écrire, « Polyrock » s’avère avec le recul être l’une de ces bombes à déflagration lente. Très lente. Tellement lente qu’il aura fallu trois décennies pour que ses ricochets égratignent – et encore – le tympan de l’auditeur moderne. New wave par endroits et post-punk faute de mieux, ce premier essai aux lumières irrégulières balaye un spectre musical tellement large que même plusieurs écoutes ne parviennent pas à dissiper toutes les incompréhensions du même auditeur, stupéfié gueule grande ouverte face à tant d’associations contre-nature.
Fortement – et forcément – influencé par les boucles répétitives de Glass, Billy Robertson ne conçoit pas le rock sans l’utilisation de petits claviers vicieusement planqués ça et là, parfois même joués par Glass himself. Ça démarre sec avec Romantic Me et son orgue de messe qui fait l’hallali pendant que le chanteur s’époumone comme un damné ; à ce stade, on peut encore croire à la chance du débutant et pourtant non, c’est juste une mise en bouche avant le grand zigzag. Enchaînement avec This Song, version rimbaldienne du No New York de James Chance avec ses guitares-cutters tirées à quatre épingles ; premier virage à bâbord avec No Love Lost et ses changements de rythme qui donnent le vertige, passage à tribord version cyborg du Bronx avec Bucket Rider et ses balafres punk romantique sous méthadone ; puis tangage houleux avec le chef d’œuvre Your Dragging Feet, entrecoupé par les hoquets d’un Billy Robertson possédé comme Ian Curtis ayant avalé de traviole, qui évoque la main de fer dans un gant de velours des Athéniens de feu Pylon, groupe culte lui-même exhumé par DFA voilà quelques années. Comme quoi, à New York la boucle finit toujours par se boucler. Ad nauseam…
Tout ceci n’explique pas le rôle inédit de Philip Glass en tant que producteur – ce sera sa première et dernière expérience en la matière. « J’ai eu de la chance, j’ai croisé des tas de gens aux influences diamétralement opposées, j’ai été exposé à différentes sortes de cultures et j’ai pu en tirer parti pour ma propre musique », explique-t-il à une college radio qui lui pose alors la question. « Pour moi, Police, les B-52’s, Bartok, les requiem de Verdi, finalement c’est un peu la même chose, je ne fais pas de distinction entre la musique classique et la pop (…) et en tant que producteur de Polyrock, je voulais absolument éviter l’écueil de la ‘pre-packaged music’ ». Si sa présence aux manettes s’avère certainement décisive dans le succès tout relatif de ce premier album, on aurait pourtant tort de résumer Polyrock à un groupe de grands guignols manipulés par ce grand gourou qui fait inévitablement penser au Brian Eno des premiers Roxy Music. Car Polyrock, comme on dit chez Midas, en a sous la pédale. Six mois passent, un ange aussi. Le succès est en retard, Polyrock referme la porte à double tour pour changer de style et faire sa propre vidange.
Lesson two : Remake, remodel
 « Pourquoi t’es plus new wave, pourquoi t’aimes plus mes rock’n’roll qui tournent en 45 tours ? », crie William Sheller dans la chanson du même nom. On est déjà en 1982 et, à voir la tenue du principal intéressé, on comprend bien que la nouvelle vague a besoin, comme dirait Jakie Quartz, d’une mise au point. Synchronisation des horloges oblige, Polyrock se cale sur l’heure anglaise en adoptant un style Roxy Music période brushing et cruising en sidecar avec une réponse au « Avalon » sorti quelques mois plus tôt. On pourra à l’occasion pinailler sur la qualité de certains des morceaux et sur le côté binaire du batteur obsédé par le quatre temps, n’empêche que « Changing Hearts » contraste avec la majorité des productions de l’époque ; disque tour à tour vulgaire et précieux, foncièrement cheap et soigneusement travaillé dans ses parties de guitare « ciselées » — on disait comme ça au siècle dernier, les anciens lecteurs de Best apprécieront — un disque de périphérie qui hélas passe à côté de la cible en dépit d’une réelle ambition : ne ressembler à personne. « On n’est jamais rentré en studio en se disant que la guitare devait sonner comme du Eagles, ou que tel riff devait ressembler à du Keith Richards, expliquent les frères Robertson en 80, et c’est pour ça qu’on aime travailler avec un producteur, le genre de type capable d’imposer une texture, un son qui, même s’il peut faire penser à tel ou tel groupe, sera toujours le fruit d’une réflexion avec un angle créatif, et pas juste une référence aux claviers de David Bowie. »
« Pourquoi t’es plus new wave, pourquoi t’aimes plus mes rock’n’roll qui tournent en 45 tours ? », crie William Sheller dans la chanson du même nom. On est déjà en 1982 et, à voir la tenue du principal intéressé, on comprend bien que la nouvelle vague a besoin, comme dirait Jakie Quartz, d’une mise au point. Synchronisation des horloges oblige, Polyrock se cale sur l’heure anglaise en adoptant un style Roxy Music période brushing et cruising en sidecar avec une réponse au « Avalon » sorti quelques mois plus tôt. On pourra à l’occasion pinailler sur la qualité de certains des morceaux et sur le côté binaire du batteur obsédé par le quatre temps, n’empêche que « Changing Hearts » contraste avec la majorité des productions de l’époque ; disque tour à tour vulgaire et précieux, foncièrement cheap et soigneusement travaillé dans ses parties de guitare « ciselées » — on disait comme ça au siècle dernier, les anciens lecteurs de Best apprécieront — un disque de périphérie qui hélas passe à côté de la cible en dépit d’une réelle ambition : ne ressembler à personne. « On n’est jamais rentré en studio en se disant que la guitare devait sonner comme du Eagles, ou que tel riff devait ressembler à du Keith Richards, expliquent les frères Robertson en 80, et c’est pour ça qu’on aime travailler avec un producteur, le genre de type capable d’imposer une texture, un son qui, même s’il peut faire penser à tel ou tel groupe, sera toujours le fruit d’une réflexion avec un angle créatif, et pas juste une référence aux claviers de David Bowie. »
Si Glass a encore le cul rivé sur le fauteuil du producteur, on commence tout de même à se demander comment Papy compte tripatouiller cette grande salade niçoise : « Ma musique est très physique, et en toute logique cela doit se traduire par des mouvements eux-mêmes physiques, répond alors Glass, actuellement on entre dans une phase musicale dansante, c’est ce qu’on entend dans tous les clubs, et à ce niveau-là Polyrock m’a semblé très concerné par la nécessité, quasi physique, de faire danser ses auditeurs. » C’est bien beau tout ça, mais à vouloir changer son cœur de place, Polyrock peine à trouver ses partenaires. Y a boire et à manger sur « Changing Hearts », y a même quelques restes qu’on mettra à la poubelle avec l’impression toutefois d’avoir bien mangé. Et pour pas cher en plus… Une reprise synthetico-rococo des Beatles (Rain), un titre qui aurait pu figurer sans rougir sur un best-of de Blondie (In Full Circle), un autre du calibre du crooner Bryan Ferry dans ses bons jours (Love Song), les frères Robertson commencent à frotter leurs égos de façon déraisonnable en tentant le grand écart douloureux entre avant-garde et mainstream. Un peu comme si les Feelies avaient décidé d’embaucher Steve Reich à la production avec l’espoir secret de passer sur MTV. Bien évidemment, ça ne marche pas.
Jusqu’au-boutiste sur le premier album et désormais prêt à courber — un peu — l’échine si besoin pour entrer dans le moule commercial, le Polyrock de 1982 ne ressemble plus, comme on peut le lire un peu partout, à une « décalcomanie des Talking Heads », ces voisins de palier de Brooklyn dont la seule originalité aura été, provocation mise à part, de fournir à l’humanité des albums plus ampoulés qu’une discothèque. Alors que le groupe de David Byrne a fait ses débuts avec un disque éponyme à la couleur rouge Mercurochrome, Polyrock a opté pour le sobre noir. Une sorte de non-choix esthétique qui collera aux basques d’un groupe qui, pas plus que par son nom, ne brille par ses pochettes. Celle de « Changing Hearts » ne fait pas exception. D’une laideur atroce à vous en donner la nostalgie de Paul Young et de tout autre chanteur de variété s’étant abandonné, le temps d’un morceau play-back, sur les Champs Élysées de Michel Drucker. Pour couronner le tout, le disque est un monumental flop sans single, même pas capable de traverser l’Atlantique pour trouver grâce aux yeux des Européens. Ça sent le sapin. Glass se tire sur la pointe des pieds, suivi de près par Tommy, qui laisse son frère seul sur le bateau. Et Polyrock, en toute logique, commence à tomber à l’eau.
Lesson three : the death is not the end
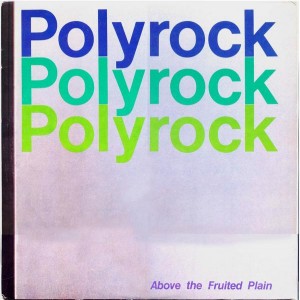 Il y aura tout de même un baroud d’honneur nommé « Above the Fruited Plain », un EP de cinq chansons décomplexées où Billy, désormais alone in Babylone, se lâche complètement sur les synthés. Et vas-y que je force sur le mascara, et vas-y que j’m’en fous du solo de guitare tellement plastoque que c’est même plus chic, rien à foutre le Billy, il ouvre les vannes parce qu’il faut maintenant casser le jouet et que tout doit disparaître. Inutile de préciser que, si l’EP rencontre le même succès qu’une vente des petites culottes de Margaret Thatcher à Drouot, Polyrock parvient encore à éviter le prêt-à-écouter des ondes FM. Et rétrospectivement, des morceaux synth-pop comme Call of the Wild ou Working on my love enterrent dès la première écoute l’intégralité du répertoire de Hot Chip et autres professionnels de la contrefaçon sur trois touches. De l’autre côté, le fantôme de Jacno plane sur la dernière chanson de l’EP — et donc du groupe —, Indian Song, qui rappelle que l’auteur de Rectangle a déjà sensiblement fait la même chose… trois ans plus tôt. Un injuste retour de bâton qui n’enlève rien à la fulgurance de Polyrock, pas plus qu’il ne sauve le groupe d’une mort prématurée. En 1982, l’affaire est pliée, le groupe se dissout alors même que le « Thriller » de Bambi explose dans les charts. Ça sent sévèrement le cramé pour les rockeurs de cette génération.
Il y aura tout de même un baroud d’honneur nommé « Above the Fruited Plain », un EP de cinq chansons décomplexées où Billy, désormais alone in Babylone, se lâche complètement sur les synthés. Et vas-y que je force sur le mascara, et vas-y que j’m’en fous du solo de guitare tellement plastoque que c’est même plus chic, rien à foutre le Billy, il ouvre les vannes parce qu’il faut maintenant casser le jouet et que tout doit disparaître. Inutile de préciser que, si l’EP rencontre le même succès qu’une vente des petites culottes de Margaret Thatcher à Drouot, Polyrock parvient encore à éviter le prêt-à-écouter des ondes FM. Et rétrospectivement, des morceaux synth-pop comme Call of the Wild ou Working on my love enterrent dès la première écoute l’intégralité du répertoire de Hot Chip et autres professionnels de la contrefaçon sur trois touches. De l’autre côté, le fantôme de Jacno plane sur la dernière chanson de l’EP — et donc du groupe —, Indian Song, qui rappelle que l’auteur de Rectangle a déjà sensiblement fait la même chose… trois ans plus tôt. Un injuste retour de bâton qui n’enlève rien à la fulgurance de Polyrock, pas plus qu’il ne sauve le groupe d’une mort prématurée. En 1982, l’affaire est pliée, le groupe se dissout alors même que le « Thriller » de Bambi explose dans les charts. Ça sent sévèrement le cramé pour les rockeurs de cette génération.
Comme l’horloge du rock ne tourne que très rarement à l’envers, Polyrock n’aura jamais droit à la postérité qu’il méritait. Pas de réédition, aucun sacre mortuaire et des vinyles disponibles sur eBay à prix discount. En moins de quatre ans d’existence, les New-Yorkais n’ont pourtant pas ménagé leur peine pour éviter l’unhappy end ; ils sont aussi les témoins d’une époque où la musique allait simplement trop vite pour eux. De 78 à 82, Polyrock aura connu la fin du punk, les débuts du disco, la naissance du CD, le rock MTV et la mondialisation du R’n’B sur grand écran. Une sorte de film musical en accéléré, avec des héros d’un jour qui se retrouvent subitement commerciaux chez Xerox, à ressasser le passé en tripotant la photocopieuse à souvenirs. L’époque étant au revival 80’s et les sosies eux-mêmes n’étant plus ce qu’ils étaient, Polyrock méritait au moins ça : une ultime apparition au générique de fin.









13 commentaires
POLIOROCK ::: Le mec au synthé semble avoir un sacré problème
Ils sont six sur la photo et produits par Phillip Glass, l’immortel compositeur de la BO de The Truman Show, Poliorock, groupe qui fut largement méconnu durant leur existence de 1978 à 82, jusqu’à leur redécouverte par Bester Langs lors de l’été 2012, et leur retour triomphal sur scène. Permettant par la même le retour en hype du style new wave cheveux courts et manches de chemises retroussées à Paris. Merci Bester.
Hey, ça me plait bien bien bien ça, merci !
On dirait un groupe de Playmobil sur le 1er clip. C’est ça l’avangarde, ressembler à un groupe de Playmobil, merci les 80’s! Non c’est pas mal sinon.
Non mais une vente des petites culottes de Margaret Thatcher à Drouot, c’est la phrase la plus trash de l’année, CLAIR!
Et l’on s’enfonce dans ce mois de doute si morne, nous disposons de sa bande-son maintenant
merci
Je me souviens même d’un critique français (mais je ne sais plus lequel) qui avait pris ça pour du rock progressif…
J’ai les 2 LPs et je les réécoute régulièrement, je trouve que ça a plutôt mieux vieilli que la majorité des trucs de l’époque. Je les avait découvert par le biais de la collaboration de Tommy Robertson au 2ème LP d’Extraballe, « Sales romances ».
Merci beaucoup pour ce papier !
Je les ai découverts en 1981, j’ai encore leurs vinyles de l’époque en pressage français avec l’étiquette RCA Collection « Rock Moderne ».
En fait RCA avait essayé à l’époque de lancer la New Wave US sous cette rubrique avec des groupes comme Slow Children.
A noter une réédition cd en 2007 des 2 premiers album RCA.
GONZAÏ VEUT TU PEUX TU LE RESSORTIR C QUI LE CHEF DE CE PRODUIT ?????????