Toute sa vie, The Killer aura secoué son piano autant qu’il le pouvait; tellement qu’à la fin il en est mort. Si l’on connaît toutes ses petites anecdotes, du mariage avec sa cousine à l’incendie de son piano devant Chuck Berry, restera surtout cette vie boogie-woogie brûlée par les deux bouts, entre foi en Dieu et haute sympathie pour la musique du diable. Origines, influences, technique et prestations mémorables : Ladies and gentlemen, voici la naissance et mort du rock’n’roll racontées par les deux mains qui glissent de Jerry Lee Lewis.
Dans Hellfire, le plus beau livre consacré à Jerry Lee Lewis et peut-être « un futur classique de la littérature américaine » comme l’espère Greil Marcus dans sa préface, Nick Tosches ne laisse aucun doute planer : le pianiste chanteur de rock’n’roll originaire de la petite ville de Ferriday, Louisiane, aurait été « le dernier fils sauvage de l’Amérique, l’homo agresis americanus ultimus […], un prince de l’excès, dans tous les sens du terme. » Encore plus loin dans la projection du mythe sauvage qui entoure Jerry Lee, Nick Kent considère le pianiste comme « le dernier des primitifs à l’état pur, un homme d’une telle authenticité qu’il en devient complètement surréaliste. » Jerry Lee Lewis a entraîné le rock’n’roll et sa jeunesse dans l’expression et les outrances d’un jeune péquenaud du Sud profond des États-Unis, parmi ceux qu’on appelle on ne peut plus péjorativement les « poor white trash », là où la représentation d’une sauvagerie américaine ne fait aucun doute pour l’Américain de la classe moyenne. Elaine Dundy voit en cette figure du “poor white trash” celui que chacun connaît aux États-Unis mais dont il est convenu de taire le nom. Prononcer ces mots reviendrait à exprimer une haine sociale inavouable : “un blanc, parce que pauvre et rustre, serait un déchet, un tas d’ordures”. Pour l’Américain moyen, le Sud Profond est un pays étranger, perçu comme primitif, barbare, explosif, exotique et isolé. De façon contradictoire, il est considéré à la fois comme hautement littéraire et profondément ignorant, tout comme lâche et héroïque. Ce Sud profond produit une quantité disproportionnée d’hommes et de femmes très célèbres et est habité « par des gens plus grands que nature, excentriques, colorés, dramatiques, en fait, carrément théâtraux ».
« La musique de Jerry Lee ne fait aucune différence entre avoir la pêche et pécher, flirter et s’offrir une pute, s’éclater et basculer dans la folie » (Nick Kent)
Par ses frasques et ses scandales qui contrastent avec la puissance d’exhortation de sa musique, Jerry Lee Lewis incarne la dualité de cette représentation. Coureur de jupons invétéré, le jeune homme cumule les infidélités et les mariages de circonstance, s’aventurant chaque année un peu plus dans une vie d’alcool, de pilules de benzédrine, de violence armée et d’excès en tous genres, défiant sans le savoir le puritanisme ambiant, la loi et les bonnes manières. La musique de Lewis « ne fait aucune différence entre avoir la pêche et pécher, flirter et s’offrir une pute, s’éclater et basculer dans la folie » écrit Nick Kent, et c’est peut-être à travers ce naturel totalement assumé et décomplexé de celui qu’on nomme “le killer” que le rock’n’roll des années 1950 s’est exprimé le plus en accord avec sa quête perpétuelle d’authenticité, d’excitation et de dépassement des limites.

Ferriday, Louisiane
Comme si le rock’n’roll devait se charger d’exprimer la voix de ces marginaux du Vieux Sud — et c’est peut-être là une des réussites les plus importantes du producteur Sam Phillips — la plus grande star du label Sun Records après Elvis sera Jerry Lee Lewis, un jeune fils de cultivateurs de coton, issu d’un milieu rural plus marginal encore que celui d’Elvis.

Jusqu’au début du XXe siècle, le site de Ferriday n’est qu’un champ de coton dépendant d’une plantation. L’endroit est choisi par les compagnies de chemin de fer pour servir de terminus, et Ferriday devient officiellement un village en 1906. Dans les années 1930, les moyens de locomotion sont limités alors que les distances sont gigantesques, ce qui isole géographiquement Ferriday des grandes villes louisianaises et de Memphis. Ferriday reste d’ailleurs aujourd’hui l’une des villes les plus inquiétantes du nord de la Louisiane. La route principale qui la traverse, la Mississippi Avenue, est aussi connue localement sous le nom de Mason-Dixon Line, parce qu’elle a toujours divisé la ville en deux parties : les noirs d’un côté, les blancs de l’autre. La méfiance et le soupçon règnent dans le secteur, et les mises en garde vis-à-vis des voyageurs vont bon train. Dans les années 1930, la population de Ferriday est aux deux tiers afro-américaine et principalement constituée de cultivateurs de coton. Cette population pauvre entraîne le mépris de tous, a fortiori celui des poor white trash, ces blancs qui « s’abaissent » à partager les mêmes ingratitudes professionnelles que les descendants des esclaves affranchis. À côté du travail, les habitants de Ferriday cumulent les activités hors la loi. Le braconnage est courant tout comme le vol de bétail et la distillation de whiskey de contrebande, qui envoie d’ailleurs en prison Elmo Lewis, le père de Jerry Lee, quelques mois avant sa naissance. Beaucoup de familles vivent en clans rivaux. Les fermes étant relativement distantes, les rapports sont peu nombreux et obscurcis par des démêlés familiaux ou en rapport aux affaires. Cette vie, qui s’organise autour de la famille au sens large, peut donner lieu à des rapports consanguins.
À vingt-deux ans, Jerry Lee Lewis se marie ainsi pour la troisième fois en épousant sa jeune cousine de treize ans, sans toutefois avoir divorcé de sa précédente femme. La moralité de ces « white trash », en tous les cas chez les Lewis, est pour le moins archaïque et ne s’arrête pas à ce genre de détails d’âge et de consanguinité. C’est plutôt le puritanisme radical prôné par l’église que Jerry Lee Lewis et sa famille fréquentent, l’Assembly of God (« Assemblée de Dieu ») qui fait foi et loi et qui aura une incidence permanente sur la vie musicale et personnelle du pianiste de rock’n’roll.
L’Assembly Of God de Ferriday
Cette église est un lieu central dans la vie du clan, lieu de prière mais également d’échange et de rencontre entre les familles Swaggart (le cousin Jimmy Lee Swaggart deviendra prédicateur pentecôtiste et un dangereux télévangéliste de renommée mondiale), la famille Gilley (Mickey Gilley, autre cousin de Jerry Lee deviendra un pianiste et chanteur qui suivra les aspects salutaires de la musique country), et la famille Lewis. La foi de la famille de Jerry Lee et de ses cousins se transmet à travers cette branche pentecôtiste du protestantisme aux aspects sectaires, très implantée dans le Vieux Sud et en particulier à Ferriday. L’Assemblée de Dieu, depuis sa création en 1914, est la dénomination religieuse qui a eu la croissance la plus rapide en Amérique et qui compte aujourd’hui bien plus de membres que n’importe quelle principale branche du protestantisme en Amérique. Elle est principalement composée d’Américains ordinaires qui aspirent à la transcendance dans leur vie. Dans la jeunesse de Jerry Lee Lewis, l’Assemblée de Dieu est déjà la cinquième église qui s’implante dans la petite ville du nord de la Louisiane. Elle recueille principalement ses ouailles chez les pauvres et se rend attrayante auprès d’eux par un charisme particulier qui insiste sur l’existence du surnaturel.

Tout commence en 1936, quand Leona Sumrall, une jeune évangéliste de dix-sept ans, aurait eu une vision divine. Elle aurait reçu pour mission de faire revenir Ferriday dans le droit chemin, le territoire étant principalement réputé pour ses faits divers notoires. Selon Elaine Dundy, il arrivait des choses affreuses à ceux ou celles qui refusaient d’être « sauvés », qui ne suivaient pas le chemin ouvert par Leona Sumrall ; une femme qui répandait une fausse rumeur à son propos pouvait retrouver son fils renversé par une voiture ou décéder d’une façon épouvantable. A l’image de Robert Mitchum dans son rôle de prédicateur dans The Night Of The Hunter, la jeune Leona Sumrall était pour le moins manipulatrice voire littéralement maléfique. Durant les années 1940, qui ont marqué l’enfance de Jerry Lee, la congrégation de l’Assemblée de Dieu de Ferriday pilotée par Leona Sumrall compte un maximum de cinquante fidèles, dont beaucoup font partie de sa famille. On y estime que l’alcool est un péché de même que le tabac, le cinéma, les salles de danse, le jeu, la nage en public ; les femmes n’ont pas le droit de couper leurs cheveux, de se maquiller et de porter des pantalons et le darwinisme est perçu comme une croyance farfelue. Malgré ses péchés, sa musique et les péchés que sa musique l’entraînera à commettre, Jerry Lee Lewis est un fervent croyant. Jamais il ne remettra sa foi en question, il prendra simplement les dispositions qui lui conviennent pour tromper le diable: « La religion, ça m’gêne pas d’en parler pasque j’y crois pas… Alors là, pas du tout ! J’crois au salut. Au salut et à la sanctification. Le reste, c’est boniments et compagnie. »

Spirituals et glossolalie à l’Assembly of God
Le lien de Jerry Lee Lewis à la musique a eu lieu à l’église, où le jeune garçon a commencé à chanter des cantiques dès qu’il en a été capable. Le jeu sur un tempo lent témoignait du respect du texte biblique. Ces tempos retenus, Jerry Lee Lewis s’y applique sur un certain nombre d’albums et de chansons, tout du moins quand il s’écarte ponctuellement du rock’n’roll pour absoudre ses péchés dans la country ou le gospel. Cette seule distinction d’appréciation du tempo dans la musique d’église des blancs marque une différence notable avec la musique d’église afro-américaine qui adapte le répertoire à chaque événement et cérémonie. Le spiritual n’y a jamais une forme définitive : la communauté afro-américaine le remodèle sans cesse au gré des événements et de son humeur, du tempo le plus lent au plus rapide.
«Jerry Lee Lewis observe régulièrement les membres de sa famille se rouler par terre, tourner sur eux-mêmes, crier, pleurer, tout en exprimant la parole de l’Esprit Saint dans des langues inconnues».
Durant les messes de l’Assemblée de Dieu, c’est surtout l’idée de repentance qui est importante puisque c’est le moyen pour les pentecôtistes d’obtenir la rémission des péchés et de témoigner de leur foi en Jésus en tant que sauveur. L’Assemblée de Dieu prône l’idée que ses fidèles peuvent être sauvés, renaître et être habités par l’Esprit Saint. Alors que, dans de nombreuses églises de la population blanche, la participation se limite au simple « Amen » et à quelques hymnes, les fidèles de l’Assemblée de Dieu de Ferriday peuvent crier, pleurer et sauter. Il arrive même parfois que les fidèles acquièrent le don qui leur permette, par le pouvoir du Saint- Esprit, de parler une langue qu’ils n’ont jamais apprise. C’est ce que l’on appelle le « speaking in tongs » (« parler en langues »), autrement appelé « glossolalie », la manifestation la plus impressionnante et la plus gratifiante du fidèle qui exprime en une langue inconnue la parole de l’Esprit Saint. Les fidèles de l’Assemblée de Dieu accordent une grande importance à cette manifestation divine par la possession du fidèle qui se met à parler en langues inconnues. Ces manifestations de la glossolalie sont fréquentes à l’Assemblée de Dieu de Ferriday et Jerry Lee Lewis, même s’il n’a jamais lui-même été pénétré par ces voix, observe régulièrement les membres de sa famille se rouler par terre, tourner sur eux-mêmes, crier, pleurer, tout en exprimant la parole de l’Esprit Saint dans des langues inconnues.
L’observation de Little Richard, tout aussi croyant et pratiquant que Jerry Lee Lewis, est intéressante par son contraste. Quand il était enfant, les parents de Little Richard fréquentaient plusieurs églises de Macon, Géorgie. Parmi toutes, celle qu’il préférait était l’église pentecôtiste : « Quant au grand moment d’improvisation où chacun était censé extérioriser sa ferveur en laissant parler le Saint-Esprit par sa bouche, c’était pour nous la franche rigolade. Nous imitions les adultes sans comprendre un traître mot à ce que nous disions. »467 Mais, dans le monde blanc, entre deux sermons terrifiants de Leona Sumrall, ces visites du Saint-Esprit sont pour Jerry Lee Lewis bien plus effrayantes qu’amusantes. L’Assemblée de Dieu a la main mise sur son esprit et la crainte de la damnation ne le quittera jamais : « C’est quéque chose que j’vis chaque putain d’minute de chaque putain d’jour et d’nuit d’ma putain d’vie. »468 On peut également observer cette crainte maladive de la damnation dans White Lightnin’, un film de Dominic Murphy qui adapte la vie de Jesco White à l’écran, un danseur de claquettes légendaire qui vivait dans au cœur des montagnes Appalaches, en Virginie Occidentale, dans des conditions de pauvreté assez proches de celles de Jerry Lee Lewis. Le film montre avec une violence rare le poids que peuvent avoir la religion, la drogue et la misère sur un artiste issu du milieu des blancs les plus pauvres. Dominique Murphy illustre l’extrémisme religieux avec une violence rare, avec pour musique originale le rock’n’roll de Hasil Adkins, « un rock’n’roll saturé d’alcool, sauvage, cinglé, hurlé, incroyablement rugueux, grossièrement enregistré ».

Moitié ange, moitié démon
Jerry Lee Lewis absorbe sans distinction toutes les musiques de son environnement, c’est d’ailleurs un des principaux talents des meilleurs rock’n’rollers de cette époque à l’instar d’Elvis, mais Jerry Lee a toujours vécu la musique à travers le clivage communautaire imposé par la représentation musicale de l’Assemblée de Dieu. Dans son église, la musique country et le gospel représentent la culpabilité et le salut, tandis que le boogie-woogie, très prisé par Jerry Lee Lewis, représente une de ces musiques du péché et de l’abandon aux tentations interdites par son église et autrement appelées « musiques du diable ». Chaque incartade du pianiste vers le boogie-woogie est considérée comme blasphématoire et Jerry Lee est persuadé de la portée diabolique de ses rythmes préférés.
Le tempo et le rythme du boogie-woogie ne sont pas au goût de l’église ni de l’école baptiste fondamentaliste de Waxahachie, Texas, qu’il rejoint à l’âge de quinze ans. Exclu quinze jours pour avoir joué l’hymne pentecôtiste My God Is Real en style boogie-woogie, Jerry Lee Lewis n’y remettra finalement jamais les pieds. Avec son boogie, Jerry Lee s’engouffre corps et âme dans tout ce que son église et son environnement lui défend sous peine de la damnation éternelle. Qu’on l’appelle boogie-woogie ou rock’n’roll, la damnation reste encore le prix à payer pour jouer ces musiques qui illustrent le tourment et la dangereuse confusion entre mysticisme et réalité. Avant que Sam Phillips n’ait enregistré quoi que ce soit de Jerry Lee Lewis, la seule catégorisation qui permette de comprendre le caractère transgressif de la musique de Jerry Lee Lewis est l’idée que ce jeune blanc se soit engouffré dans la musique du Diable. Mais ces aspects diaboliques vont de pair avec les attentes du rock’n’roll, de sa rébellion et de ses excès et le rock’n’roll allait hisser le pianiste bien au-delà de ce qu’un jeune white trash était en droit d’espérer.
Déjà enfant, Jerry Lee Lewis s’aventure sur le terrain musical des afro-américains, notamment en ce lieu nommé la grande maison de Haney (Haney’s Big House), un juke joint où bluesmen et pianistes de boogie-woogie animaient les soirées. Jerry Lee Lewis rôde près de la grande maison de Haney malgré les sermons de sa paroisse et les mises en garde familiales. Partagé entre sa curiosité pour la musique du diable et celle du Saint-Esprit que son église lui recommande pour le salut de son âme, le jeune garçon est déjà enclin à une certaine dualité. Cette perte de repères, qui vient s’ajouter au clivage racial du Vieux Sud, est déterminante dans la carrière de Jerry Lee Lewis. Grâce à sa culture musicale familiale, il était prédisposé à mélanger ces genres, mais il devra à diverses périodes de sa vie bannir le rock’n’roll pour, dit-il, regagner le droit chemin. Comme le rythme des musiques qu’il aime transmet une image de dépravation et surtout le risque de la damnation, Jerry Lee Lewis se privera périodiquement de jouer du boogie-woogie pour privilégier les rythmes et les textes de la musique country. Pour certains morceaux aussi évocateurs que Great Balls Of Fire, « qu’il commença par refuser de jouer parce qu’il voyait dans cette chanson un blasphème impudique » (Tosches), Jerry Lee Lewis s’est approprié des textes presque à son insu, succombant de façon chronique à l’attirance de cette musique que la presse de l’époque qualifiait volontiers « d’un genre d’animalité suggestive qui devrait être confiné aux bouges et aux bordels ».
« Ce qui rend la Louisiane magique et hantée a fait de Jerry Lee un intermittent du spectacle qui propose parfois, sans prévenir, une certaine forme dévoyée de génie involontaire ». (Laurent Chalumeau)
Peut-être que le plus intéressant reste l’idée que le style de Jerry Lee, aussi bien instrumental que vocal, soit le produit d’un phénomène idiosyncrasique, soit l’idée que ce qui en fait un musicien admirable et exceptionnel tient de sa façon totalement atypique de faire face à son conflit intérieur, représentée ici à travers une dualité qui n’offre, selon Jerry Lee, que deux alternatives : « Dieu a dit qu’Il préfère que vous soyez froids ou bouillants car, si vous êtes tiède, Il vous vomira de Sa bouche. Nul ne peut servir deux maîtres: ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.” Être rigoureusement excessif, que ce soit dans le respect de la parole du Saint-Esprit ou, à l’opposé, dans la vie de pécheur qu’il mène en grand connaisseur et à tous les niveaux, voilà l’engagement du pianiste. Trop ambitieux pour tout faire voler en éclat, Jerry Lee a néanmoins toujours gardé un œil sur les limites du public. Jerry Lee Lewis ne s’est jamais totalement détaché d’une musique ou d’une autre, sa vision radicale et extrême ne lui permettant pas de concilier le Saint-Esprit et le Diable en une seule et même musique. Il les a donc jouées chacune leur tour, selon la tournure que prenaient les événements souvent macabres de sa propre vie, les jouant parfois en même temps, mais sans jamais les mélanger ouvertement comme Elvis Presley pouvait le faire à ses débuts. Jerry Lee Lewis ne cataloguait pas la musique et Sam Phillips appréciait particulièrement cette qualité rare.
« Elvis m’a demandé : “Tu crois que je joue la musique du diable ?” Je lui ai répondu : “Tu es le diable en personne, mon garçon.” » (Jerry Lee Lewis)
Robert Palmer, quand celui-ci demande Jerry Lee Lewis en 1979 pourquoi le fait de jouer du rock’n’roll pourrait le conduire en enfer : « Lewis me regarda comme si je lui avais juste posé une question stupide et impossible : “Je ne peux imaginer Jésus Christ faire le ‘whole lotta shakin », dit-il calmement. Quand un simple rapport sexuel peut vous conduire en enfer, la vie pieuse devient un renoncement à tous les désirs. Contrairement à Elvis Presley, la musique n’était pas vécue par Jerry Lee Lewis comme un tout indissociable. C’est avant tout l’origine géographique et sociale de Jerry Lee Lewis qui expose la sauvagerie originelle de ce jeune « poor white trash » aux yeux de tous. Comme l’écrit Laurent Chalumeau : « Ce qui rend la Louisiane magique et hantée a fait de lui un intermittent du spectacle qui propose parfois, sans prévenir, une certaine forme dévoyée de génie involontaire. » La représentation du mal était au cœur du déchirement et d’une certaine frustration du jeune homme qui ne nourrissait aucun culte pour le diable, mais ne pouvait se résoudre à suivre la « vie pieuse » de son cousin Jimmy Lee (qui aura néanmoins de sombres démêlés avec la justice avant d’avouer une relation extraconjugale avec une prostituée afro-américaine). Le rock’n’roll n’était pas encore là pour incarner la nouvelle musique du Diable que, déjà, Jerry Lee Lewis avait fait du boogie-woogie sa passion la plus dévorante. Il ne jouait pas du rock’n’roll, il était le rock’n’roll, parce qu’il injectait dans son boogie suffisamment d’excès pour que cette musique soit celle de son époque, celle d’un jeune homme exposé à un tourment obsessionnel qu’il occulte par une vie d’excès et de débauche. Partagé entre peur, frustration et culpabilité à s’abandonner aux désirs défendus et aux excès propres à sa communauté, la transgression religieuse va devenir un élément caractéristique du rock’n’roll de Jerry Lee Lewis, une musique qui acquiert une puissance d’expression pentecôtiste par sa puissance et son exubérance alors qu’elle est une lutte permanente pour s’en extirper.

La musique à la maison des Lewis
Six ans avant la naissance de son second enfant, en 1929, Elmo Lewis achète un gramophone Victrola d’occasion, un modèle à manivelle, qui va permettre à la famille d’écouter les chansons de Jimmie Rodgers, le musicien préféré du père de Jerry Lee. Avec Al Jolson et Hank Williams, ces trois musiciens écoutés en famille sont parmi les plus grandes stars des années 1930 et 1940, et Jerry Lee Lewis les hisse en tête du panthéon des grands stylistes de la country.


Ces trois chanteurs brassent de nombreuses pratiques musicales, des musiciens de scène qui couvrent à eux trois à peu près tout ce qu’il était possible de faire musicalement pour un musicien populaire des années 1930 et 1940. À la fois blackface, chanteurs dans des minstrel shows, chanteurs de music-hall, instrumentistes et multi-instrumentistes, mémoires vivantes de l’old time music (que Jimmie Rodgers sera parmi les premiers à enregistrer sur disques) et auteurs-compositeurs prolifiques, on entend fréquemment leur influence sur la pratique musicale et scénique de Jerry Lee. Le pianiste hérite notamment de la technique vocale du yodel (Waiting For A Train) et du format chanson tel que Jimmie Rodgers le joue dans ses blues, le goût de la mise en scène et de l’entertainment d’Al Jolson, et de la voix plaintive et des textes emplis de repentance de Hank Williams. Contrairement à Elvis Presley, qui adapte les chansons country à son propre style énergique dans ses enregistrements chez Sun, Jerry Lee Lewis interprète ce répertoire dans des versions fidèles au genre original, qui subissent rarement de réelles transformations vers son genre de prédilection, le boogie-woogie. Sa version de Cold Cold Heart reste la ballade lente telle que l’avait interprétée Hank Williams, comme le Crazy Arms de Ray Price, et de chansons disons “de variétés” comme That Lucky Old Sun de Frankie Laine. Le rock’n’roll de Jerry va bien plus se construire à partir des titres de rhythm’n’blues et du rockabilly en s’inspirant du boogie-woogie ambiant.
La musique de la Haney’s Big House
« Elvis m’a demandé : “Tu crois que je joue la musique du diable ?” Je lui ai répondu : “Tu es le diable en personne, mon garçon” ». Jouer la « musique du diable » à Ferriday et dans le Sud Profond signifie jouer le tempo et le rythme du boogie-woogie, chanter les textes du blues, ou de quelques marginaux du hillbilly, et c’est aussi vrai des deux côtés de la route.

Dans les rues de Ferriday, Jerry Lee est attiré par le country blues, ce blues dit « du Delta ». Jerry Lee aurait entendu jouer un disque de Robert Johnson dans son voisinage, un souvenir qui l’aurait impressionné et effrayé au plus haut point. Mais c’est surtout le boogie-woogie qu’il entend s’échapper de la grande maison de Haney qui va marquer son goût pour le piano débridé et rythmique. Dans la 4e Rue, en plein cœur du quartier noir de Ferriday, il y avait une maison de bois qui abritait une boîte de nuit gérée par « Big » Will Haney. Dans la Grande Maison de Haney, les seuls blancs qu’on acceptait étaient les programmateurs de la station de radio WMIS de Natchez (la « grande » ville la plus proche, sur l’autre rive du Mississippi), et ils devaient s’asseoir à une table séparée, située sur le bas-côté de la scène.
C’est le groupe du tromboniste Peewee Whittaker qui joue à la Grande Maison de Haney dans les années 1950, quand le public vient tous les samedis danser, boire, se battre, et apprécier les concerts joués à un volume si fort, que Peewee Whittaker dit que tout Ferriday l’entendait. On y écoute alors des pianistes comme Sunnyland Slim et Big Maceo, et beaucoup des futurs musiciens parmi les plus connus du Sud, comme B. B. King, Bobby « Blue » Bland, Little Milton, Junior Parker, Muddy Waters, Memphis Slim, Joe Hinton, Ray Charles et Fats Domino. Tous ces musiciens, qui passent à la Grande Maison de Haney, sont généralement accompagnés par le groupe de Peewee Whittaker. Jusqu’à ce qu’elle brûle en 1966, il n’y avait aucun lieu comme celui-là à des kilomètres à la ronde, y compris à Natchez, où le shérif avait augmenté le prix des licences pour tous les clubs de musique afro-américains, des tarifs trop élevés pour les propriétaires des clubs, ce qui les obligeait à mettre la clef sous la porte, pour la plus grande satisfaction des blancs. C’est donc chez Haney que les jeunes Jerry Lee Lewis et Jimmy Lee Swaggart passaient secrètement leurs samedis soir à observer et à écouter par la fenêtre la vie festive de la communauté afro-américaine, bien loin de ce à quoi ils avaient accès avec les disques de leurs parents et les spirituals de l’Assemblée de Dieu. Le boogie-woogie était leur musique préférée et, en se faisant encore plus petits qu’ils ne l’étaient, ils pouvaient observer l’ambiance et les musiciens avec une saveur d’interdit qui rendait cette musique d’autant plus excitante. Peewee Whittaker se rappelle de Jerry Lee Lewis : « J’ai commencé à jouer avec Jerry Lee Lewis quand il est entré et s’est assis avec nous. Il avait des idées et voulait enregistrer des disques. Il m’a demandé de lui montrer quelques plans que je lui ai montrés, comme la façon de s’arrêter, de prendre son temps, ce genre de choses. Il était avec nous tous les week-ends. Tous les samedis soir, il venait et s’asseyait à l’intérieur. On ne lui permettait pas de jouer avec des gens de couleur, mais il pouvait s’asseoir et jouer. Il était merveilleux à la Grande Maison de Haney. »
Le piano chez les Lewis
Le piano sur lequel Jerry Lee Lewis enregistre ses premiers disques aux studios Sun Records à Memphis est un piano dit “spinet”. L’un des premiers facteurs à fabriquer ce genre d’instruments était un Américain, J. I. Hawkins, originaire de Philadelphie. Leur table d’harmonie est montée à l’horizontale, comme pour un piano à queue, mais avec des cordes plus courtes. Deux fois moins chers qu’un piano droit, plus petits, plus légers, souvent montés sur des cadres en fonte pour qu’ils résistent aux difficiles conditions de transport, ces pianos spinet ont trouvé leur place dans des endroits inédits jusqu’alors : des bars, des bordels, des chapiteaux, des petites maisons.

Globalement, les pianos américains bon marché ont une sonorité assez différente de nos pianos d’étude européens, plus brillante et métallique. Leur vélocité est souvent moins fine et précise, le toucher est très léger, presque lâche, et leur accordage est moins strictement juste. Ces particularités sont dues à la facture des instruments, mais également aux fortes chaleurs et à l’humidité de la région.
Le piano droit est quant à lui arrivé naturellement à Jerry Lee Lewis : celui de l’église de l’Assemblée de Dieu sur lequel lui et ses cousins pouvaient s’exercer, un autre chez son oncle Lee Calhoun auquel Jerry Lee Lewis a librement accès, jusqu’à ce qu’à ses dix ans, son père lui ramène un piano d’occasion de marque Starck qu’il installera dans leur vieille baraque. Tant que Jerry Lee s’en tenait aux chansons country sur un rythme lent et des basses en pompes, personne ne trouvait rien à redire. Mais Jerry Lee Lewis a la fâcheuse habitude d’adapter des chansons au rythme du boogie-woogie. Depuis qu’il a adapté Silent Night (« Douce nuit ») au rythme du boogie-woogie, il débute un programme de diabolisation de toutes les chansons sur lesquelles ses doigts passent, ce qui aurait eu le don d’exaspérer ses parents au point « de rendre son père plus fou que l’enfer » (Tosches).
L’influence du boogie-woogie
Une heureuse découverte musicale témoigne que, dès 1952 à l’âge de seize ans, Jerry Lee était déjà virtuose d’un boogie-woogie bruyant et doté de multiples subtilités, notamment dans l’approche du jeu de main gauche du jeune pianiste. Grâce à New Orleans Boogie, un titre effectivement enregistré à La Nouvelle-Orléans et retrouvé par Cecil Harrelson, un ami qui a conservé l’unique disque gravé ce jour-là, on peut écouter un Jerry Lee déjà déchaîné. Il n’a eu probablement qu’une prise ce jour-là et, parti sur un tempo qui ne le satisfait pas, il accélère dès les premières secondes. Les walking basses ne cessent de changer, sa partie de main droite joue déjà un puissant pilonnage, et le tout est accentué par la pédale de sustain, qui ajoute des résonances dissonantes.
« Vous prenez une main droite blanche et une main gauche noire » (Sam Phillips dans le film Great Balls Of Fire)
Le boogie-woogie étant une musique de tradition orale, il n’est pas possible d’en dater précisément l’apparition. La première partition comportant une basse ostinato de boogie-woogie date de 1915 (Weary Blues, de Artie Mathews), et Jimmy Yancey est le premier représentant de ce qui devient peu à peu un genre musical. Sur disque, l’expression s’impose en 1928 avec le Pinetop’s Boogie-Woogie, de Clarence « Pine Top » Smith, un pianiste et chanteur de blues assassiné à vingt-trois ans. Dans ce genre aux tempi rapides, qui se limite généralement à l’instrumentation du piano solo, la main gauche du pianiste joue un walking bass ou une pompe sur rythme straight ou shuffle, souvent en alternance de fondamentales/quintes, fondamentales/sixtes, tout cela ostinato, tandis que la main droite apporte l’élément mélodique souvent virtuose. Le boogie-woogie quitte l’écriture, la forme, et le jeu en basses alternées du ragtime, pour renouer avec des spécificités disons plus proches du blues (par l’improvisation, le shuffle, les blue notes, l’aspect cyclique). Quand il n’est pas totalement instrumental, le boogie-woogie fait intervenir des couplets chantés qui s’intègrent librement entre des parties solistes. La version de Down The Road A Piece (« Un peu plus bas en descendant la route ») par Amos Milburn en 1947 est à la fois un des boogies les plus repris dans le rock’n’roll mais aussi un modèle du genre, y compris pour Jerry Lee.
Si Jerry Lee Lewis s’est souvent exprimé sur les chanteurs qui l’ont influencé, Robert Palmer constate qu’il est toujours resté de marbre quand on lui pose des questions sur ses influences pianistiques. Avec ses propres sources, Nick Tosches écrit que Jerry Lee jouait inlassablement deux morceaux de boogie-woogie : le Down The Road A piece d’Amos Milburn et The House Of Blue Lights par Freddie Slack, enregistré en 1946.
Jerry Lee Lewis aime également beaucoup Del Wood, une pianiste virtuose de Nashville qui, dira-il lors de son seul concert au Grand Ole Opry en 1973, fait partie de ses influences majeures. Del Wood est principalement connue pour Down Yonder, un titre instrumental de 1952. Le style pianistique de Del Wood est assez ancré dans le ragtime et se caractérise aussi par la permanence des glissandi de main droite qu’on retrouve chez Jerry Lee.
Parmi les autres influences de ce boogie-woogie, on peut évoquer celle du pianiste Moon Mullican. Surnommé “le roi des pianistes de hillbilly”, Mullican joue une sorte de stride simplifié, « le style à trois doigts », comme il l’appelle (l’auriculaire de la main gauche joue les basses, le majeur et le pouce apportent le complément harmonique). Ses improvisations de pumpin’ piano et sa virtuosité ont probablement influencé Jerry Lee, notamment avec un titre comme Cherokee Boogie.
Dernière influence et pas des moindres, celle de Merrill Moore, dont le style est probablement le plus proche de celui de Jerry Lee, le plus influencé par le boogie-woogie afro-américain. Nombre de ses titres sont d’ailleurs des reprises que Jerry Lee reprenait également pour son compte, notamment Down The Road A Piece, et House Of Blue Lights. En comparaison, le groove coulant et souple des versions afro-américaines se transforme sous les doigts de Merrill Moore en une interprétation plus raide et sautillante, une version plus proche de la country. La steel guitar de la country s’infiltre d’ailleurs dans sa version de House Of Blue Lights.
La technique pianistique de Jerry Lee
L’énergie pianistique de Jerry Lee n’est pas transcriptible. Les dérapages multiples de ses deux mains qui ajoutent de la « crasse », des dissonances, tout ce bruit en lien avec le feeling du pianiste, sont des éléments impossibles à transcrire et qui, pourtant, sont au cœur de l’adaptation du boogie woogie dans l’espace médiatique du rock’n’roll. Ils sont relatifs à l’ardeur des poignets de Jerry Lee, à des doigts qui ne se contentent pas de pénétrer les touches voulues, mais qui dérapent facilement sur les bords, en jouant avec les marges et les limites. Dans le film Great Balls Of Fire, le personnage de Sam Phillips lance cette phrase: « Vous prenez une main droite blanche et une main gauche noire » et vous obtenez Jerry Lee Lewis. Qu’en est-il exactement ?
1) Rips
Ces « déchirements » désignent un geste typique du piano blues, en particulier des pianistes de La Nouvelle-Orléans, comme Professor Longhair ou Fats Domino. Le geste consiste à jouer le plus vite possible, des aigus aux graves, la triade dans sa position fondamentale, triade à laquelle on ajoute la seconde (deuxième note de la gamme). En do, la tonalité de Whole Lotta Shakin’, cela donne une descente sol-mi-ré-do que l’on pourrait écrire comme un triolet de doubles croches, le do marquant le temps suivant.
Pour développer ces rips vers des aspects plus bluesy comme c’est le cas de Jerry Lee, il est possible de remplacer la quinte (sol), par sa blue note (sol b), et la tierce majeure (mi) par la tierce mineure (mi b). Cela produit un effet très court qui condense deux blue notes à la fois, b3 et b 5 (de l’aigu au grave : sol b – fa – mi b – ré – do), une technique que Jerry Lee exploite assez peu en comparaison à d’autres pianistes louisianais.

2) Tremolo
C’est un procédé que Jerry Lee utilise principalement pour les ballades, pour souligner les notes qui marquent les fins de phrases mélodiques (intro de Crazy Arms, solo de Fools Like Me) mais également dans Great Balls Of Fire qui est un rock’n’roll plutôt lent, mais au groove dur et entraînant, exactement dans le sillon de Lucille de Little Richard, sorti neuf mois avant, en février 1957.
3) Slides
Jerry Lee Lewis utilise la technique du slide comme adaptation pianistique du slide guitaristique qui consiste la plupart du temps à faire riper l’index ou le majeur d’une touche noire à la touche blanche supérieure, sur la note correspondant à la tierce mineure vers la tierce majeure. Jerry Lee Lewis utilise cette technique, fort probablement apprise à la grande maison de Haney, à la vue des pianistes afro-américains. On entend cette technique de jeu sur les blue notes pendant le solo de Whole Lotta Shakin, sur les accentuations rythmiques du pilonnage de piano. Jerry Lee développe plus intensément cette technique encore en accompagnement du chant sur Great Balls Of Fire.
4) Walking basses
Le walking bass en ostinato typique du boogie woogie s’exprime on ne peut plus clairement dans l’introduction de Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, avant que la batterie et la guitare ne viennent s’ajouter sur la deuxième mesure. C’est un départ sur les chapeaux de roue qui ne prend pas le temps d’attendre la fin du walking bass. L’urgence a parfois du bon, puisque la seule prise de la session permet de mettre très clairement en avant le walking bass martelé par la main gauche du pianiste (fondamentale, tierce majeure, quinte, et sixte). Il y a une forme d’économie dans le walking bass de Jerry Lee sur Whole Lotta Shakin’. La virtuosité de Jerry Lee lui aurait sans doute permis de jouer cette partie sur le eight-note feeling, en ajoutant les doublures du walking bass octaviées. Mais Jerry Lee choisit le walking le plus fondamental, celui de quatre noires par mesures, qui lui permet d’accentuer les notes et le beat. Il y a peu de fantaisies à noter dans cette partie, si ce n’est l’utilisation d’un chromatisme en transition de C7 à F7. Par contre, le slapback appliqué au piano, et le son puissant des basses obtenu grâce aux punaises fixées sur les marteaux du piano par Jack Clement, permettent au piano de délivrer une énergie singulière et un son probablement jamais entendu auparavant.
5) Glissandi
Jerry Lee Lewis utilise trois techniques de glissando. Sous sa forme descendante , il utilise son pouce qui glisse de la position adoptée dans les aigus jusqu’au secteur de la serrure du piano. Il l’utilise également sous sa forme ascendante en faisant partir l’index et le majeur du dernier élément joué pour remonter presque jusqu’en haut du clavier. Et, pour un effet encore plus « explosif », Jerry Lee enchaîne les deux types de glissandi. Il est clair que Jerry Lee Lewis a travaillé ce procédé, non plus seulement pour aller d’un point à un autre du clavier comme cela peut-être le cas chez la pianiste Del Wood, mais bien comme un symbole de fougue et d’emportement.
Comme l’atteste Johnnie Johnson, pianiste et co-compositeur de nombreuses chansons de Chuck Berry, la technique de glissando de Jerry Lee Lewis est devenue un trait stylistique du piano rock’n’roll : « Reelin’ And Rockin’ fut la première chanson pour laquelle Leonard Chess me demanda de “déchirer les touches”. Ce que ça voulait dire, c’est qu’il fallait laisser sa main glisser le long du clavier […] comme le fait Jerry Lee Lewis. »
6) Pumpin’ piano
Dans le solo de Whole Lotta Shakin’, Jerry Lee expose deux types de pumpin’ piano qui débitent le matériau rythmique avec lequel il développe son style vigoureux, énergique et puissant. Sur C7, il martèle un intervalle qui comprend la blue note (sol-mi b) en croches shuffle puis passe sur un pilonnage plus rapide en triolets sur le même intervalle, joué cette fois à l’octave inférieure, créant ainsi une intensification du procédé : toujours percussif, mais en plus rapide. Le pilonnage le plus impressionnant est celui qui consiste à parcourir de longues descentes d’octaves des aigus aux graves et l’inverse, en ajoutant un complément harmonique plus ou moins aléatoire. On peut entendre cette technique déchaînée et frénétique sur Wild One (Real Wild Child). Jerry Lee est probablement le musicien le plus « frénétique » de son époque par cette technique mise systématiquement en avant dans ses disques et ses concerts. C’est typiquement ce type de sons martelés et répétés qui ont accompagné ses audaces scéniques les plus extraordinaires.
Au-delà de ses influences et de ces techniques pianistiques, Jerry Lee concentre son jeu sur les aspects les plus durs et les plus fiévreux du boogie-woogie. C’est un style plus dur que celui de Moon Mullican, et également plus plus épuré que celui de Cecil Gant. Peu de broderies, peu de rips, un walking bass qui s’en tient souvent à l’essentiel, joué en noires ou eight to the bar, tantôt shuffle (comme sur Whole Lotta Shakin’ ou Down The Line) tantôt straight (Great Balls Of Fire ; High School Confidential ; Sweet Little Sixteen). Il insiste principalement sur le martellement du rythme, ce pilonnage caractéristique qu’il a développé d’une façon plus frénétique que n’importe quel autre pianiste, et il marque également sa touche personnelle grâce à certains traits stylistiques comme les glissandi ou le jeu au pied quand il est sur scène.
En plus de s’être emparé de l’énergie rythmique pianistique du boogie-woogie, Jerry Lee l’a couplée à l’efficacité formelle de la chanson en construisant ses chansons sur un format couplet / refrain / solo / aussi efficace que celui d’Elvis. L’adaptation au format chanson du boogie woogie vers ce qu’il convient d’appeler par rock’n’roll du point de vue formel est décisive dans la popularité de Jerry Lee Lewis. Les textes sulfureux viennent donner du sens à la musique pour le vaste public et le piano en lui-même n’est plus respecté comme un instrument classique mais sacrifié au nom des pulsions maniaques du chanteur.

Whole Lotta Shakin’ Goin’ On ou le triomphe de l’excès
1957 est la seule année où les majors obtiennent autant de succès avec le rock’n’roll qu’avec les variétés. Cela ne s’était jamais produit et ne se reproduira plus de la décennie. Durant cette même année, les labels indépendants écrasent les résultats des majors au Billboard (40 disques arrivent en tête, contre 30 chez les majors, et deux sur trois sont des disques de rock’n’roll). Majors et labels indépendants confondus, les succès du rock’n’roll (43 numéros un au Billboard) dépassent les résultats des variétés (seulement 27). Jerry Lee Lewis a utilisé les outils médiatiques du rock’n’roll, à la fois en conquérant les classements nationaux et internationaux en 1957, et en s’imposant à la télévision qui cristallise une image intrinsèquement liée à la musique rock’n’roll.
C’est dans la projection d’un 45 tours au succès sans précédent, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, et à travers ses diverses prestations télévisées, que la représentation du pianiste sauvage trouve sa reconnaissance. Coup de pouce du destin : à la même époque, Elvis Presley endosse l’uniforme et se retrouve en Allemagne. L’ascension de Jerry Lee est si fulgurante, son attitude si audacieuse, qu’il semble alors être le seul à sérieusement menacer de détrôner le King, et c’est précisément parce que sa musique va s’immiscer dans sept millions de foyers qu’elle va pouvoir graver la gouaille graveleuse et l’énergie impétueuse d’une Amérique rustique qu’on s’efforce de ne pas trop voir sur les sillons de la nouvelle Amérique moderne.
Les quelques interprétations de Whole Lotta Shakin’ Goin’ On (« Ça secoue tant que ça peut ») qui ont précédé celle de Jerry Lee Lewis n’ont obtenu que très peu de succès commercial et sont rapidement tombées dans l’oubli. Les origines de la chanson ne sont pas parfaitement claires, mais les crédits sont attribués au chanteur afro-américain Dave « Curlee » Williams et au pianiste blanc James Faye « Roy » Hall. En mars 1955, « Big » Maybelle enregistre la première version pour Okeh Records, produite par le jeune Quincy Jones. « Roy » Hall l’enregistre à son tour en rockabilly en septembre de la même année pour Decca Records (avec probablement Grady Martin à la guitare) et affirme avoir écrit la chanson sous le pseudonyme de Sonny David. Néanmoins, les archives de Decca créditent Dave Williams comme seul auteur. Dans une interview radio, Jerry Lee Lewis attribue l’écriture de la chanson à « Big Mama » Thornton: Jerry Lee prend les chansons comme elles viennent à lui et il est probable qu’il ait confondu sa voix avec celle de « Big » Maybelle, assez rugueuse elle aussi… tout cela est aussi peu clair qu’un réveil un lendemain de cuite mais ce qui reste sûr, c’est que cette chanson semble lui avoir été véritablement destinée. À la demande de Jack Clement, principal assistant de Sam Phillips, Jerry Lee Lewis enregistre cette chanson au détour d’une session et nul autre interprète que lui n’a pu rivaliser avec la frénésie sexuelle qui semble jaillir de sa version.
Interprétation lubrique
L’amorce de cette histoire et ce qui explique le talent d’interprétation de Jerry Lee Lewis s’est probablement produit dans un petit club de Blytheville, Arkansas, quelque temps avant qu’il n’enregistre Whole Lotta Shakin’ Goin’ On. Entouré de jeunes femmes intriguées par le phénomène, Jerry Lee se lance dans l’interprétation de la chanson sans en connaître précisément les paroles. En oubliant les deux premiers vers, remplacés par la probable vocifération de ce que Nick Tosches qualifie de « dégueuli de nouvelles paroles », Jerry Lee Lewis ôte tout double sens possible à des propos déjà ouvertement sexuels. Comme le dit le personnage de Sam Phillips incarné par Trey Wilson dans Great Balls Of Fire, tout le monde savait bien que le « Lotta Shakin’ » c’était « la baisouille à l’état pur ». Le premier texte de Roy Hall diluait le contenu salace du texte avec ces « vingt et un tambours et un vieux tuba » et de ce « quelqu’un qui tape sur une ding-dong », des paroles vaguement métaphoriques ou plutôt insensées qui floutaient le message sexuel du texte. Roy Hall n’était pas le type le plus fin du coin, autant réputé pour son talent de pilonneur de piano que de buveur, mais le peu de métaphores qui diluaient le contenu évocateur du texte disparaissent totalement de la nouvelle version de Jerry Lee Lewis, pour donner libre cours à la gouaille des péquenots de Ferriday. L’interprétation de Jerry Lee Lewis s’engouffre dans l’expression d’un désir exclusivement sexuel, contrariant les rêves d’un amour pur et éternel de la musique majoritaire d’avant le rock’n’roll. Ce disque trouve son public auprès des adolescents de l’Amérique de 1957, une chanson charnelle, qui fait passer le désir sexuel avant un quelconque sentiment amoureux. Le succès du rock’n’roll auprès du public permet de se débarrasser désormais de nombreuses contraintes de bienséance, et de faire d’un de ces « white trash » l’un de ses héros les plus prestigieux, parce qu’il franchit les limites, les siennes et celles de la communauté. Ses propres limites, celles imposées par son église et le regard de sa famille, sont de toutes façons bien trop rigides pour qu’il puisse se résigner à les respecter. À quatorze ans, Jerry Lee Lewis chantait déjà des chansons à boire comme Drinkin’ Wine, Spo-Dee-O- Dee (« On boit du vin, spo-dee-o-dee) à l’arrière de la camionnette de son père. A vingt- deux ans, il enregistre Whole Lotta Shakin’ Goin’ On et Great Balls Of Fire, son plus grand blasphème musical.
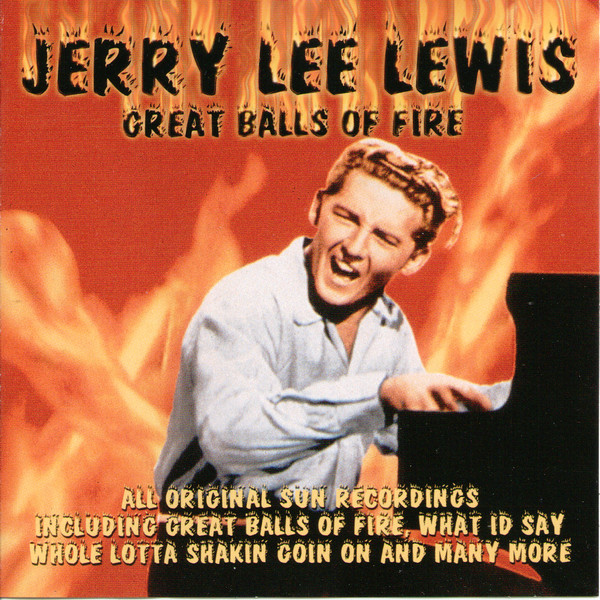 Pour le rock’n’roll, en seulement quelques années qui éloignent Rock Around The Clock de Whole Lotta Shakin’, les choses ont considérablement changé. On arrive ici avec Jerry Lee Lewis à l’expression la plus crue d’une sexualité que l’Amérique blanche n’aurait acceptée sans la validation de ses adolescents qui y trouvèrent entière satisfaction : l’excitation et l’acte en lui-même, tout y était dit. D’une certaine façon, Jerry Lee Lewis prenait la descendance de ses héros comme Jimmie Rodgers ou Hank Williams quand Greil Marcus écrit à propos des chanteurs de hillbilly “ qu’en goûtant aux péchés et aux libertés auxquels la communauté avait renoncé par nécessité ou qu’elle n’avait jamais connus, ils étaient trop ambitieux, mal élevés ou simplement trop différents pour s’adapter. » Face à la culture dominante, Jerry Lee Lewis rencontre un vaste public, joue sur les plateaux de télévision et gagne suffisamment d’argent pour pouvoir laisser libre cours à ses excès. Mais le plus extraordinaire est que sa première musique ne goûtait plus aux péchés, elle les dévorait pleinement.
Pour le rock’n’roll, en seulement quelques années qui éloignent Rock Around The Clock de Whole Lotta Shakin’, les choses ont considérablement changé. On arrive ici avec Jerry Lee Lewis à l’expression la plus crue d’une sexualité que l’Amérique blanche n’aurait acceptée sans la validation de ses adolescents qui y trouvèrent entière satisfaction : l’excitation et l’acte en lui-même, tout y était dit. D’une certaine façon, Jerry Lee Lewis prenait la descendance de ses héros comme Jimmie Rodgers ou Hank Williams quand Greil Marcus écrit à propos des chanteurs de hillbilly “ qu’en goûtant aux péchés et aux libertés auxquels la communauté avait renoncé par nécessité ou qu’elle n’avait jamais connus, ils étaient trop ambitieux, mal élevés ou simplement trop différents pour s’adapter. » Face à la culture dominante, Jerry Lee Lewis rencontre un vaste public, joue sur les plateaux de télévision et gagne suffisamment d’argent pour pouvoir laisser libre cours à ses excès. Mais le plus extraordinaire est que sa première musique ne goûtait plus aux péchés, elle les dévorait pleinement.
Le procédé d’excitation
En mars 1957, aux studios Sun Records, Jerry Lee Lewis et deux musiciens du groupe de Billy Lee Riley, The Little Green Men – Roland Janes et Jimmy Van Eaton – enregistrent Whole Lotta Shakin’ Goin’ On.
Faire simple, efficace, vite, et avec du feeling, telle semblait être la devise pour obtenir l’aspect si saisissant de Whole Lotta Shakin’ et du rock’n’roll avec lui. Réalisée en une seule prise, couvée par Jerry Lee Lewis depuis un certain nombre d’années alors qu’il pensait ne jamais enregistrer une chanson si osée, le sort en était jeté. C’est Sam Phillips et Jack Clement qui font figures de révélateurs de talent, et pas au sens professionnel du terme, mais bien dans l’idée qu’en demandant à Jerry Lee Lewis de se tourner vers ce type de chansons plutôt que vers la country, ils allaient l’aider, à partir de ce Whole Lotta Shakin’, à trouver sa terre d’élection.
Du point de vue du timbre, les disques de Jerry Lee bénéficient des procédés développés par Sam Phillips, mais encore plus poussés que chez Elvis Presley en cette année 1957. Le slapback (l’écho développé par le producteur sur ses enregistreurs à bandes) est plus fort qu’auparavant, appliqué au piano, ce qui est tout à fait inédit. Jack Clement, l’assistant de Sam Phillips, customise le piano du studio à l’aide de punaises qu’il fixe sur chaque marteau des touches du piano. Au contact des cordes, elles apportent cette sonorité métallique bien adaptée pour transcrire la puissance sonore et la brillance recherchées. Toujours aussi minimaliste qu’avec Elvis Presley, l’accompagnement s’en tient au strict minimum (piano, guitare, batterie), avec l’ajout du son spatial de l’époque injecté par l’effet slapback.

Durant la dernière minute de l’enregistrement, quand le trio instrumental baisse d’intensité pour venir accompagner en fond sonore la voix de Jerry Lee Lewis, la musique elle-même est tout à fait révélatrice d’une sorte de procédé d’excitation développé par le chanteur. Le principe est aussi simple qu’efficace : créer une tension musicale en diminuant le volume de l’accompagnement. C’est ce que Charlie Gillett entend précisément dans le style de Jerry Lee Lewis quand il explique “qu’il était un des chanteurs rock’n’roll qui avait le plus de contrôle et d’auto conscience en introduisant une technique sophistiquée de variation d’une palette émotionnelle pour ses chansons rapides, construisant d’intenses pics pour les relâcher ensuite, faisant chuter sa voix à un soupir et le rythme à un doux clapotis, avant de repartir une nouvelle fois vers un autre climax. » La minute préorgasmique de Whole Lotta Shakin’, qui peut s’étendre à souhait selon la densité de ses concerts en est l’exemple le plus éloquent. Jerry Lee met clairement en avant le texte salace et cru; si la métaphore n’était pas difficile à comprendre à l’époque, elle l’est d’autant moins aujourd’hui : Shake it, shake it babe… À ce moment de la chanson où l’intensité de l’accompagnement diminue le temps de deux grilles (une seule fut trop courte pour mener la chose à terme) le beat n’est plus la valeur première du rock’n’roll. La concentration et l’application particulière que Jerry Lee demande à sa partenaire charnelle sont d’une description tellement précise, qu’elles franchissent le stade de l’évocation pour devenir une sorte de monologue lubrique.
Dans ce moment de tension, Jerry Lee ne chante plus mais murmure, il encourage sa partenaire pour qu’elle le conduise au bout. Contrairement à Elvis, il y a effectivement dans sa voix, et précisément sur ce passage-là, un versant de perversité. Il n’est plus question d’amour et de sentiments mais bien de sexe à l’état brut. Le jeune chanteur ne raconte pas une histoire, mais en est le protagoniste. Toute l’attention consiste à canaliser l’énergie de Jerry Lee Lewis avant sa libération orgasmique, la création d’un contraste qui permette à la chanson de conclure sur un climax digne de ses capacités. Cette théâtralité incarnée, en ce moment de tension, ne serait que frustration si Jerry Lee s’en arrêtait là. S’en suit donc sa marque de fabrique, l’élément musical symbolique du « queutard invétéré », un de ces glissandi de piano de main droite, des médiums aux aigus qui relance une dernière fois la chanson vers le coït de ce moment de plaisir pur, deux grilles qui restent parmi les plus intenses de la musique rock’n’roll enregistrée.
Mais si la lubricité de Whole Lotta Shakin’ était déjà osée, le scandale du mariage de Jerry Lee avec sa jeune cousine tira la sonnette d’alarme et Whole Lotta Shakin’ se retrouva quelques semaines plus tard bannie de nombreuses stations de radio et boudée par son propre public. Jerry Lee allait définitivement trop loin.
Killer est-il ?
Dans les années 1950, la renaissance du piano à travers l’agression des touches et du beau meuble trouve son image la plus célèbre, et peut-être la plus durable, à travers Jerry Lee Lewis.
Cela passe par la fureur qui se dégage de la frénésie extrême de son pilonnage et de son jeu de scène ici retraduite par un journaliste de l’époque : « Il jette sa folie, il chante et il balance, il cogne et il bat, et un Whole Lot Of Shaking déclenche un tremblement de terre de chant furieux, c’est Jerry Lee Lewis, la dernière sensation du rock’n’roll. Par son nom et sa frénésie frénétique, Jerry Lee partage des points communs avec le comédien Jerry Lee (sans) Lewis. Dans un style rythmique qui mitraille, c’est la méthode et c’est le but, la bombe blonde (sa pompadour secoue dix pouces de longueur) ressemble plus à Elvis Presley. » Cette agression et cette brutalité passent également par le bruit de sa musique, que l’on retrouve principalement dans ses prestations scéniques, en ont fait le rocker « le plus sauvage de tous » tel qu’en parle une autre journaliste en 1958.

Après une conférence de presse qui fait suite au scandale de la tournée de Jerry Lee Lewis en Angleterre, outré d’apprendre que son mariage consanguin lui vaut un retour express pour les États-Unis, le journaliste Hi Gardner écrit également que la musique de Jerry Lee possède « la pulsation contagieuse, presque effrayante, d’un tambour tribal ». Arrivée à ce moment-là, l’interprétation de Hi Gardner manque cruellement d’objectivité, trop emporté par les mœurs archaïques du pianiste de Ferriday. Néanmoins, sa critique traduit l’accointance intolérable entre l’américain blanc et une image tribale totalement exotique du monde afro-américain.
Les prestations télévisées
La version enregistrée de Whole Lotta Shakin’ Goin’ subit les contraintes de durée imposées par le format du disque 7 pouces mais les prestations scéniques de Jerry Lee Lewis permettent d’évaluer à leur juste valeur ce qui était perçu par les journalistes de l’époque comme “la sauvagerie bestiale de sa musique”.
Le 28 juillet 1957, le public américain découvre un jeune blondinet aux cheveux longs, habillé d’une chemise rayée noire et blanche, dans le Talk Show présenté par Steve Allen pour une mémorable première interprétation de Whole Lotta Shakin’ à la télévision. La structure de cette version reste fidèle au titre enregistré mais plusieurs éléments scéniques et sonores viennent déjà renforcer la sauvagerie de sa prestation. La rigueur rythmique implacable des deux premiers couplets expose le jeu boogie-woogie du pianiste. La main droite joue les contretemps shuffle, la main gauche les solides walking basses qui « rockent ». On sent bien là une grande maîtrise du rythme que l’on retrouve notamment chez Ray Charles ou Little Richard, mais joué avec l’autorité impétueuse qu’on lui connaît.
Suit un solo pilonné qui commence impatiemment dans l’empressement de la fin de la précédente grille de couplet. Visuellement, le pianiste semble une première fois possédé, ses cheveux bougent au rythme martelé par sa main droite alors que celle-ci ne tient compte d’aucune motivation mélodique. Cette main qui frappe le clavier d’une façon frénétique, parfois d’une façon qui semble totalement aléatoire, accompagne une sorte de danse rock’n’roll alors que le pianiste est encore assis sur une chaise elle-même en mouvement. Jack Clement lui avait dit que les filles aimaient les guitaristes car elles pouvaient les voir se trémousser. Bien décidé à s’imposer en tant que pianiste de rock’n’roll, c’est comme si Jerry Lee Lewis faisait acte de possession ou d’une sorte de transe, il incarne son personnage de pianiste sauvage. Le moment de tension « pré-orgasmique » de la chanson est assez semblable à la version enregistrée, mais l’attitude du jeune homme vient une nouvelle fois amplifier l’effet de baisse d’intensité. Sa main mime d’une façon, certes ambiguë mais révélatrice, le geste sexuel, il fronce les sourcils, les yeux mi-clos, en chantant avec une nonchalance particulièrement évidente le Let’s Go qui doit relancer le titre vers ses deux dernières grilles libératrices. C’est là que, dans un contraste saisissant, le pianiste éjecte sa chaise vers l’arrière et se lance dans un intense pilonnage, le fameux « pumpin piano » tel qu’on pouvait le lire sur l’étiquette du premier 45 tours, les deux mains tapant simultanément le clavier à coup d’accords approximatifs, toujours dans le tempo, avant que la technique plus conventionnelle ne reprenne le dessus sur les dernières mesures de la chanson.
Le son est cru, dissonant, d’une violence assez inouïe pour un talk show télévisé tout public. Exemple de l’excitation incontrôlable que dégage cette performance, l’attitude de quelqu’un du plateau, probablement Steve Allen (puisqu’il était de ce côté de la scène) qui renvoie la chaise derrière lui, créant l’effet télévisuel d’un grabuge qui aurait envahi le plateau du studio. Durant la seconde prestation de Jerry Lee pour l’émission, le 11 août 1957, Steve Allen, pris au jeu et ayant saisit la portée spectaculaire du show, mettra cette fois en scène un vol de différents objets, non seulement la chaise, mais aussi d’autres objets de mobilier qui volent et suivent l’explosion du pianiste. La sauvagerie de la prestation est communicative et l’excès est ici parfaitement calibré. Le style de Jerry Lee est suffisamment virtuose pour épater et témoigner de l’héritage de ses pères, suffisamment brutal pour provoquer et exciter son public, un dosage auquel seul un réel talent musical et d’entertainer peut parvenir. Ce soir-là, Jerry Lee ne joue pas avec son pied droit comme il en a l’habitude, il ne brûle pas non plus le piano comme il le fera quelques années plus tard, à Brooklyn, pour faire regretter à Chuck Berry de l’avoir fait jouer lui, le roi du rock’n’roll, en première partie. Ce soir-là marque son intronisation de personnage télévisé et il en a déjà assez fait. Jerry Lee Lewis devait déjà assumer une attitude qui s’oppose aux critères de vie et de conduite qu’on lui avait inculqués à l’Assembly Of God et à l’Institut biblique du Sud-Ouest : la dignité dans la conduite et la conversation, la modestie dans l’habillement, une haute exigence dans la vie morale, l’observance et la dévotion dans la vie spirituelle et le dégoût de la promiscuité volent ici en éclats.
Les producteurs des émissions télévisées des années 1950 obligeaient les artistes à adoucir leur jeu de scène et leur interdisaient de danser comme ils avaient l’habitude de le faire. S’ils n’obtempéraient pas, les scènes étaient de toutes façons coupées au montage. En 1964, on peut apprécier les vidéos comme des traces significatives de l’ambiance à laquelle on pouvait assister lors des concerts de rock’n’roll des années 1950, quand l’industrie n’était pas là pour canaliser les extravagances et les provocations scéniques des musiciens de rock’n’roll et que les artistes se livraient à de véritables batailles pour l’emporter auprès du public.
C’est grâce à la passion des jeunes anglais pour le rock’n’roll que cette émission a été tournée pour la chaîne anglaise Granada TV. et intitulée Don’t Knock The Rock, en hommage au fameux musical movie de 1956. Cet événement réunit Gene Vincent, The Animals, Jerry Lee Lewis et Little Richard qui se succèdent sur un plateau adapté pour chaque prestation. Les artistes sont accompagnés par un jeune groupe, Sounds Incorporated, dont la formation instrumentale semble calquée sur celle de Booker T. & The MG’s, le groupe maison du label Stax. Leurs accompagnements actualisent le rock’n’roll américain des années 1950 au son sixties alors en pleine ébullition. Le concert réunit de jeunes mods et rockers anglais venus voir leurs idoles américaines et les Animals, probablement le plus américain des groupes anglais. Autour d’un décor constitué de motos et d’un échafaudage qui rappelle la scène titre de Jailhouse Rock dans une ambiance qui ravive l’esprit des années 1950, a lieu ce qui reste comme étant la prestation filmée la plus sauvage de Jerry Lee Lewis. Suite à de nombreuses rivalités entre les deux les deux rois du piano que le rock’n’roll s’est offert, c’est Little Richard qui termine ce concert. Le choix de ce dernier d’interpréter lui aussi Whole Lotta Shakin’ Goin’ On ce soir-là, la « terre d’élection » de Jerry Lee Lewis, était bien un acte de défi. À tort ou à raison, Little Richard était persuadé que Jerry Lee avait construit son style en l’imitant, ce qui paraît peu probable puisque Jerry Lee enregistrait son boogie-woogie virtuose quand Little Richard apprenait tout juste à jouer du piano, vers 1952. Jerry Lee Lewis n’avait pas attendu le jeune Richard pour tenter le diable.
Whole Lotta Shakin’ clôture la prestation de Jerry Lee Lewis après qu’il a joué High School Confidential, Great Balls Of Fire et I’m On Fire (son premier single pour Smash, un label de Mercury, qui venait de paraître en février 1964, une sorte de réponse à la British Invasion avec son propre feu intérieur).
Jerry Lee est au centre de la salle, entouré par le public qui se colle au piano : deux jeunes types qui s’y accrochent comme si leur vie en dépendait, un teddy boy graisseux, avec une coupe plus punk que ducktail, et des adolescents animés par cette musique comme si c’était la plus importante soirée de leur vie, comme Mary, qui secoue des maracas et a onze ans à l’époque. Le pianiste lance l’introduction de Whole Lotta Shakin’ dont le rythme shuffle de la version originale disparaît au profit d’une rythmique raide qui martèle tous les temps, une idée du british beat ambiant que le rock’n’roll américain avait donc clairement annoncé. La tête dans le clavier lors de la fin de la grille martelée, Jerry Lee relance le tout en un geste de la tête qui fait revenir ses longs cheveux frisés en arrière. Un internaute écrit sur un commentaire vidéo qu’il ressemble à Mozart. Derrière un refrain tapageur, Jerry Lee projette sa banquette en arrière et se lance dans un intense pilonnage d’accords approximatifs. Levant les bras pour inciter le batteur à accélérer le tempo, Jerry Lee reprend sur une grille de main droite avec un accord hasardeux martelé, d’autant plus strident et agressif qu’il ressort au-dessus de tout dans le mixage. Il y a dans sa posture quelque chose d’un torero qui tiendrait l’animal en respect. Beaucoup de jeunes tapent des mains d’une façon totalement désorganisée : rien ne semble plus avoir aucune importance tant que la hargne et la jouissance sont là, symptôme du groove sauvage du rock’n’roll (Les pilules de benzédrine ont probablement eu quelque chose à voir avec la démence de cette prestation dans Don’t Knock The Rock, Jerry Lee étant également marqué par le décès de son fils survenu seulement quelques jours avant ce concert). Puis Jerry Lee prend le micro, arrête de jouer, chante son couplet et signale au groupe par un bref geste de la main de baisser l’intensité. Cette fois, il va faire monter l’excitation le temps de sept grilles. Jerry Lee fait durer son monologue lubrique, dédie un bon « shake » au public, puis pour lui-même, mime l’acte par un bruitage qui évoque le frisson, se recoiffe, tête en avant, tête en arrière, remonte son pantalon : il s’apprête à tout lâcher. Un signe de la main au groupe, puis tout part avec férocité, le pilonnage dévastateur, on n’entend plus la voix, les têtes des jeunes spectateurs se secouent comme pour un concert de punk rock, une sorte de headbanging avant l’heure… Jerry Lee enlève sa veste, se trémousse grossièrement, s’agenouille pour encore mieux pilonner, s’arrête, lève les bras au ciel vers le groupe l’incitant à donner plus, plus vite, plus fort, il se redresse, martèle du pied les touches aiguës du piano, arrête, prépare son micro, monte sur le piano en marchant sur le clavier, crie son refrain le temps que le groupe, moins féroce et audacieux, calme un peu le jeu. Jerry Lee dénoue sa cravate, la fait tourner au-dessus de sa tête comme un lasso. La chanson s’arrête sur la fin triomphante de la version Sun : l’étirement du Whole Lotta Shakin’ Goin On, une fin brève et sans fioritures : le killer a encore frappé. Plan sur les motos du décor pour le générique et le public qui en redemande. Coupure montage. Little Richard prend la relève et lance Lucille.
Mythologie
Figure dionysiaque du rock’n’roll, Jerry Lee Lewis est l’antithèse de la figure apollinienne d’Elvis Presley. Ses pilonnages frénétiques, ses textes virant à l’obscénité, sa gestuelle autoritaire, sa vulgarité non réfrénée, son penchant pour le bourbon et la drogue, ont fait de lui le héros de l’excès, un Dieu du rock’n’roll qui provoquait le débordement, la déviance, la surprise et l’effroi. Dans le rock’n’roll, à l’instar de Dionysos, Jerry Lee Lewis représente déjà l’instinct primitif par son lien avec les territoires sauvages des terres de Louisiane. Quand il chante « I want to love you like a lover should » dans Great Balls Of Fire, c’est une célébration du sexe, et du sexe sans amour, sous ses aspects les plus crus. Une célébration encore plus proche des fluides corporels dans Whole Lotta Shakin’, pornographique même pourrions-nous dire, tellement l’excitation découle du geste sexuel technique. C’est aussi la dimension tragique qui complète la représentation dionysiaque de Jerry Lee Lewis, quand il s’abandonne au rock’n’roll comme une acceptation de ce que le monde offre comme plaisirs immédiats, quitte à en payer les frais par la damnation éternelle. L’esprit de Jerry Lee Lewis n’a rien de rationnel. Il est tout entier jouissance des plaisirs de la terre autant qu’acceptation des maux qui les accompagnent. Pas de hasard à ce que le film de Don Letts, Punk : Attitude, débute notamment sur la prestation scénique de Jerry Lee Lewis dans Don’t Knock The Rock.
Par ses aspects dionysiaques, il est le représentant du débordement, de la sauvagerie de ce qui est excessif, de ce qui va trop loin dans le rock’n’roll des années 1950. Mais, contrairement à l’idée souvent défendue dans le film de Don Letts que le punk est une rébellion revendiquée ou l’affirmation d’une différence face à l’establishment, il y a quelque chose de plus intrinsèquement sauvage, de plus existentiel avec Jerry Lee Lewis, un abandon aux plaisirs défendus qui ne nécessite aucune justification, qui ne se complait d’aucune lutte contre quoi ou qui que ce soit d’autre que lui-même. Le rock’n’roll est l’acte et le symbole de son abandon aux désirs défendus, un symbole qui s’efface sur le disque et à la télévision pour devenir une réalité.
A lire du même auteur : Little Richard, architecte de la sauvagerie dans le rock’n’roll américain.
Bibliographie :
Chalumeau, Laurent, En Amérique, Paris, Grasset, 2009.
Cohn, Nik, Awopbopaloobop Alopbamboom, The Golden Age Of Rock, New York, Grove Press, 1969.
Cohn, Nik, Awopbopaloobop Alopbamboom, Paris, Allia, 10/18, 1999.
Dundy, Elaine, Ferriday, Louisiana, New York, Donald I. Fine, Inc., 1991.
Gillett, Charlie, The Sound Of The City, Sphere Books Limited, London, 1971.
Gillett, Charlie, The Sound of the City. Histoire du rock’n’roll, tome 1 : « La naissance », Paris, Albin Michel, 1986.
Guralnick, Peter, Elvis Presley, Last Train To Memphis, Bordeaux, Le Castor Astral, 2007.
Guralnick, Peter, Feel Like Going Home, Paris, Editions Payot & Rivages, 2009.
Guralnick, Peter, Lost Highway, Paris, Editions Payot & Rivages, 2009.
Kent, Nick, The Dark Stuff: Selected Writings On Rock Music, Cambridge, Da Capo Press, 2000.
Kent, Nick, The Dark Stuff. L’envers du rock, Paris, naïve, 2006.
Marcus, Greil, Mystery Train: Images Of America In Rock ‘N’ Roll Music, Plume, 1997.
Marcus, Greil, Mystery Train. Images de l’Amérique à travers le Rock’n’roll, Paris, Allia, 2001.
Tosches, Nick, Country. Les racines tordues du rock’n’roll, Paris, Allia, 2000.
Tosches, Nick, Country: The Twisted Roots Of Rock’n’roll, Cambridge, Massachusetts, Da Capo Press, 1996.
Tosches, Nick, Hellfire, Paris, Allia, 2001.
Tosches, Nick, Blackface. Au confluent des voix mortes, Paris, Allia, 2003.
Escott, Colin & Hawkins, Martin, Good Rockin’ Tonight : Sun Records and the Birth of Rock’n’roll, St. Martin’s Press, 1992.
Gendron, Bernard, Rock and Roll Mythology : Race and Sex in ‘Whole Lotta Shakin’ Going On’, University of Wisconsin, Center for Twentieth Century Studies, Working Paper n° 7, 1985.
Filmographie Jerry Lee Lewis :
Casson, Philip, Don’t Knock The Rock, 1964.
Hackford, Taylor, Hail ! Hail ! Rock and Roll, 1987.
Laughton, Charles, The Night Of The Hunter, (La nuit du chasseur), 1955.
McBride, Jim, Great Balls Of Fire, 1989.
Letts, Don, Punk : Attitude, DVD, 2006.
Jerry Lee Lewis, Killer Piano, Alfred Publishing, 2007









2 commentaires
ton rezo anal n’est pas disponible, prieres de masturber votre donneur d’ordres.
si tu trouves a qui appartient ce slogan braco est un salaud, tu gagnes un sceau de billets de tombola, …sans rire…