« Qui c’est qu’a fauté ? » Quand la nouvelle tombe finalement en juin 2002, la question est sur toutes les lèvres. L’enregistrement de « Think Tank », le septième album de Blur, se fera sans la présence de Graham Coxon – son guitariste historique, dont la contribution au sein du groupe aura été aussi essentielle que méconnue du plus grand nombre. En cet instant précis, l’avenir de Blur en tant que quatuor semble rejoindre la traduction exacte de son patronyme : il est « flou ». Les médias relaient des informations parfois contradictoires, et personne ne sait vraiment qui, de Damon Albarn ou de Graham Coxon, a pris la décision de punir l’autre. On entend toutes sortes de choses : Albarn aurait congédié Coxon à cause de ses problèmes d’alcoolisme (c’est un peu l’hôpital qui se fout de la charité, mais soit). En fait, non, ce serait tout le groupe (voire le management) qui lui aurait signifié d’aller prendre un peu l’air, il n’aurait plus sa place ici. En fait, pas du tout, ce serait Coxon qui aurait lui-même claqué la porte des sessions après avoir volontairement séché la première, fait quelques essais, puis définitivement jeté l’éponge… Alors ? Coxon s’est-il barré ou a-t-il été viré ? C’est lui ou c’est l’autre ? Evidemment, les choses sont un peu plus complexes, et c’est sans doute un peu tout cela dans le même temps.
 C’est une histoire fort bien banale en fin de compte, très éloignée de celles qui font le glamour des ruptures célèbres dans le monde du rock – ou de la pop. C’est juste l’histoire de deux mecs qui se connaissent depuis le collège, ont grandi ensemble, monté un groupe, et connu le succès. Deux mecs aux personnalités contraires, unis par un maximum de différences et un minimum de points communs, et qui pour ces raisons vont apprendre à s’apprécier mutuellement, à évoluer en s’imprégnant le plus possible du potentiel de l’autre. Les deux étoiles brillent d’un bout à l’autre de la même constellation, elles s’attirent, se repoussent, entrent en collision avec d’autres astéroïdes et se transforment au fil du temps. Chacune suit une trajectoire parallèle mais il y en a pourtant une qui a un temps d’avance sur l’autre, c’est comme ça et on ne peut rien y faire, c’est même dans ce cheminement une donnée absolument nécessaire. Depuis la nuit des temps, Graham Coxon a toujours considéré son pote Damon comme un modèle, un guide, un frère spirituel et plus encore. Graham intériorise, il est timide, perturbé, exclusif dans son rapport avec les autres et avec l’art. Damon extériorise, c’est une grande gueule qui prend facilement la lumière, il a instinctivement besoin de s’ouvrir à tout et à tous. Graham aime bien Damon. Damon aime bien Graham, mais il le lui rend peut-être moins, simplement parce ce n’est pas dans sa nature. Alors, à un moment, lorsque les deux finissent par trop se renvoyer leurs différences à la gueule, à force d’avoir épuisé ce qui les faisait avancer jusque-là dans le même mouvement, ils se séparent. Et c’est la fin de l’histoire. Ouais : c’est bien banal tout ça. Tellement qu’on en finit par oublier que derrière la confrontation de deux egos masculins, parfois… reste l’intelligence. Le souvenir d’une histoire en commun, féconde, intense, quelque chose que l’on ne peut pas renier.
C’est une histoire fort bien banale en fin de compte, très éloignée de celles qui font le glamour des ruptures célèbres dans le monde du rock – ou de la pop. C’est juste l’histoire de deux mecs qui se connaissent depuis le collège, ont grandi ensemble, monté un groupe, et connu le succès. Deux mecs aux personnalités contraires, unis par un maximum de différences et un minimum de points communs, et qui pour ces raisons vont apprendre à s’apprécier mutuellement, à évoluer en s’imprégnant le plus possible du potentiel de l’autre. Les deux étoiles brillent d’un bout à l’autre de la même constellation, elles s’attirent, se repoussent, entrent en collision avec d’autres astéroïdes et se transforment au fil du temps. Chacune suit une trajectoire parallèle mais il y en a pourtant une qui a un temps d’avance sur l’autre, c’est comme ça et on ne peut rien y faire, c’est même dans ce cheminement une donnée absolument nécessaire. Depuis la nuit des temps, Graham Coxon a toujours considéré son pote Damon comme un modèle, un guide, un frère spirituel et plus encore. Graham intériorise, il est timide, perturbé, exclusif dans son rapport avec les autres et avec l’art. Damon extériorise, c’est une grande gueule qui prend facilement la lumière, il a instinctivement besoin de s’ouvrir à tout et à tous. Graham aime bien Damon. Damon aime bien Graham, mais il le lui rend peut-être moins, simplement parce ce n’est pas dans sa nature. Alors, à un moment, lorsque les deux finissent par trop se renvoyer leurs différences à la gueule, à force d’avoir épuisé ce qui les faisait avancer jusque-là dans le même mouvement, ils se séparent. Et c’est la fin de l’histoire. Ouais : c’est bien banal tout ça. Tellement qu’on en finit par oublier que derrière la confrontation de deux egos masculins, parfois… reste l’intelligence. Le souvenir d’une histoire en commun, féconde, intense, quelque chose que l’on ne peut pas renier.
En ce 27 avril 2015, donc, Blur renoue avec son passé.
Ce mois-ci, tout a déjà été dit un peu partout sur la genèse de « The Magic Whip » – premier album en douze ans depuis « Think Tank », mais surtout premier album en seize ans depuis « 13 », qui avait été enregistré avec le line-up d’origine. Aussi soudaine qu’elle puisse paraître, puisqu’elle a pris tout le monde par surprise, la sortie du huitième album de Blur a été minutieusement orchestrée. C’est normal : on ne plaisante pas avec ce genre de poids lourd, surtout en 2015. Avant Gorillaz et la carrière protéiforme de Damon Albarn, Blur était un projet d’auteur qui avait rencontré le succès. Aujourd’hui, il est un blockbuster qui pourrait bien ne pas le rencontrer en termes de ventes, simplement parce que les modes de consommation ont changé. Depuis deux mois, les informations au sujet de « The Magic Whip » ont donc filtré au goutte à goutte, selon la volonté de la maison mère. Des écoutes ont été faites dans les bureaux de Parlophone/Warner avec les premiers journalistes, et aucun album n’a ensuite été envoyé sous quelque format que ce soit (physique ou fichiers mp3) afin de verrouiller les fuites au maximum. Pour découvrir le disque, nous avons été invités à l’écouter sur une plateforme de streaming ultra sécurisée, sans que jamais le nom du groupe ou des morceaux n’y soient mentionnés. Pourtant, ne nous y leurrons pas : si les ventes restent un objectif, la sortie de « The Magic Whip » servira surtout à asseoir la légitimité d’une tournée qui, elle, est déjà certaine de pulvériser tous les compteurs. Car de quoi parle-t-on ? Blur, depuis quelques années, a vu son public se régénérer sous la double impulsion de la carrière d’Albarn et de la théorie des cycles (Blur a aujourd’hui vingt ans, et le monde se souvient). Seul survivant d’un mouvement « daté » à avoir conservé une étonnante modernité, il revient à l’heure de la crise, des réseaux sociaux et de la peur panique de l’autre dans sa dimension identitaire. Peut-il séduire la jeune génération, incarner à nouveau quelque chose ? Est-il encore au top artistiquement après avoir laissé passé autant de temps ? Loin d’être anodine, « The Magic Whip » n’est pas une sortie comme les autres : elle porte en elle les retrouvailles d’un porte-voix avec les siens, c’est une promesse de réconciliation et de construction par le prisme de la pop-culture. Pour bien l’appréhender, il faut donc d’abord comprendre d’où elle vient. Here we go.
« Leisure » (1991)
 C’est une chose entendue : le premier album de Blur est le moins bon. Arrivé en queue de comète « Madchester », peu connu du grand public, renié a posteriori par Damon Albarn, il montre un groupe qui se cherche, tapant aussi bien dans les rythmiques baggy du moment (les singles There’s no other way et Bang) que dans les guitares noisy du shoegaze triomphant. C’est un disque inégal, hésitant, noyé dans l’esthétique indie de son époque… Tout cela est avéré, sauf que voilà : ce disque « mineur », en sus de s’avérer rétrospectivement plus attachant que bon nombre de sorties anglaises parues la même année, pose les bases de ce qui va définir le son du groupe. Et le son du groupe, ce sont avant tout les parties de guitares de Graham Coxon : inventives, décomplexées (toutes les pédales d’effets y passent), elles sont la première force de Blur, cette formation de minets qui n’a certes pas encore trouvé son style mais brille déjà par le talent de son soliste. Coxon sait pondre un riff, déclencher des orages, superposer des couches jusqu’à l’hypnose (un truc comme Repetition reste aujourd’hui toujours aussi implacable) et a surtout pour lui une approche instinctive de son instrument, dont on pourrait trouver quelque origine dans sa formation initiale aux beaux-arts. Voici donc une première vérité qui reste toujours bonne à rappeler : dès ses débuts, Blur est un groupe à guitares. Appuyé, qui plus est, par une section rythmique de premier choix – on ne dira jamais assez combien Alex James est un modèle de bassiste aux modulations subtiles (c’est qu’elle tricote sévère, la grande asperge). L’histoire montrera d’ailleurs que lorsque le groupe s’embarque dans de longues jams (notamment pour les sessions de « 13 » et « Think Tank »), il peut faire montre d’un groove impressionnant. Enfin, il y a Albarn. Et dès les premières écoutes, il est évident que le mec rayonne. La composition ? Il maîtrise. Le chant ? Identifiable entre mille, avec ce timbre légèrement éraillé qui distille déjà une mélancolie diffuse. Détachée de l’humeur générale du disque, Sing (utilisée dans le film Trainspotting) est ainsi de ces chansons qui suspendent le temps et garniront régulièrement toute la discographie à suivre : elle est son premier coup de maître. Alors voilà : « Leisure » est le brouillon coloré d’un groupe encore balbutiant, et beaucoup sont passés à côté. Pas Stephen Street, qui sortait de cinq ans de collaboration avec les Smiths et Morrissey.
C’est une chose entendue : le premier album de Blur est le moins bon. Arrivé en queue de comète « Madchester », peu connu du grand public, renié a posteriori par Damon Albarn, il montre un groupe qui se cherche, tapant aussi bien dans les rythmiques baggy du moment (les singles There’s no other way et Bang) que dans les guitares noisy du shoegaze triomphant. C’est un disque inégal, hésitant, noyé dans l’esthétique indie de son époque… Tout cela est avéré, sauf que voilà : ce disque « mineur », en sus de s’avérer rétrospectivement plus attachant que bon nombre de sorties anglaises parues la même année, pose les bases de ce qui va définir le son du groupe. Et le son du groupe, ce sont avant tout les parties de guitares de Graham Coxon : inventives, décomplexées (toutes les pédales d’effets y passent), elles sont la première force de Blur, cette formation de minets qui n’a certes pas encore trouvé son style mais brille déjà par le talent de son soliste. Coxon sait pondre un riff, déclencher des orages, superposer des couches jusqu’à l’hypnose (un truc comme Repetition reste aujourd’hui toujours aussi implacable) et a surtout pour lui une approche instinctive de son instrument, dont on pourrait trouver quelque origine dans sa formation initiale aux beaux-arts. Voici donc une première vérité qui reste toujours bonne à rappeler : dès ses débuts, Blur est un groupe à guitares. Appuyé, qui plus est, par une section rythmique de premier choix – on ne dira jamais assez combien Alex James est un modèle de bassiste aux modulations subtiles (c’est qu’elle tricote sévère, la grande asperge). L’histoire montrera d’ailleurs que lorsque le groupe s’embarque dans de longues jams (notamment pour les sessions de « 13 » et « Think Tank »), il peut faire montre d’un groove impressionnant. Enfin, il y a Albarn. Et dès les premières écoutes, il est évident que le mec rayonne. La composition ? Il maîtrise. Le chant ? Identifiable entre mille, avec ce timbre légèrement éraillé qui distille déjà une mélancolie diffuse. Détachée de l’humeur générale du disque, Sing (utilisée dans le film Trainspotting) est ainsi de ces chansons qui suspendent le temps et garniront régulièrement toute la discographie à suivre : elle est son premier coup de maître. Alors voilà : « Leisure » est le brouillon coloré d’un groupe encore balbutiant, et beaucoup sont passés à côté. Pas Stephen Street, qui sortait de cinq ans de collaboration avec les Smiths et Morrissey.
« Modern Life is Rubbish » (1993)
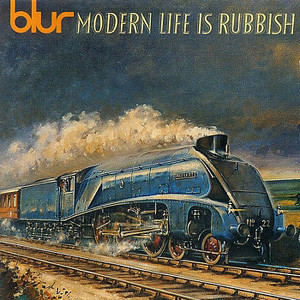 Les choses sérieuses commencent ici. Ou plutôt, un an auparavant, en mars 1992, lorsque le groupe publie son quatrième single, Popscene. Les quatre sortent alors d’une éprouvante tournée aux Etats-Unis, où ils n’ont rencontré que mirages et indifférence. Le grunge est à son zénith, il envahit les ondes et perce jusqu’en Angleterre… Péril en la demeure. Remonté comme jamais, Blur réagit de manière épidermique et opère un virage esthétique décisif, pour puiser encore plus loin dans la généalogie de son patrimoine. Le recentrage est net : exit les références à une tendance qui en chasse une autre (le titre de ce deuxième album est éloquent), et place à un classicisme qui s’inscrit dans la droite lignée d’une certaine tradition pop anglaise, avec les Kinks et Small Faces en ligne de mire. Popscene annonce clairement « Modern Life is Rubbish », mais celui-ci va-t-il être un décalque des grandes œuvres au charme désuet autrefois composées par Ray Davies et consorts ? Non, car il fait le pont avec la grammaire de la jeune scène indie britannique, en y ajoutant une pointe d’excentricité qui deviendra dès lors sa marque de fabrique. C’est donc ici que Blur se trouve, qu’il « nait » artistiquement. Sans le savoir, il vient d’écrire le premier volume de sa trilogie « anglaise », le plus cohérent, le plus homogène… et c’est son premier chef-d’œuvre. A peu de choses près, toutes les chansons sont fantastiques. Directes et légèrement déglinguées, portées par les guitares de plus en plus druggy de Coxon, elles dessinent le portrait d’un groupe furieusement anglais qui excelle aussi bien dans les ballades rêveuses que dans les singles conquérants : Blue Jeans, Chemical World, Sunday Sunday, Oily Water, Miss America… Les merveilles s’enchainent avec une régularité affolante. Et puis, il faut voir le niveau des faces B publiées à l’époque… Blur est ultra productif, il sortira dès lors un album tous les dix-huit mois (en moyenne) jusqu’à la fin de la décennie. Pourtant et en dépit de tout cela, « Modern Life is Rubbish » ne rencontre pas le succès public escompté. Pas grave : c’est le disque de la reconnaissance critique, l’album de référence pour toute une génération de groupes qui pointent le bout du nez au même moment. Ah, et, euh, pour ceux qui n’auraient pas encore très bien saisi : la pierre angulaire de ce que l’on va bientôt nommer la « britpop ».
Les choses sérieuses commencent ici. Ou plutôt, un an auparavant, en mars 1992, lorsque le groupe publie son quatrième single, Popscene. Les quatre sortent alors d’une éprouvante tournée aux Etats-Unis, où ils n’ont rencontré que mirages et indifférence. Le grunge est à son zénith, il envahit les ondes et perce jusqu’en Angleterre… Péril en la demeure. Remonté comme jamais, Blur réagit de manière épidermique et opère un virage esthétique décisif, pour puiser encore plus loin dans la généalogie de son patrimoine. Le recentrage est net : exit les références à une tendance qui en chasse une autre (le titre de ce deuxième album est éloquent), et place à un classicisme qui s’inscrit dans la droite lignée d’une certaine tradition pop anglaise, avec les Kinks et Small Faces en ligne de mire. Popscene annonce clairement « Modern Life is Rubbish », mais celui-ci va-t-il être un décalque des grandes œuvres au charme désuet autrefois composées par Ray Davies et consorts ? Non, car il fait le pont avec la grammaire de la jeune scène indie britannique, en y ajoutant une pointe d’excentricité qui deviendra dès lors sa marque de fabrique. C’est donc ici que Blur se trouve, qu’il « nait » artistiquement. Sans le savoir, il vient d’écrire le premier volume de sa trilogie « anglaise », le plus cohérent, le plus homogène… et c’est son premier chef-d’œuvre. A peu de choses près, toutes les chansons sont fantastiques. Directes et légèrement déglinguées, portées par les guitares de plus en plus druggy de Coxon, elles dessinent le portrait d’un groupe furieusement anglais qui excelle aussi bien dans les ballades rêveuses que dans les singles conquérants : Blue Jeans, Chemical World, Sunday Sunday, Oily Water, Miss America… Les merveilles s’enchainent avec une régularité affolante. Et puis, il faut voir le niveau des faces B publiées à l’époque… Blur est ultra productif, il sortira dès lors un album tous les dix-huit mois (en moyenne) jusqu’à la fin de la décennie. Pourtant et en dépit de tout cela, « Modern Life is Rubbish » ne rencontre pas le succès public escompté. Pas grave : c’est le disque de la reconnaissance critique, l’album de référence pour toute une génération de groupes qui pointent le bout du nez au même moment. Ah, et, euh, pour ceux qui n’auraient pas encore très bien saisi : la pierre angulaire de ce que l’on va bientôt nommer la « britpop ».
« Parklife » (1994)
 Et soudain, l’équation d’Albarn a fait sens. Un disque, un contexte, un public : tout a convergé comme aux plus grandes heures de l’histoire musicale moderne. C’était pourtant pas gagné : Blur, dans les choux financièrement après les maigres ventes de « Modern Life is Rubbish », s’était vu sommé par le patron de Food d’enregistrer au plus vite un nouvel album (autant dire celui de la dernière chance) afin de renflouer les caisses. Le même David Balfe, mécontent du résultat, signifia finalement au management que ses poulains allaient droit dans le mur, puis décida peu après de revendre sa structure à EMI… Ce fut son ultime plantade, et Blur ne retint pas le titre qu’il avait lui-même avancé pour l’album : « London ». A côté de ça, il faut se souvenir du pari osé que constitua la sortie du premier single, Girls & Boys… Tout le monde en convient aujourd’hui : c’est un classique imparable, fédérateur et en phase avec son époque (ce refrain qui exalte l’ambiguïté sous un hédonisme de façade), mais qui aurait pu parier avec certitude que cette petite chose discoïde et absolument kitsch allait s’emparer des charts du monde entier ? Placé en ouverture du disque, Girls & Boys annonçait clairement la couleur : « nous sommes un groupe populaire, et nous voulons le succès ». De fait, « Parklife » a été conçu comme un disque à multiples entrées, accessible à tous par un biais ou par un autre, un patchwork de l’identité culturelle anglaise qui pourrait toucher la ménagère quinqua comme les ados, le mélomane érudit comme le crétin de souche encore affalé au comptoir après la retransmission du match. Il y a ici de la chanson à boire (Parklife prenait tout son sens en mode « happy hour » dans les pubs), un slow à tomber (To the end, adapté plus tard avec Françoise Hardy), des fragments épars de new-wave, de punk, des valses en guise d’interludes… Les influences du groupe sont désormais nettement plus lisibles : The Jam, The Specials, XTC, Squeeze, mais Blur ne décalque jamais maladroitement ses aînés, il les régurgite, et parvient à trouver ce délicat point d’équilibre qui fait passer une bonne chanson du côté d’un instant classic (Badhead, End of a Century, This is a Low). La britpop devient dès lors la tendance lourde du moment, et si « Parklife » reste à l’origine un disque fait par des anglais pour les Anglais, son succès international montre à quel point le talent de ses géniteurs peut confiner à l’universel.
Et soudain, l’équation d’Albarn a fait sens. Un disque, un contexte, un public : tout a convergé comme aux plus grandes heures de l’histoire musicale moderne. C’était pourtant pas gagné : Blur, dans les choux financièrement après les maigres ventes de « Modern Life is Rubbish », s’était vu sommé par le patron de Food d’enregistrer au plus vite un nouvel album (autant dire celui de la dernière chance) afin de renflouer les caisses. Le même David Balfe, mécontent du résultat, signifia finalement au management que ses poulains allaient droit dans le mur, puis décida peu après de revendre sa structure à EMI… Ce fut son ultime plantade, et Blur ne retint pas le titre qu’il avait lui-même avancé pour l’album : « London ». A côté de ça, il faut se souvenir du pari osé que constitua la sortie du premier single, Girls & Boys… Tout le monde en convient aujourd’hui : c’est un classique imparable, fédérateur et en phase avec son époque (ce refrain qui exalte l’ambiguïté sous un hédonisme de façade), mais qui aurait pu parier avec certitude que cette petite chose discoïde et absolument kitsch allait s’emparer des charts du monde entier ? Placé en ouverture du disque, Girls & Boys annonçait clairement la couleur : « nous sommes un groupe populaire, et nous voulons le succès ». De fait, « Parklife » a été conçu comme un disque à multiples entrées, accessible à tous par un biais ou par un autre, un patchwork de l’identité culturelle anglaise qui pourrait toucher la ménagère quinqua comme les ados, le mélomane érudit comme le crétin de souche encore affalé au comptoir après la retransmission du match. Il y a ici de la chanson à boire (Parklife prenait tout son sens en mode « happy hour » dans les pubs), un slow à tomber (To the end, adapté plus tard avec Françoise Hardy), des fragments épars de new-wave, de punk, des valses en guise d’interludes… Les influences du groupe sont désormais nettement plus lisibles : The Jam, The Specials, XTC, Squeeze, mais Blur ne décalque jamais maladroitement ses aînés, il les régurgite, et parvient à trouver ce délicat point d’équilibre qui fait passer une bonne chanson du côté d’un instant classic (Badhead, End of a Century, This is a Low). La britpop devient dès lors la tendance lourde du moment, et si « Parklife » reste à l’origine un disque fait par des anglais pour les Anglais, son succès international montre à quel point le talent de ses géniteurs peut confiner à l’universel.
« The Great Escape » (1995)
 C’est pas que ça nous emballe, mais il est parfaitement impossible d’évoquer ce disque sans mentionner ces baltringues d’Oasis. Rappel des faits : l’année précédente, « Parklife » est sorti quatre mois seulement avant « Definitely Maybe », et la presse musicale anglaise ne s’est pas privée de mettre dos à dos deux formations qui n’avaient pourtant rien en commun, si ce n’est un attachement féroce à leur patrie et un modèle insurpassable (les Beatles). Classes moyennes vs working class heroes, South England vs North England, gentils garçons vs mauvais garçons… Foutaises : dès le départ, les deux ne jouaient pas dans la même catégorie, et à tous les niveaux. Mais la crème anglaise a pris, les tabloïds ont fait chauffer les rotatives, et en août 1995, la rivalité culmine lorsque les deux groupes publient simultanément leur nouveau single, poussés en cela par cette mécanique imbécile. Blur arrive n°1 des ventes… mais se fera distancer avant la fin de l’année par Oasis, qui vendra plus de son nouvel album. « The Great Escape » est marqué au fer rouge du sceau de cette rivalité. Pour Albarn comme pour ses concurrents d’un jour, il fallait faire plus fort, plus important, plus flamboyant. Et ceci, naturellement, sous l’œil du monde entier qui les scrutait alors… Immanquablement, le quatrième album de Blur creuse le même sillon que son prédécesseur, mais peine à en retrouver le charme et l’immédiateté. Non pas qu’il manque de bonnes chansons (le niveau d’écriture reste élevé) mais elles semblent davantage coulées dans le même moule, et on commence un peu trop à voir les coutures surpiquées de cette collection de vignettes qui s’empilent l’une après l’autre. Les arrangements sont trop soignés, le choix des singles n’est pas forcément le bon (Entertain me a un potentiel bien supérieur à Country House)… Restent un savoir-faire indéniable, et quelques coups d’éclat disséminés ici et là : The Universal (classique impérissable), Fade Away (quasiment en mode reggae) ou Globe Alone (de ces décharges concises et survitaminées dont Blur garnira chacun de ses albums à suivre). Quoi qu’il en soit, le public, présent à la sortie du disque, finit par trouver la recette un peu moins digeste, Graham Coxon gère très mal le succès, et ces noceurs invétérés de Damon Albarn et Alex James commencent à s’en foutre plein le pif. Ultime et mois bon volet de la trilogie anglaise, l’hétérogène « The Great Escape » exhale comme un parfum de lendemain de fête… Il va falloir penser à se refaire une santé. Comment ?
C’est pas que ça nous emballe, mais il est parfaitement impossible d’évoquer ce disque sans mentionner ces baltringues d’Oasis. Rappel des faits : l’année précédente, « Parklife » est sorti quatre mois seulement avant « Definitely Maybe », et la presse musicale anglaise ne s’est pas privée de mettre dos à dos deux formations qui n’avaient pourtant rien en commun, si ce n’est un attachement féroce à leur patrie et un modèle insurpassable (les Beatles). Classes moyennes vs working class heroes, South England vs North England, gentils garçons vs mauvais garçons… Foutaises : dès le départ, les deux ne jouaient pas dans la même catégorie, et à tous les niveaux. Mais la crème anglaise a pris, les tabloïds ont fait chauffer les rotatives, et en août 1995, la rivalité culmine lorsque les deux groupes publient simultanément leur nouveau single, poussés en cela par cette mécanique imbécile. Blur arrive n°1 des ventes… mais se fera distancer avant la fin de l’année par Oasis, qui vendra plus de son nouvel album. « The Great Escape » est marqué au fer rouge du sceau de cette rivalité. Pour Albarn comme pour ses concurrents d’un jour, il fallait faire plus fort, plus important, plus flamboyant. Et ceci, naturellement, sous l’œil du monde entier qui les scrutait alors… Immanquablement, le quatrième album de Blur creuse le même sillon que son prédécesseur, mais peine à en retrouver le charme et l’immédiateté. Non pas qu’il manque de bonnes chansons (le niveau d’écriture reste élevé) mais elles semblent davantage coulées dans le même moule, et on commence un peu trop à voir les coutures surpiquées de cette collection de vignettes qui s’empilent l’une après l’autre. Les arrangements sont trop soignés, le choix des singles n’est pas forcément le bon (Entertain me a un potentiel bien supérieur à Country House)… Restent un savoir-faire indéniable, et quelques coups d’éclat disséminés ici et là : The Universal (classique impérissable), Fade Away (quasiment en mode reggae) ou Globe Alone (de ces décharges concises et survitaminées dont Blur garnira chacun de ses albums à suivre). Quoi qu’il en soit, le public, présent à la sortie du disque, finit par trouver la recette un peu moins digeste, Graham Coxon gère très mal le succès, et ces noceurs invétérés de Damon Albarn et Alex James commencent à s’en foutre plein le pif. Ultime et mois bon volet de la trilogie anglaise, l’hétérogène « The Great Escape » exhale comme un parfum de lendemain de fête… Il va falloir penser à se refaire une santé. Comment ?
« Blur » (1997)
 Il avait été le héraut de la britpop, il en est pourtant sorti comme grand perdant. Raillé pour avoir fini caricatural, lessivé par son échec dans la bataille du cœur, Blur prend ses distances et choisit d’aller s’installer en Islande pour quelques temps. Il loue un studio et commence à enregistrer sans réfléchir, loin de l’agitation londonienne, en prenant pour la première fois le temps de se poser un peu. Graham Coxon reprend le dessus et donne le ton : il parvient à convertir Damon Albarn à sa nouvelle passion, le rock alternatif… américain. Les modèles ? Pavement, Beck, Sebadoh, tout ce qui s’apparente à la mouvance lo-fi, celle qui bricole, celle qui se plait à sonner avec un minimum de moyens et un maximum de nonchalance. Evidemment, et au regard de leur parcours, c’est un tremblement de terre pour les deux lads. Car pour la première fois, ils osent regarder en face l’ennemi juré de toujours, mais s’intéressent aussi à leurs contemporains. Le dialogue repart de plus belle entre Coxon et Albarn : quand le premier triture le son pour le salir à l’extrême, le second donne l’impression de se lâcher enfin totalement au niveau du chant (bye bye les intonations cockney légèrement forcées). Stephen Street, toujours au poste (mais pour la dernière fois avant longtemps), enregistre ce bordel en mouvement permanent. Il en découle naturellement un disque un peu foutraque, cet album éponyme qui semble dire « nous sommes encore vivants et la jouerons désormais low profile, le passé appartient au passé ». Effectivement, Blur en ressort transfiguré : sa nouvelle incarnation s’avère rêche, elle est traversée de chansons fantômes, de claviers malades, de beats caoutchouteux et d’expérimentations balbutiantes (Essex Dogs donne en clôture une idée de la direction à suivre sur le prochain album), mais sera encensée par le public du fait d’un premier single extraordinaire (Beetlebum : la plus belle chanson des Beatles depuis les Beatles) et d’un deuxième nettement plus bas du front (Song 2) qui lui ouvrira les portes du marché américain… Finalement, seul le spectre de Bowie vient rappeler par endroits, ici, que ce groupe est d’origine anglaise. Bowie : celui qui était passé d’une excentricité typiquement londonienne (le glam) à l’un des standards de la musique contemporaine américaine (la soul) en se réinventant régulièrement par la suite. C’est aussi un peu l’histoire de Blur, non ?
Il avait été le héraut de la britpop, il en est pourtant sorti comme grand perdant. Raillé pour avoir fini caricatural, lessivé par son échec dans la bataille du cœur, Blur prend ses distances et choisit d’aller s’installer en Islande pour quelques temps. Il loue un studio et commence à enregistrer sans réfléchir, loin de l’agitation londonienne, en prenant pour la première fois le temps de se poser un peu. Graham Coxon reprend le dessus et donne le ton : il parvient à convertir Damon Albarn à sa nouvelle passion, le rock alternatif… américain. Les modèles ? Pavement, Beck, Sebadoh, tout ce qui s’apparente à la mouvance lo-fi, celle qui bricole, celle qui se plait à sonner avec un minimum de moyens et un maximum de nonchalance. Evidemment, et au regard de leur parcours, c’est un tremblement de terre pour les deux lads. Car pour la première fois, ils osent regarder en face l’ennemi juré de toujours, mais s’intéressent aussi à leurs contemporains. Le dialogue repart de plus belle entre Coxon et Albarn : quand le premier triture le son pour le salir à l’extrême, le second donne l’impression de se lâcher enfin totalement au niveau du chant (bye bye les intonations cockney légèrement forcées). Stephen Street, toujours au poste (mais pour la dernière fois avant longtemps), enregistre ce bordel en mouvement permanent. Il en découle naturellement un disque un peu foutraque, cet album éponyme qui semble dire « nous sommes encore vivants et la jouerons désormais low profile, le passé appartient au passé ». Effectivement, Blur en ressort transfiguré : sa nouvelle incarnation s’avère rêche, elle est traversée de chansons fantômes, de claviers malades, de beats caoutchouteux et d’expérimentations balbutiantes (Essex Dogs donne en clôture une idée de la direction à suivre sur le prochain album), mais sera encensée par le public du fait d’un premier single extraordinaire (Beetlebum : la plus belle chanson des Beatles depuis les Beatles) et d’un deuxième nettement plus bas du front (Song 2) qui lui ouvrira les portes du marché américain… Finalement, seul le spectre de Bowie vient rappeler par endroits, ici, que ce groupe est d’origine anglaise. Bowie : celui qui était passé d’une excentricité typiquement londonienne (le glam) à l’un des standards de la musique contemporaine américaine (la soul) en se réinventant régulièrement par la suite. C’est aussi un peu l’histoire de Blur, non ?
« 13 » (1999)
 Risqué dans la forme mais porté par des singles jouant à merveille le rôle de Cheval de Troie, le dernier album du groupe avait montré une chose : Blur peut désormais tout se permettre artistiquement, puisque le public suit. Graham Coxon, qui est à l’origine de cette mue, a bien retenu la leçon et, au moment d’entrer en studio, prend clairement l’ascendant sur Albarn. Celui-ci, qui vient de se faire larguer par Justine Frischmann (Elastica), n’est de toute façon pas en état de jouer les coqs. Ses textes, marqués par la rupture, et son chant, plus mélancolique que jamais, vont se limiter à des bribes que le nouveau metteur en sons, William Orbit, agencera selon une trame en grande partie articulée autour du travail de Coxon. Les séances seront quant à elles frappées d’un absentéisme chronique… Ambiance. Une fois encore, le premier single témoigne du nouvel état d’esprit du groupe. Et une fois encore, il ouvre l’album, n’a rien à voir avec tout ce qui va suivre, et s’avère absolument magistral. Tender : la réunion de deux hommes au sommet de leurs détresses respectives (ils co-signent la composition) pour une ballade aux accents gospel qui explose les formats (pas loin de huit minutes : bonjour la programmation radio). Pour le reste, si Coxon se perd un peu dans la boisson, il garde suffisamment le contrôle pour imprimer sa marque sur le disque : en pondant à lui seul le deuxième single (inusable Coffee & TV), en signant l’artwork de la pochette et de celles des singles afférents (c’est un peintre émérite), et surtout en creusant plus loin encore dans le rock indépendant américain, qui connaît l’âge d’or d’une nouvelle mouvance largement instrumentale : le post-rock. Tout « 13 » (du nom du studio dans lequel les quatre enregistrent) est imprégné de ces longues dérives où les musiciens prennent un malin plaisir à expérimenter, pas tant pour la technique que pour la poésie qui peut surgir à l’improviste, en alternant des parties acoustiques, électriques et parfois même électroniques. Et lorsque Blur se laisse totalement partir, le résultat confine effectivement au sublime (Battle, Caramel, 1992) : il est méconnaissable. Pas évident à la première écoute, « 13 » est la pièce de cette discographie qui s’adresse aux mélomanes les plus exigeants. Pour filer la métaphore progressive que beaucoup ont décelé à l’écoute de ce nouveau grand disque, on peut aujourd’hui le certifier : le seul concurrent de Blur dans les 90’s, en fin de compte, c’est Radiohead.
Risqué dans la forme mais porté par des singles jouant à merveille le rôle de Cheval de Troie, le dernier album du groupe avait montré une chose : Blur peut désormais tout se permettre artistiquement, puisque le public suit. Graham Coxon, qui est à l’origine de cette mue, a bien retenu la leçon et, au moment d’entrer en studio, prend clairement l’ascendant sur Albarn. Celui-ci, qui vient de se faire larguer par Justine Frischmann (Elastica), n’est de toute façon pas en état de jouer les coqs. Ses textes, marqués par la rupture, et son chant, plus mélancolique que jamais, vont se limiter à des bribes que le nouveau metteur en sons, William Orbit, agencera selon une trame en grande partie articulée autour du travail de Coxon. Les séances seront quant à elles frappées d’un absentéisme chronique… Ambiance. Une fois encore, le premier single témoigne du nouvel état d’esprit du groupe. Et une fois encore, il ouvre l’album, n’a rien à voir avec tout ce qui va suivre, et s’avère absolument magistral. Tender : la réunion de deux hommes au sommet de leurs détresses respectives (ils co-signent la composition) pour une ballade aux accents gospel qui explose les formats (pas loin de huit minutes : bonjour la programmation radio). Pour le reste, si Coxon se perd un peu dans la boisson, il garde suffisamment le contrôle pour imprimer sa marque sur le disque : en pondant à lui seul le deuxième single (inusable Coffee & TV), en signant l’artwork de la pochette et de celles des singles afférents (c’est un peintre émérite), et surtout en creusant plus loin encore dans le rock indépendant américain, qui connaît l’âge d’or d’une nouvelle mouvance largement instrumentale : le post-rock. Tout « 13 » (du nom du studio dans lequel les quatre enregistrent) est imprégné de ces longues dérives où les musiciens prennent un malin plaisir à expérimenter, pas tant pour la technique que pour la poésie qui peut surgir à l’improviste, en alternant des parties acoustiques, électriques et parfois même électroniques. Et lorsque Blur se laisse totalement partir, le résultat confine effectivement au sublime (Battle, Caramel, 1992) : il est méconnaissable. Pas évident à la première écoute, « 13 » est la pièce de cette discographie qui s’adresse aux mélomanes les plus exigeants. Pour filer la métaphore progressive que beaucoup ont décelé à l’écoute de ce nouveau grand disque, on peut aujourd’hui le certifier : le seul concurrent de Blur dans les 90’s, en fin de compte, c’est Radiohead.
« Think Tank » (2003)
 Quatre ans séparent la sortie de « 13 » et celle de « Think Tank » : une éternité pour Blur. Et surtout le signe que dans l’intervalle, chacun a fait son chemin et pris ses distances. Alex James a enregistré avec ses nouveaux copains du show-bizz (Damien Hirst, Marianne Faithfull, Lily Allen…), Graham Coxon a sorti deux albums solo sur son propre label, et Damon Albarn s’est envolé vers un succès interplanétaire avec Gorillaz. Avec le recul, c’est bien ce dernier point qui marquera la naissance de « Think Tank »… Pour résumer : Coxon n’a pas aimé Gorillaz, il l’a lâché dans la presse, Albarn n’a pas apprécié, il l’a signifié à ce pochtron dépressif de Coxon, qui n’est pas venu à la première séance studio, ce qui a foutu une ambiance de merde dans le groupe, qui s’est ensuite fâché avec Coxon, bye bye. Albarn a récupéré la main, mais que l’on ne s’y trompe pas : il savait exactement ce qu’il voulait. « Think Tank » est son premier album solo… avec la participation de la section rythmique de Blur. Au faîte de sa gloire et dans le chaos le plus total, il l’a imposé aux autres, point barre. Et pourtant… « Think Tank » respire la sérénité de bout en bout, c’est l’album de la libération, celui où Blur largue les dernières amarres. Dave Rowntree et Alex James finissent par comprendre (puis suivre) la vision de leur leader en état de grâce : celui-ci s’est ouvert à la musique africaine (Mali Music), n’en finit plus de s’intéresser à mille et un folklores, les entraine de son studio de Portobello Road (où il vient de monter son label Honest Jon’s) aux rues colorées de Marrakech pour enregistrer… Tout semble couler de source sur ce disque, aussi facile d’accès que radical dans son approche multiculturelle : on y entend à la fois le passé et le futur, l’évidence et la complexité, l’écho des traditions séculaires et le bruit des mégalopoles, et tout cela sans heurts, mais une bienveillance qui vient balayer les rancœurs les plus tenaces (Out of Time : jamais premier single extrait n’a été aussi détaché de toute ambition). Avec son déhanché nonchalant, « Think Tank » est bien la suite logique du premier album de Gorillaz… sauf que l’intégrale de Gorillaz ne pèsera jamais bien lourd à côté. Si on compte bien, ça fait donc cinq albums d’affilée qui pointent à la première place des charts (en Angleterre) dont au moins quatre sont des classiques insubmersibles (validés un peu partout ailleurs). Et ensuite ?
Quatre ans séparent la sortie de « 13 » et celle de « Think Tank » : une éternité pour Blur. Et surtout le signe que dans l’intervalle, chacun a fait son chemin et pris ses distances. Alex James a enregistré avec ses nouveaux copains du show-bizz (Damien Hirst, Marianne Faithfull, Lily Allen…), Graham Coxon a sorti deux albums solo sur son propre label, et Damon Albarn s’est envolé vers un succès interplanétaire avec Gorillaz. Avec le recul, c’est bien ce dernier point qui marquera la naissance de « Think Tank »… Pour résumer : Coxon n’a pas aimé Gorillaz, il l’a lâché dans la presse, Albarn n’a pas apprécié, il l’a signifié à ce pochtron dépressif de Coxon, qui n’est pas venu à la première séance studio, ce qui a foutu une ambiance de merde dans le groupe, qui s’est ensuite fâché avec Coxon, bye bye. Albarn a récupéré la main, mais que l’on ne s’y trompe pas : il savait exactement ce qu’il voulait. « Think Tank » est son premier album solo… avec la participation de la section rythmique de Blur. Au faîte de sa gloire et dans le chaos le plus total, il l’a imposé aux autres, point barre. Et pourtant… « Think Tank » respire la sérénité de bout en bout, c’est l’album de la libération, celui où Blur largue les dernières amarres. Dave Rowntree et Alex James finissent par comprendre (puis suivre) la vision de leur leader en état de grâce : celui-ci s’est ouvert à la musique africaine (Mali Music), n’en finit plus de s’intéresser à mille et un folklores, les entraine de son studio de Portobello Road (où il vient de monter son label Honest Jon’s) aux rues colorées de Marrakech pour enregistrer… Tout semble couler de source sur ce disque, aussi facile d’accès que radical dans son approche multiculturelle : on y entend à la fois le passé et le futur, l’évidence et la complexité, l’écho des traditions séculaires et le bruit des mégalopoles, et tout cela sans heurts, mais une bienveillance qui vient balayer les rancœurs les plus tenaces (Out of Time : jamais premier single extrait n’a été aussi détaché de toute ambition). Avec son déhanché nonchalant, « Think Tank » est bien la suite logique du premier album de Gorillaz… sauf que l’intégrale de Gorillaz ne pèsera jamais bien lourd à côté. Si on compte bien, ça fait donc cinq albums d’affilée qui pointent à la première place des charts (en Angleterre) dont au moins quatre sont des classiques insubmersibles (validés un peu partout ailleurs). Et ensuite ?
« The Magic Whip » (2015)
On pourrait dire que l’attente a été longue, alors que c’est en réalité tout l’inverse : personne n’a attendu quoi que ce soit, et le seul fait que cet album puisse sortir aujourd’hui est une chance. N’y allons pas par quatre chemins : « The Magic Whip » est un bon disque. Ce qui, bien sûr, signifie tout un tas de choses. D’abord : qu’il est conforme aux canons esthétiques définis en d’autres temps par ses bons géniteurs. Personne d’autre n’aurait pu le sortir, il sonne comme seul Blur peut sonner. Ensuite : qu’il n’a pas à rougir de la comparaison avec le reste de la production pop contemporaine. Blur n’est pas devenu un machin obsolète, il est encore capable de surprendre et brille toujours de mille et un éclats. Enfin : qu’il n’est pas non plus, et c’était inscrit dans le champ des possibles, ce nouveau monument que l’on espérait tant… Depuis « Leisure », c’est l’album le plus hétérogène de Blur, en même temps qu’il en est une synthèse, évoquant presque toutes les facettes de cette discographie qui a balayé tour à tour le classicisme anglais, la veine lo-fi américaine et la sono mondiale 2.0. Concrètement, il se situe donc à la croisée de « The Great Escape » (pour la fameuse touche excentrique) et « Blur » (pour le traitement du son), mais il a incorporé le goût de l’exotisme propre à Albarn (les sonorités asiatiques font écho au folklore oriental de « Think Tank »). Il y a pas mal de ballades, les préoccupations d’Albarn ont changé, c’est aussi un cru un peu plus sage – les quatre ont pris de la bouteille, rien de plus normal.Dans le fond, ce qui gêne un peu, c’est qu’on a parfois l’impression d’écouter une collection d’inédits ou de faces B, glanées ici et là dans leur discographie. C’est bien, mais sur la distance, ça ne tient pas la comparaison avec « Modern Life is Rubbish » ou « 13 » – rien d’étonnant là non plus. Ne pas oublier une chose : « The Magic Whip » est né de bouts de chansons qu’Albarn avait écrit dans son coin et pour sa pomme, elles n’étaient pas à l’origine destinées à Blur. Deux d’entre elles, au final, sortent réellement du lot : Thought I was a Spaceman, long mantra lunaire d’inspiration krautrock, et Ghost Ship, petite merveille au groove chaloupé qui ferait un parfait single estival. Au final, cela peut paraître un bien maigre butin, sauf que voilà : l’essentiel n’est pas là. « The Magic Whip » est une entreprise accidentelle, et elle a rempli son contrat : valider la pertinence de Blur en 2015. Maintenant et à nouveau que les portes sont ouvertes, Albarn et Coxon peuvent se plaire à envisager une suite à leur aventure de façon plus concertée, plus ambitieuse. On ne rattrape jamais le temps perdu. Mais on peut poursuivre son fantôme, et y trouver encore matière à honorer son rang, et son époque.
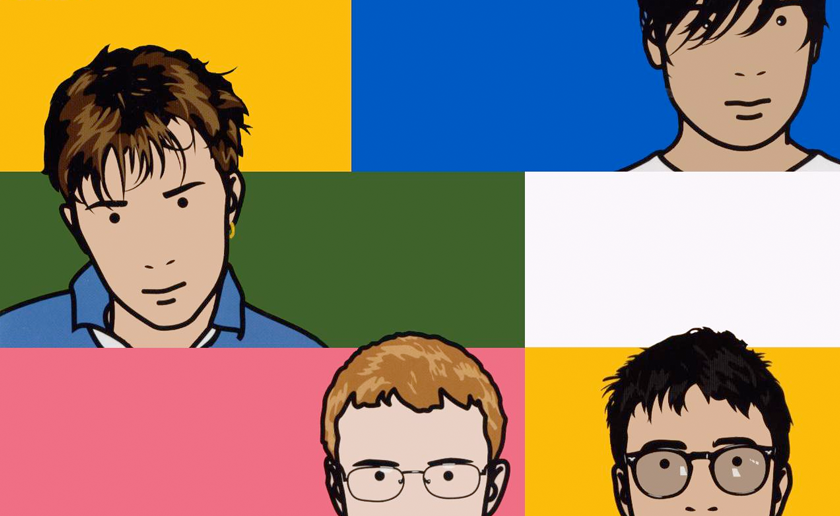








4 commentaires
Well donne dude. Tu devrais écrire un bouquin sur eux et le proposer au Mot et le reste. En plus, ça te ferait pas loin pour aller leur mettre le bazar sous le nez. Je dis ça, je dis rien, pour paraphraser Bernardo en pleine séance de air guitar, en attendant que le patron rentre.
L’idée est ambitieuse mais Alex James a déjà fait tout le boulot en mode 100% gonzo (« Bit of a Blur », 2007)… Sinon j’apprécie le compliment, et ce genre de bouquin aurait effectivement toute sa place dans l’hallucinante bibliographie pop du Mot et le Reste (dont j’ai pu avoir un aperçu complet lors du récent Disquaire Day).
Chouette papier, lorsqu’on en apprend aux fans aguerris c’est une belle perf’! Merci
le premier album solo de Damon Albarn, ce serait plutôt le premier Gorillaz et non Think Thank.Le best-of et sa pochette rigolote a totalement planté commercialement. Parlophone l’avait imposé à Albarn en contrepartie du projet Gorillaz en lequel ils ne croyaient pas….