Il n’empêche que le cinéma pornographique et celui dit « traditionnel » passent beaucoup de temps, dans une chambre ou ailleurs, à pratiquer un 69 inaltérable. Des exemples ? Le meilleur reste celui des deux réalisateurs contemporains les plus hyperactifs, qui trouvent bien sûr le temps de passer par la case cul : Soderbergh et Winterbottom. Le réalisateur de Sexe, Mensonges & Vidéo (il devait arrêter le cinéma, il sort trois films en 2012) caste Sasha Grey pour Girlfriend Experience. Et le deuxième, qui passe son temps à semer sa filmo de parenthèses, en a ouvert une petite sur la question avec le classé X, c’est 9 Songs. Même le plus inoffensif des réalisateurs français, Christophe Honoré, a tourné avec le hardeur gay François Sagat un film à l’air olé-olé (L’Homme Au Bain). Même Mélanie Laurent a tourné le sien (À ses pieds). Noé en parle à longueur d’interviews, Cronenberg n’exclurait pas l’idée non plus. Imaginons qu’ils ouvrent une brèche et que d’autres s’y mettent, pour enfin délivrer de vrais bons films imaginatifs explicites d’auteurs. Le top de notre porNo Futur, c’est juste en dessous
Depuis vingt plombes, Gaspar Noé le premier devrait passer à l’acte.
 En témoigne sa filmographie tout entière qui ne tourne qu’autour du sexe, sous toutes ses formes et coutures. Soit en mise en abyme, quand Nahon, en grognant, matte un porno sur grand écran, c’est Seul contre tous. Soit en tant que dualité domination/soumission ou conciliation idéale, c’est Irreversible (« Le sexe peut être un syndrome de névrose de pouvoir pour des gens qui en manquent totalement, mais ça peut être aussi autre chose, et le film en propose le contrechamps amoureux » in Repérages, mai 2002). Soit de façon tour à tour fun, symbolique, œdipienne, éventuellement nécrophile, en tout cas une sexualité mi-exécutée mi-chiquée, tout ça, c’est Enter the Void (chiquée pour son morceau de bravoure avec sa fameuse bite finale intra muros récrée en 3D). Soit filtrée un maximum façon manège enchanté, c’est le clip de Protège-Moi. Soit de façon directe, quoique ébranlée par un stroboscope soupesant le va-et-vient (et grillant la rétine), c’est We fuck alone. Pffffiou !!!
En témoigne sa filmographie tout entière qui ne tourne qu’autour du sexe, sous toutes ses formes et coutures. Soit en mise en abyme, quand Nahon, en grognant, matte un porno sur grand écran, c’est Seul contre tous. Soit en tant que dualité domination/soumission ou conciliation idéale, c’est Irreversible (« Le sexe peut être un syndrome de névrose de pouvoir pour des gens qui en manquent totalement, mais ça peut être aussi autre chose, et le film en propose le contrechamps amoureux » in Repérages, mai 2002). Soit de façon tour à tour fun, symbolique, œdipienne, éventuellement nécrophile, en tout cas une sexualité mi-exécutée mi-chiquée, tout ça, c’est Enter the Void (chiquée pour son morceau de bravoure avec sa fameuse bite finale intra muros récrée en 3D). Soit filtrée un maximum façon manège enchanté, c’est le clip de Protège-Moi. Soit de façon directe, quoique ébranlée par un stroboscope soupesant le va-et-vient (et grillant la rétine), c’est We fuck alone. Pffffiou !!!
Pareil que la longue liste de réalisateurs qui l’auraient poussé à tourner une version longue de Carne, on imagine bien certains de ses proches du milieu X (Trinh Thi, B. Root, HPG et compagnie créole) l’inciter à viagraiser son bordel – plus c’est long, plus c’est bon. Et l’enjeu de la manœuvre serait bien évidemment d’accomplir le fantasme ultime ; un long-métrage porno sublime, oui, au même niveau qu’un génial film tout court. Fist-moi, ça vaut mieux – pardon pour l’élégance du titre, mais il s’agit là de l’injonction de Jean-Louis Costes dans Irréversible – ad lib, plus c’est long, plus c’est bon, ah bon. Une équipe de bras pas cassés vaselinés jusqu’au coude et des semaines de post-production pour un trip narratif sexperimental. Un fist donc, pour pénétrer des entrailles insolites et pour rester dans un esprit film coup de poing. Pas de sexe sans latex (Noé a également produit Good Boys use Condoms ), ce n’est plus Bangalter qui se colle à la bande-son mais sa moitié, le Guy-Man X de Sexuality, pour les synthés voluptueux et le doigté protégé par les gants. Ensuite, mises à part les prouesses techniques, et mise à part la violence ; l’amour. Chez Noé, qu’il soit physique ou sentimental, il résonne avec l’impossibilité d’une romance, et ce au moins dans ses trois longs ; dans Seul contre tous c’est Lemon Incest, dans Irréversible – malgré la plus belle scène d’intimité jamais tournée ! – c’est déjà trop tard, et dans Enter the Void c’est une « âme » et sa sœur. Alors, quels procédés déployer pour rester dans le registre ? On attendra. Et plus ce sera long, plus ce sera long ?
Autre réalisateur français : Bruno Dumont.
 Qu’il s’agisse de filmer en gros plan une pénétration sauvage dans les champs ou « l’origine du monde » d’une fillette, Bruno Dumont s’en branle royalement ; il le fait. Chez lui, quand la communication atteint ses limites (parfois même elle s’arrête avant même de démarrer), ne reste plus que l’attraction des corps, le sexe étant alors un moyen et à égale proportion une fin en soi, un peu par défaut. Dans L’humanité petit h : « C’est ça que tu veux ? », s’enquiert la fille, en désignant son sexe apprêté, résigné comme s’il était le seul objectif valable et « palpable » pour le type, la seule offrande qui ait une valeur à peu près certaine (en fait, le seul truc qui ne mente pas). Explication de Dumont : « Je suis dans la physiologie : le physique c’est le film, et le méta c’est le spectateur. » À propos de ses acteurs : « Ce sont des espèces de bouffeurs de corps des autres qui, dans le contact des autres, tentent de percer la grâce et qui ont des rapports crus, sexuels, violents. Ce sont des corps surtout. Donc ce sont des acteurs mécaniciens : ils jouent des actions mais ne méditent jamais sur ce qu’ils font. »
Qu’il s’agisse de filmer en gros plan une pénétration sauvage dans les champs ou « l’origine du monde » d’une fillette, Bruno Dumont s’en branle royalement ; il le fait. Chez lui, quand la communication atteint ses limites (parfois même elle s’arrête avant même de démarrer), ne reste plus que l’attraction des corps, le sexe étant alors un moyen et à égale proportion une fin en soi, un peu par défaut. Dans L’humanité petit h : « C’est ça que tu veux ? », s’enquiert la fille, en désignant son sexe apprêté, résigné comme s’il était le seul objectif valable et « palpable » pour le type, la seule offrande qui ait une valeur à peu près certaine (en fait, le seul truc qui ne mente pas). Explication de Dumont : « Je suis dans la physiologie : le physique c’est le film, et le méta c’est le spectateur. » À propos de ses acteurs : « Ce sont des espèces de bouffeurs de corps des autres qui, dans le contact des autres, tentent de percer la grâce et qui ont des rapports crus, sexuels, violents. Ce sont des corps surtout. Donc ce sont des acteurs mécaniciens : ils jouent des actions mais ne méditent jamais sur ce qu’ils font. »
Alors un film fondé uniquement sur des rapports sexués lui conviendrait, un film à première vue creux, à la deuxième un film d’une puissance saturée de sensualité et de non-sens. Ce qui pourrait en faire un porno muet (« un semi pléonasme » vous dites-vous dans votre tête ?) mais non pas sans bruit, plutôt sans paroles : inspirations, expirations, exténuations, flottements très étendus, frottements peu détendus. Où la laideur ne serait en vérité qu’une beauté travestie, une beauté impure, entre les plans comme on dit entre les lignes. D’ailleurs Dumont, en tant qu’athée, parle volontiers de Vérité plutôt que de Dieu, et exactement comme la vérité, la beauté serait ailleurs. Mais pas située hors champ. Dedans, mais invisible. Le défi ultime pour le genre porno dans lequel on en voit souvent trop. En restant dans la même lignée que d’habitude, le casting se composerait exclusivement d’amateurs pur jus (de toute façon, pour lui, tous les acteurs représentent des seconds rôles par rapport au reste), mais des acteurs et actrices « familiers » à la chose (rappel : le flic de l’Humanité est un vrai flic dans la vraie vie, le chien d’Hadewijch est un vrai chien dans la vraie vie…). Exemple de scène : le mec ne jouirait pas, tandis que la fille, contrainte mais consentante, penserait complètement à autre chose ou à rien du tout, le genre d’indifférence qui laisse un peu perplexe. Elle n’aurait pas l’air d’en avoir envie, comme par exemple quelqu’un qui n’aurait pas trop envie de parler mais se forcerait parce qu’il le faut bien. Plus plus : des références religieuses, ce qui déclencherait un discret tollé du côté de l’Église. Dumont s’en défendrait : « Je suis un artiste, un athée, un anar, et je vous encule. » Et il aura bien raison.
Tout au long de sa filmographie, Dario Argento a bricolé des films marqués par leur sexualité.
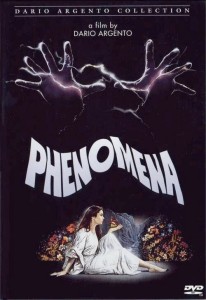 La sexualité, qu’elle soit violente, languide, carnassière ou petite mort, ou connectée à des délires selon l’humeur du chef (le corps empalé sur une stalagmite dans Le Fantôme de l’Opéra). Des Nuits rouges du bourreau de Jade, à Saint-Ange en passant par Amer, ses petits frères (francophones) cherchent moins l’intrigue complexe que le climat sexuel. En Italie, l’aversion pour le gore à l’époque (à la sortie de Suspiria : « Il fait trop peur, n’y allez pas, il y a des sorcières partout ! ») se pose sur la même ligne que l’aversion contemporaine pour le sexe ; pourtant, bon nombre de films sulfureux désormais passés cultes sont transalpins (La Grande Bouffe, Salo, Le Diable au corps, Caligula…), la contrainte libère ; pourtant un mec comme Berlusconi ressemble quelque peu à un ventripotent producteur de X. Passons, si beaucoup à l’époque qualifiaient le cinéma d’Argento justement de pornographique, aujourd’hui il est bien sûr reconnu pour son sens du raffinement, sa sensualité trouble, son soin de l’esthétique. Prendre au mot ce qualificatif et imaginer ce que ça pourrait faire de tourner ce qui était Amer – c’est-à-dire l’obsession pour les tics. Plus : entremêler fantasme et réel, cauchemar et rêve, montrer le SM comme un jeu. Réinterpréter un peu les névroses d’Argento – sachant qu’il flippe en voyant un film d’épouvante (c’est Alain Schlockoff qui le dit) : un concentré de toutes ses hantises. Pour donner une idée vague, citer Profondo Rosso : « Il arrive que ce que tu vois réellement et ce que tu imagines se mélangent dans ta mémoire comme un cocktail dont tu n’arrives plus à distinguer les saveurs. »
La sexualité, qu’elle soit violente, languide, carnassière ou petite mort, ou connectée à des délires selon l’humeur du chef (le corps empalé sur une stalagmite dans Le Fantôme de l’Opéra). Des Nuits rouges du bourreau de Jade, à Saint-Ange en passant par Amer, ses petits frères (francophones) cherchent moins l’intrigue complexe que le climat sexuel. En Italie, l’aversion pour le gore à l’époque (à la sortie de Suspiria : « Il fait trop peur, n’y allez pas, il y a des sorcières partout ! ») se pose sur la même ligne que l’aversion contemporaine pour le sexe ; pourtant, bon nombre de films sulfureux désormais passés cultes sont transalpins (La Grande Bouffe, Salo, Le Diable au corps, Caligula…), la contrainte libère ; pourtant un mec comme Berlusconi ressemble quelque peu à un ventripotent producteur de X. Passons, si beaucoup à l’époque qualifiaient le cinéma d’Argento justement de pornographique, aujourd’hui il est bien sûr reconnu pour son sens du raffinement, sa sensualité trouble, son soin de l’esthétique. Prendre au mot ce qualificatif et imaginer ce que ça pourrait faire de tourner ce qui était Amer – c’est-à-dire l’obsession pour les tics. Plus : entremêler fantasme et réel, cauchemar et rêve, montrer le SM comme un jeu. Réinterpréter un peu les névroses d’Argento – sachant qu’il flippe en voyant un film d’épouvante (c’est Alain Schlockoff qui le dit) : un concentré de toutes ses hantises. Pour donner une idée vague, citer Profondo Rosso : « Il arrive que ce que tu vois réellement et ce que tu imagines se mélangent dans ta mémoire comme un cocktail dont tu n’arrives plus à distinguer les saveurs. »
Dans le même film, Helga sait déjà ce qui va lui arriver (elle est parapsychologue) ; le porno est, par définition, prémonitoire. Le giallo est un genre à code, idem pour qui vous savez, une « esthétique » et une soi-disant réponse à une soi-disant demande du spectateur, un peu comme si se déroulait régulièrement une assemblée pendant laquelle on éplucherait les exigences du peuple. On parle généralement de la « patte » d’un artiste, là c’est comme s’il n’y en avait qu’une seule, celle d’un sous-genre, une esthétique clairement « porno », plus rarement d’un auteur porno. Et le gonzo, c’est un peu comme si, dans un Argento ou un De Palma, on ne gardait que le meurtre, rien d’autre, ni tension, ni dramaturgie, ni psychologie, rien de ce qui pourrait parasiter, alors que ce qui compte reste moins l’aboutissement que ce qui précède. Pour reprendre ce bon vieux Clémenceau : « Le meilleur moment dans l’amour, c’est quand on monte les escaliers. » C’est pour ça qu’un film comme Martyrs (du même Laugier que Saint-Ange) incarnerait le parfait versant horreur du porno : l’enchainement d’abominations comme un découpage YouTube servi sur un plateau, le concentré du pire, ou comme une compilation où l’on ne garderait que les refrains, en quelque sorte. Sauf que si Dario suivait ce principe pour érotiser encore plus son cinéma, les refrains s’avéreraient évidemment saisissants.
Maintenant, rayon mastodontes US : Quentin Tarantino.
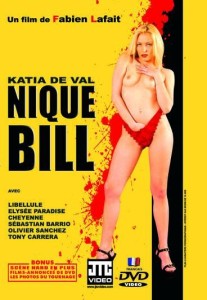 Fanboy cinéphage, Quentin ne fait pas l’impasse sur le X, il ne se cache pas d’avoir été un consommateur boulimique. Si le porno devait exister chez lui, il ne se placerait pas du tout « à part » du reste de sa filmo : plus encore qu’un film-bonus. À la clé, des clins d’œil aguicheurs qu’on oserait à peine dire pompeurs, un grand jeu de devinettes sur plein de films transgenres (c’est-à-dire pas que X). D’ailleurs, qui se ressemble se pille, même le X a sorti sa version de Kill Bill, intitulée Nique Bill, preuve que rôde là-dedans un beau parfum d’orgie. On imagine déjà des remakes de scène de sexe incorporant des films traditionnels, sauf que là on parlerait de prolongements : quand la caméra jouait sa pudique, Tarantino remonterait tout ça, remontrerait tout ce qu’on avait juste imaginé. Des scènes déjà vues (mais pas jusqu’au bout – et stop la frustration) des scènes inédites et interdites aux moins de tous âges. Et le terme film de culte prendrait son sens – et son pied. D’ailleurs, ce film serait adoubé par Ed Fox et Jonathan Reynolds puisqu’il montrerait bien évidemment la base, le ressort, les pieds nus qui envahissaient Boulevard de la Mort et le reste aux quatre coins des angles. Ceux-ci sont désormais soutenus par des talons haut de gamme et les tongs changées en fuck-me shoes (selon l’expression de Geoff Nicholson dans Le Fétichiste) ; par exemple, la fille de Boogie Nights (un de ses films fétiches traitant… de pornographie !) aurait la décence de retirer ses rollers pendant qu’elle fait l’amour. Et s’il devait y avoir une créature exclue de la partouze, il s’agirait des sirènes – d’ailleurs, qu’est-ce qu’elles viendraient foutre là ? –, me glisse-t-on aimablement à l’oreille.
Fanboy cinéphage, Quentin ne fait pas l’impasse sur le X, il ne se cache pas d’avoir été un consommateur boulimique. Si le porno devait exister chez lui, il ne se placerait pas du tout « à part » du reste de sa filmo : plus encore qu’un film-bonus. À la clé, des clins d’œil aguicheurs qu’on oserait à peine dire pompeurs, un grand jeu de devinettes sur plein de films transgenres (c’est-à-dire pas que X). D’ailleurs, qui se ressemble se pille, même le X a sorti sa version de Kill Bill, intitulée Nique Bill, preuve que rôde là-dedans un beau parfum d’orgie. On imagine déjà des remakes de scène de sexe incorporant des films traditionnels, sauf que là on parlerait de prolongements : quand la caméra jouait sa pudique, Tarantino remonterait tout ça, remontrerait tout ce qu’on avait juste imaginé. Des scènes déjà vues (mais pas jusqu’au bout – et stop la frustration) des scènes inédites et interdites aux moins de tous âges. Et le terme film de culte prendrait son sens – et son pied. D’ailleurs, ce film serait adoubé par Ed Fox et Jonathan Reynolds puisqu’il montrerait bien évidemment la base, le ressort, les pieds nus qui envahissaient Boulevard de la Mort et le reste aux quatre coins des angles. Ceux-ci sont désormais soutenus par des talons haut de gamme et les tongs changées en fuck-me shoes (selon l’expression de Geoff Nicholson dans Le Fétichiste) ; par exemple, la fille de Boogie Nights (un de ses films fétiches traitant… de pornographie !) aurait la décence de retirer ses rollers pendant qu’elle fait l’amour. Et s’il devait y avoir une créature exclue de la partouze, il s’agirait des sirènes – d’ailleurs, qu’est-ce qu’elles viendraient foutre là ? –, me glisse-t-on aimablement à l’oreille.
N’oublions pas Virginie Despentes.
 Dans The Kids Are Allright, quand un des fils demande à ses mamans pourquoi la veille elles mataient un film bruyant dans lequel deux mecs jouent à jouir, l’imperturbable Annette Bening propose une réponse évidente : « Dans les films pornos, on ne voit que des hétéros qui jouent aux lesbiennes ». Cette affirmation sied à Virginie Despentes : Baise-Moi reste dans les anale. Et Bye Bye Blondie se pose en comédie familiale sexuée, non pas à cause d’un quelconque caractère érotisant mais pour le goût sexuels des personnages. Un film comme Coup de Foudre à Notting Hill reste une comédie romantique tout court. Alors est-ce bien pertinent de spécifier, comme c’est le cas dans certaines entreprises culturelles, un rayon « gays & lesbiens » uniquement parce que les héros ne sont pas hétéros ? Comme s’il s’agissait, par exemple, d’une nationalité ou d’un euh genre… ah merde, ça marche pour celui-ci. On croirait un étalage de films de cul qui n’en sont absolument pas !
Dans The Kids Are Allright, quand un des fils demande à ses mamans pourquoi la veille elles mataient un film bruyant dans lequel deux mecs jouent à jouir, l’imperturbable Annette Bening propose une réponse évidente : « Dans les films pornos, on ne voit que des hétéros qui jouent aux lesbiennes ». Cette affirmation sied à Virginie Despentes : Baise-Moi reste dans les anale. Et Bye Bye Blondie se pose en comédie familiale sexuée, non pas à cause d’un quelconque caractère érotisant mais pour le goût sexuels des personnages. Un film comme Coup de Foudre à Notting Hill reste une comédie romantique tout court. Alors est-ce bien pertinent de spécifier, comme c’est le cas dans certaines entreprises culturelles, un rayon « gays & lesbiens » uniquement parce que les héros ne sont pas hétéros ? Comme s’il s’agissait, par exemple, d’une nationalité ou d’un euh genre… ah merde, ça marche pour celui-ci. On croirait un étalage de films de cul qui n’en sont absolument pas !
Mais revenons à Despentes ; si elle se plaint du manque d’archétype de la lesbienne au cinéma, les personnages ont tout de même envahi les écrans ces dernières années, de la culture ultra populaire (The Kids Are All Right donc, mais aussi la « bilogie » Klapisch, Millénium, Intouchables, Skins, L World et j’en passe) ou plus estampillée « indé » (de Boys don’t cry à Fucking Amal, en passant par La Naissance des Pieuvres), ces films mettant de côté que l’argument lesbien tiendrait au service du fantasme hétérocentré vers lequel tendrait une bonne part du cinoche mainstream. Plus encore à un genre de porno mainstream (oxymore ?) : le cahier des charges Canal et câblé qui demande l’interdiction de scène « homo » mais accorde volontiers un espace aux séquences lesbiennes. Sur le porno supposé, Virginie avait répondu il y a quelques années : « Une partouze sur trois étages avec des femmes tatouées et piercées qui sodomiseraient des hommes beaux comme des dieux, avec application et rage. » Aujourd’hui, peut-être se concentrerait-elle sur un film exclusivement lesbien, mais sans hétéros qui joueraient à l’être.
En ce qui concerne le « jeu » : pour rester dans l’idée de scindage propre à son dernier film (bourges vs prolos, années 80 vs années 2000, punks vs skins), on note cette particularité dans les deux longs réalisés : d’un côté, Baise-Moi était composé à 69 % de gens du milieu, de l’autre le plus cucul BB un casting à 96 % classé Y, autrement dit, même si c’est fait exprès pour que les mâles hétéros ne viennent pas pour se rincer l’œil, la question demeure : n’y a-t-il pas ce problème de tourner des scènes explicites avec des « non-professionnel(le)s » ? Donc voilà, de vraies hardeuses, de vraies lesbiennes, et un vrai film qui atterrirait dans le rayon DVD « comédies dramatiques » et paradoxalement aurait l’autorisation de sortir en salles justement parce que c’est Despentes qui l’a réalisé. Et tracklisting punk pour enrober le tout. À noter : il y a plusieurs omissions musicales dans la version cinéma de Bye Bye Blondie, dont La Femme Ecarlate de Taxi Girl. Mirwais a travaillé avec YAS et celle-ci a justement intitulé un morceau Coït Me, tout se recoupe, incroyable. Voilà, ça c’était gratuit. La suite.
Une autre femme : Catherine Breillat.
 Les films de Breillat donnent moins chaud au ventre qu’ils ne font froid dans le dos ; des films-horreurs et non d’horreur, des films-culs mais pas de cul. Généralité récurrente ; les femmes savent aller plus loin dans la crudité sexuelle que les hommes. Des exemples récents de réalisatrices qui n’y vont pas avec le dos de la main morte : Sleeping Beauty (de Julia Leigh) ou le petit chaperon rouge au pays des séniors libidineux (des viols consentants, elle se laisse faire puisqu’elle dort), une sorte de versant conte de Mes Chères Études, autre film qui explicite pas mal la suggestion et réalisé par une femme (Emmanuelle Bercot). Ou encore le très bon Portrait au Crépuscule (Angelina Nikolova) qui cause de la force de la femme mais à travers le masochisme et qui, lui aussi, cogne de partout. Tous trois attendrissent, dérangent, fascinent, épuisent. A priori sur la ligne opposée d’un film porno se situe le film dit traditionnel ? Est-ce que ce ne serait pas plus directement le cinéma anti-sexe, celui qui castre tout élan de voyeurisme ?
Les films de Breillat donnent moins chaud au ventre qu’ils ne font froid dans le dos ; des films-horreurs et non d’horreur, des films-culs mais pas de cul. Généralité récurrente ; les femmes savent aller plus loin dans la crudité sexuelle que les hommes. Des exemples récents de réalisatrices qui n’y vont pas avec le dos de la main morte : Sleeping Beauty (de Julia Leigh) ou le petit chaperon rouge au pays des séniors libidineux (des viols consentants, elle se laisse faire puisqu’elle dort), une sorte de versant conte de Mes Chères Études, autre film qui explicite pas mal la suggestion et réalisé par une femme (Emmanuelle Bercot). Ou encore le très bon Portrait au Crépuscule (Angelina Nikolova) qui cause de la force de la femme mais à travers le masochisme et qui, lui aussi, cogne de partout. Tous trois attendrissent, dérangent, fascinent, épuisent. A priori sur la ligne opposée d’un film porno se situe le film dit traditionnel ? Est-ce que ce ne serait pas plus directement le cinéma anti-sexe, celui qui castre tout élan de voyeurisme ?
Mais revenons à Breillat, même si on parle là de son cinéma. Celle qui fait dire crânement à Asia Argento « C’est un monstre, je me suis trouvé beaucoup d’affinités avec elle » ; Breillat, toujours à aborder ce qui serait dixit elle-même le « désir féminin », pourrait-elle passer pas de l’autre côté de la barrière ? Maniérée ? Peut-être, en fait. Mais c’est faire preuve d’une distinction bien sotte. Oshima (le réalisateur de L’Empire des Sens) définissait la chose autrement : « Les films érotiques ont été conçus pour la bourgeoisie, les films pornographique, pour le prolétariat », sans prendre en compte que s’il y a bien une égalité – sexuelle, puisque c’est le sujet – c’est justement face au cinéma sexuel, qu’il fasse son allumeuse ou son étalage d’exhibition avec une caméra-loupe. C’est peut-être ce qui permet à certains films de Breillat de ne pas passer au rayon X ; pas assez excitants pour répondre à la demande, très sexe mais très secs. Et trop pornographiques pour occuper la tranche 22h30/minuit de RTL9 ou des machins de ce genre. En attendant, si elle se mettait en tête d’en faire un vrai, il se pourrait bien qu’il se révèle nettement plus hardcore que la moyenne de nombre de ses confrères hétéro-beaufs, la cruauté assumée. Un genre de porno dramatique. Des films avec du sexe explicite terne, il en existe un paquet ; en revanche, il n’y a pas vraiment de pornos tristes, ou alors éventuellement à leur insu. L’intention est hédoniste, par ailleurs rabâchée pour justifier la fabrication à la va comme j’te pousse – il faut que tu jouisses, pas que tu te laisse happer par le grain du canapé ou le travelling arrière d’un quelconque sifflotement suicidaire – qui plus est dans le gonzo, rien ne compte moins que le détail ; à ce rythme-là, on produit des éjaculateurs précoces. Ras-le-bol, fuck la jouissance : Breillat en contrepied, génial !
S’il y en a un qui s’en donnerait à cœur-joie pour œuvrer dans la matière, c’est bien Paul Verhoeven.
Comme il sait faire, avec quelques autres, le blockbuster pour adultes, il inventerait, pour inverser la donne, une sorte de porno familial. « Familial » puisque tout le monde y trouverait son compte, et en prime time. Et c’est là tout le paradoxe admiré chez cet homme : tourner des films king size en ne faisant qu’un corps du ludique et du lubrique, cette alchimie qui plonge le $ de dollar dans celui du soufre, tout en faisant jaillir quelques éclats de bling bling marxiste. Plutôt qu’un voyeurisme vicelard ou énervant, Paul incruste le sexe comme un trompe-l’œil, et si le spectateur se le rince, l’œil, c’est le plus souvent pour se le dépoussiérer. Du viol (Spetters, La Chair et le sang), de la prostitution (Keetje Tippel), de la religion (Le Quatrième Homme et sa version fantasmagorique du catholicisme, Turkish Delices et son culte « Je baise mieux que Jésus »…) et ainsi de suite : à lui tout seul, il remplit le cahier des charges du sang, du sperme et des larmes, sans gratuité, avec vision et humanité.
 Dans sa filmo, un type de fait d’arme polémique : être taxé d’homophobie pour Spetters. Contresens et absurdité ; comme une scène de backroom avec Fassbender dedans (Shame), il s’agit moins d’une charge contre l’homosexualité que d’une approche frontale sur les pulsions de l’ami mâle. Quand il tourne Querelle, est-ce que Fassbinder prend des pincettes ? Non. Tout au plus de l’Homo phobie en deux mots – d’autant plus que placer les femmes en « premier rôle » à plusieurs reprises (Basic Instinct, Showgirls, Black Book, Keetje Tippel…), ça court pas obligatoirement les bobines. Verhoeven renouerait pour l’occasion avec sa période science-fiction, tout en gardant sa constante. On l’imaginerait bien s’amuser à déjouer les codes d’un certain porno institutionnel, voire « marginal », en tout cas « mainstream » puisqu’il serait sans doute plus regardé que n’importe quel court-métrage de tel auteur bulgare en formation. On l’imaginerait alors bien tenter la posture de bad boy avec l’industrie pornographique et même, à l’instar d’un Tarantino, pondre un grand manifeste néo-féministe, et sans y aller avec les gros sabots du genre « Tu vois pas comment elle s’épanouit ma comédienne à se faire mettre des claques sur les fesses ?! » Un exemple de pitch : aux environs de 2069, année post-érotique, on détecterait un nouveau virus vertueux appelé « STI » (« Sexual Transmitted Intelligence ») qui se contracterait par le fluide comme n’importe quelle MST, mais qui consisterait cette fois-ci à transmettre des facultés intellectuelles plus ou moins identifiables après un test de dépistage de Q.I. ou impossible à déceler autrement que par la mise à l’épreuve de l’esprit quelques temps après le coït. Il y aurait aussi cette femme qui enverrait littéralement en l’air ces mecs avec qui elle échange physiquement ; ces derniers deviendraient par la suite transparents. Revival Hollow Man, ou la mise au point d’un film sur comment tourner l’affaire si les sujets (les corps) ne sont plus visibles à l’œil nu – paradoxe folichon vu qu’on reproche souvent au porno de manquer d’âme. C’est aussi reprendre l’idée de Despentes selon laquelle le spectateur s’identifie largement à l’actrice, l’homme servant en quelque sorte de base interactive, de machin membré. C’est d’ailleurs assez bizarre qu’il n’existe pas de porno futuriste intitulé Sex Machine.
Dans sa filmo, un type de fait d’arme polémique : être taxé d’homophobie pour Spetters. Contresens et absurdité ; comme une scène de backroom avec Fassbender dedans (Shame), il s’agit moins d’une charge contre l’homosexualité que d’une approche frontale sur les pulsions de l’ami mâle. Quand il tourne Querelle, est-ce que Fassbinder prend des pincettes ? Non. Tout au plus de l’Homo phobie en deux mots – d’autant plus que placer les femmes en « premier rôle » à plusieurs reprises (Basic Instinct, Showgirls, Black Book, Keetje Tippel…), ça court pas obligatoirement les bobines. Verhoeven renouerait pour l’occasion avec sa période science-fiction, tout en gardant sa constante. On l’imaginerait bien s’amuser à déjouer les codes d’un certain porno institutionnel, voire « marginal », en tout cas « mainstream » puisqu’il serait sans doute plus regardé que n’importe quel court-métrage de tel auteur bulgare en formation. On l’imaginerait alors bien tenter la posture de bad boy avec l’industrie pornographique et même, à l’instar d’un Tarantino, pondre un grand manifeste néo-féministe, et sans y aller avec les gros sabots du genre « Tu vois pas comment elle s’épanouit ma comédienne à se faire mettre des claques sur les fesses ?! » Un exemple de pitch : aux environs de 2069, année post-érotique, on détecterait un nouveau virus vertueux appelé « STI » (« Sexual Transmitted Intelligence ») qui se contracterait par le fluide comme n’importe quelle MST, mais qui consisterait cette fois-ci à transmettre des facultés intellectuelles plus ou moins identifiables après un test de dépistage de Q.I. ou impossible à déceler autrement que par la mise à l’épreuve de l’esprit quelques temps après le coït. Il y aurait aussi cette femme qui enverrait littéralement en l’air ces mecs avec qui elle échange physiquement ; ces derniers deviendraient par la suite transparents. Revival Hollow Man, ou la mise au point d’un film sur comment tourner l’affaire si les sujets (les corps) ne sont plus visibles à l’œil nu – paradoxe folichon vu qu’on reproche souvent au porno de manquer d’âme. C’est aussi reprendre l’idée de Despentes selon laquelle le spectateur s’identifie largement à l’actrice, l’homme servant en quelque sorte de base interactive, de machin membré. C’est d’ailleurs assez bizarre qu’il n’existe pas de porno futuriste intitulé Sex Machine.
Un qui devrait renouer avec une période, c’est David Cronenberg.
Ce serait d’ailleurs génial qu’il renoue avec sa propre période Cronenberg. Crash est potentiellement érotique, il est surtout son anagramme à une lettre près – théorique – et l’idée de mettre en image une chronique du genre auto-socio de Bolino Croustibat devrait le titiller, à moins que quelqu’un propose l’idée saugrenue d’une version porno hardcore du Cars de Pixar, intitulée Autos-tamponneuses. En somme, l’inverse de la femme-objet ou de l’homme-objet. Narcisse m’avait d’ailleurs déclaré, un soir où on parlait de l’industrie ferroviaire : « J’ai toujours trouvé les rétroviseurs terriblement excitants ».







3 commentaires
Très bon article dont le titre aurait pu être : de l’Art et du cochon.
J’y ai notamment apprécié la référence à « Fucking Amal », film injustement oublié de tous les cinéphages d’Europe et de Navarre, sans doute parce que lorsqu’ils tentent de le télécharger, ils tapent : Fucking Anal…et que du coup, derrière, ça fait un peu mal au cul.
Un peu du trip japonais : « le viol des femmes n’est pas une mauvaise chose puisqu’au final, elles vont toutes finir par aimer ça » aurait été de bon ton mais on ne peut pas tout avoir, et de l’art, et du cochon.
Il y a eu un temps où les réalisateurs faisaient des films pour de très belles actrices parce qu’ils voulaient essayer de les aimer et, surtout, d’être aimer d’elles en retour.
C’était vraiment obscène.
Surtout quand ils mariaient leur égérie.
Aujourd’hui, les réalisateurs font des films pour baiser des jeunes actrices ou des actrices connues.
En dernier ressort, s’ils ne les baisent pas, les les font baiser par d’autres en les montrant comme des salopes ordinaires. (incroyable, elles aiment baiser pourtant elles sont belles).
Le porno est la forme la plus aboutie de l’absence d’imagination du cinéma main stream.
Les tentatives d’intellectualiser cela, c’est vraiment pathétique et d’un ennui terrifiant.
Le suspense qui ne sera jamais dénouer même dans la presse people gonzo. C’est vraiment elles qui baisent ou des doublures ?
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Alors ?
On recommence.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Alors ?
On recommence.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Alors ?
On recommence.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Alors ?
On recommence.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Alors ?
On recommence.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Alors ?
On recommence.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Alors ?
On recommence.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.
Bon, la caméra est dans la chambre et filme comme ils baisent.