Pour la postérité, William Gibson restera sans doute comme le père du mouvement cyberpunk. De sa jeunesse bercée par la science-fiction jusqu’à son interview accordée à Gonzaï, portrait de l’auteur du Neuromancien, fin analyste des dérives du présent qu’il conjugue au futur.
« Le ciel au-dessus du port était couleur télé, calée sur un émetteur hors service. » Les premiers mots du Neuromancien claquent comme une remontée de drogue synthétique encore inconnue, un flash au silicium dans un cerveau branché sur le cyberspace. En quelques lignes, une ville tentaculaire se dévoile. Des immeubles infinis côtoient un bidonville de néon – surplombés par des cieux transformés soudainement en illusion fractale, comme un lait-fraise au mercure tourne à l’amer… Nous sommes en 1984, le Neuromancien de William Gibson vient de vitrifier l’univers de la science-fiction et le recouvrir d’un nouveau terreau littéraire fertile. Futur sombre, décadence sociétale, implants cybernétiques, mégacorporations toutes-puissantes, hackers et cowboys du cyberspace, drogues, rébellion : le cyberpunk débarque et il veut tout balayer !
Rapidement, Le Neuromancien est un immense succès littéraire et Gibson accède, malgré lui, au statut d’écrivain culte. Le « visionnaire neuromantique » explore la dimension poétique de la technologie, des rebuts plastiques, des bas-fonds, des marginaux accros aux réseaux numériques… Il invente une « matrice » qu’il nomme « cyberspace » – elle sera, bien avant l’avènement d’internet, le modèle de toutes celles qu’on retrouvera dans de nombreuses fictions, telles que Matrix des sœurs Wachowski. Comment un baby-boomer, né dans le Sud profond, a-t-il pu devenir le prophète techno et urbain des 80s ? Pour le savoir, il faut retourner vers les routes brûlées par le soleil de la Caroline du Sud.

Première bombe
1956, Conway. Le jeune William Gibson a 6 ans et vit ses derniers moments d’insouciance. Fils unique, il connaît une enfance nomade, rythmée par les déménagements vers les nouveaux sites de construction gérés par son père, ingénieur dans le BTP. Leur itinérance connaît une pause à Oak Ridge, Tennessee, où le pater familias travaille à la construction du laboratoire où seront assemblés les différents éléments de la première bombe atomique. C’est l’heure des balbutiements de la TV et du rock’n’roll, les comics coûtent quelques cents, les jouets sont des pistolets de l’espace et les voitures ressemblent à des vaisseaux intergalactiques.
« Oh, happy days ! »
Le destin viendra ternir rapidement cette American way of life triomphant. Le père du petit William meurt en s’étouffant accidentellement. Il faut alors revenir s’installer auprès de la famille maternelle, en Virginie. Ce déménagement au sein d’une petite communauté rurale, majoritairement blanche, traditionnaliste et religieuse, est mal vécu par William. Ce dernier s’isole, devient un lecteur acharné et travaille à se créer ce qu’il appellera plus tard « une personnalité lovecraftienne ». De ces années, il apprend à se méfier des sourires avenants qui cachent l’intolérance ; de la pourriture séculaire qui s’accumule derrière les jardins proprets bordés de piquets blancs.
Le refuge dans les livres
1963. Sa mère a beaucoup de mal à l’élever seule. Surmontant avec difficulté son veuvage, elle décide d’envoyer son fils en pension à des milliers de kilomètres, en Arizona. William Gibson a 14 ans et il rêve de devenir écrivain de science-fiction. C’est une forme d’évasion à moindre coût. Au-delà des visions conservatrices de romanciers tels que Robert A. Heinlein, l’adolescent découvre une écriture allégorique, satirique et nettement ancrée « à gauche » chez de nombreux auteurs du genre. « La science-fiction était l’un de ces endroits, notamment à l’époque McCarthy, où vous pouviez écrire ce que vous vouliez, parce qu’elle était méprisée et passait sous les radars de la censure », expliquera-t-il dans une interview au Guardian en 2003.

Croyant avoir affaire à de nouveaux auteurs de SF, il tombe accidentellement sur les écrivains de la Beat Generation. La découverte de Burroughs, Kerouac ou Ginsberg coïncide avec son entrée dans l’adolescence ; elle le marquera durablement. Il aime les personnages à la marge qu’il y découvre et étouffe de plus en plus au contact de la bigoterie et du racisme de son sud natal. Exit le personnage d’érudit reclus, il est temps pour lui de se frotter à la contre-culture. Il devient hippie mais l’État d’Arizona n’est pas San Francisco, encore moins Haight Ashbury : « Les flics m’ont vu lire Kerouac et m’ont soupçonné de fumer de la marijuana… J’essayais pourtant désespérément d’en fumer mais je n’en avais jamais trouvé à l’époque. J’ai vu ça comme une occasion de partir », racontera-t-il des années plus tard.
« Le cyberpunk était subversif dans les années 80. Mais à partir du moment où il s’est répandu, c’était fini. »
William a 18 ans lorsque sa mère meurt soudainement. Nouvelle onde de choc. Il finit par quitter le lycée sans obtenir de diplôme. Nous sommes en 1966 et le Summer of Love bat son plein. Encore une fois, tout cela se passe très loin, trop loin de chez lui. Désormais orphelin, il gagne sa vie grâce à divers petits boulots et en chinant dans les vieux débarras de campagne pour revendre plus tard ses trouvailles à des citadins en quête d’un morceau d’Amérique profonde. En 1968, il est rattrapé par une guerre absurde qui se déroule à des milliers de kilomètres de là, dans la jungle étouffante du Vietnam. Pour échapper à la conscription, il s’enfuit au Canada. C’est à Vancouver, en 1972, qu’il rencontre sa femme. Après un voyage en Europe, il reprend des études littéraires. Ce n’est qu’en 1977 qu’il renoue avec sa passion première pour la science-fiction. 1977, émergence d’un nouveau monument culturel nommé « punk ». Gibson est fasciné. Il ne lui reste qu’une seule solution pour échapper à un monde du travail aliénant : devenir écrivain.
« Le métal est plus fort que la chair »
C’est cette même année qu’il développe la thématique du bidonville high-tech dans Fragments de rose en hologramme. La patte de Gibson est déjà là ; synthèse complexe de culture pop, de film noir et de savoir technologique, portée par un style littéraire de haute volée. Ses nouvelles publiées dans le magazine Omni commencent à attirer l’attention. Gibson enchaîne avec Johnny Mnemonic (un polar futuriste allumé qui tourne autour des réseaux, alors que lui-même n’a jamais touché un ordinateur), Hôtel New Rose… Dystopie, défiance du capitalisme, cybernétique et biotechnologie… Ces récits baroques et touffus imposent une vision sombre de l’avenir mais ce futur reste identifiable, c’est une extrapolation des travers de notre société moderne.

Au même moment, à Austin, un mouvement informel se crée autour de la personnalité haute en couleur d’un jeune romancier texan : Bruce Sterling. Dans Cheap Truth, fanzine photocopié qu’il diffuse gratuitement, Sterling, qui signe ses articles sous le pseudo de Vincent Omniveritas, s’en prend violemment à la SF construite autour d’une « formule éculée à base de robots, d’astronef et du miracle-moderne-de-l’énergie-atomique ». Il jubile en lisant les textes de Gibson et écrira : « Tirée de son hibernation, la SF sort de sa caverne pour se retrouver au plein soleil de l’air du temps moderne. Et nous voilà dehors, maigres, affamés, et de fort méchante humeur. » Cette vision, il n’est pas le seul à l’avoir. Dans les colonnes du fanzine, tous les intervenants signent sous pseudonymes, mais on y retrouve des auteurs comme Pat Cadigan, Rudy Rucker, Marc Laidlaw, Lewis Shiner, Tom Maddox… De jeunes plumes aussi inventives qu’acérées qui partagent un goût commun pour des mondes hyper-informatisés emplis de mégalopoles en décrépitude, apothéose d’un capitalisme sans âme. Après avoir essayé d’en faire des « techno-marginaux » ou leur coller sur le dos l’étiquette de « Radical SF », ce mouvement va prendre, sous la plume des critiques de l’époque, et notamment de Gardner R. Dozois, rédacteur en chef du magazine Asimov’s Science Fiction, le nom de « cyberpunk ».
En 1982, William Gibson sort d’une séance de cinéma en titubant ; il vient de voir Blade Runner. Le jeune trentenaire est sous le choc et pense qu’il vient de se faire battre sur son propre terrain. Il se ressaisit en réalisant que Ridley Scott n’a pas effleuré, une seule seconde, ce qui restera la part la plus célèbre et influente parmi ses créations : le « cyberspace ». Si sa première évocation date de la nouvelle Gravé sur chrome, c’est avec Le Neuromancien qu’il développera son concept et en donnera une définition plus précise :
« Cyberespace… Une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions d’opérateurs, dans tous les pays, par des enfants à qui des concepts mathématiques sont ainsi enseignés… Une représentation graphique de données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain. »
Now future
Avec Le Neuromancien qu’il publie en 1984, soit le premier tome de la trilogie de la Conurb, William Gibson a tout imaginé : le règne de la technologie et son omniprésence, la réalité virtuelle, le transhumanisme, les réseaux numériques… La presse le célèbre comme un visionnaire, un gourou « technoïde ». Son œuvre est commenté par des sociologues, des philosophes et tous les nerds de la planète la dissèquent au détail près. Pour les décennies à venir, le cinéma et les jeux vidéo vont puiser leurs idées au sein de cet imaginaire foisonnant. On le dit même inspirateur de l’interface graphique de logiciels d’analyses boursières utilisés aux États-Unis à l’époque. Gibson est partout mais comme à son habitude, il se sent déjà loin : « Le cyberpunk était subversif dans les années 80. Mais à partir du moment où il s’est répandu, c’était fini […] nous avons été résumés à cela, une branche comme une autre de la SF, un simple moment de son histoire, et tout potentiel révolutionnaire a été neutralisé. »

Les années passent et Gibson reste souvent sollicité. Il signe de nombreux articles pour l’excellent magazine techno Wired, mais aussi pour le New York Times ou Rolling Stone, dans lesquels il essaye de se défaire de son image de techno-prophète. Mais surtout il écrit, encore et toujours. Dans les années 90, il décide d’ancrer son style dans une veine plus réaliste avec son roman, Lumière virtuelle (1994), suivi d’Idoru (16996) et All Tomorrow’s Parties (1999), dans lesquels il se focalise moins sur la technologie que sur ses effets dans notre société [les trois ouvrages formeront la Bridge trilogy, NdlR].
Retour vers notre futur. Le temps a gommé la célébrité, reste la légende. Les Millenials et les générations suivantes seront de moins en moins nombreux à se souvenir de l’héritage de William Gibson. Il n’en a cure. L’écriture, il le sait, ne saurait être qu’une activité solitaire. William Gibson vit toujours au Canada avec sa femme et ses deux enfants. Prudent, il garde toujours un œil sur l’avenir depuis son salon. Si son écriture délaisse les effets d’annonce spectaculaires pour mieux représenter la mosaïque d’un monde en pleine mutation, elle garde une constante : l’important n’est pas de parler du futur, mais de se servir du futur comme d’un outil pour parler du présent. Le cyberpunk est mort, mais son cadavre bouge encore !
Entre deux visions et la finalisation de son prochain ouvrage, le cyberprophète a pris le temps de répondre à quelques-unes de nos interrogations via le World Wide Web.

Vous avez passé la majeure partie de votre enfance à Wytheville, Virginie. Avez-vous des souvenirs de la ségrégation, des églises baptistes… de quelque chose de profondément lié au sud ?
William Gibson : Tous mes souvenirs d’enfance sont liés au sud. J’ai grandi dans un petit village religieux et traditionnaliste. À cette époque, la Virginie était toujours placée sous le coup des lois de l’apartheid selon Jim Crow : écoles, toilettes et fontaines séparées pour les Blancs et les Noirs… Là-bas, le pourcentage de population non-blanche y était infime. Mes parents étaient tous deux présents, quand un terrible lynchage a eu lieu dans les années 1920. Je ne l’ai appris qu’il y a quelques années, tant cette histoire fut complètement réprimée et tabou. Cet univers en vase clos, fermé aux influences extérieures, était oppressant, voire irréel.
Juste avant d’être publié, vous ne lisiez pratiquement plus de science-fiction. Qu’est-ce qui vous a amené à en écrire ?
William Gibson : J’ai commencé à en lire, jeune adolescent, au début des années 60, et j’ai trouvé que les auteurs de la nouvelle vague britannique étaient les plus intéressants. J’aimais J. G. Ballard notamment. Je pensais que c’était une forme essentielle d’art populaire. Vers la fin des années 1970, il m’a semblé que la SF a commencé à stagner. J’ai commencé à me demander quel type de science-fiction ressemblerait à la musique que j’écoutais alors, quelle forme lui donner… Et si cela même était possible ! Il fallait secouer les choses dans tous les cas.
Comment un garçon, né à la campagne dans le vieux Sud, a-t-il pu avoir l’idée de renouveler la science-fiction avec un genre totalement urbain et crépusculaire ? Ce goût des mégalopoles mais aussi l’idée du mélange entre roman noir, hackers et yakuzas…
William Gibson : La vie dans les petits bourgs avait fini par procurer de nombreuses associations négatives – le racisme, en premier lieu, alors forcément, j’ai de suite adoré les grandes villes. J’ai choisi d’y placer l’action de mes romans, d’y vivre et j’y suis toujours d’ailleurs. Pour autant, j’ai senti qu’il manquait encore à la science-fiction un certain degré de naturalisme littéraire. Le genre de science-fiction que j’ai commencé à écrire doit probablement plus au naturalisme qu’au surréalisme. Mais le naturalisme dans ce type de littérature peut sembler assez surréaliste… Car nous ne sommes toujours pas habitués à cela.
« L’idée du cyberspace ? Elle m’est venue dans une salle d’arcade. »
La rupture des distinctions – entre culture « sérieuse » et culture pop – a-t-elle eu un effet libérateur sur les écrivains de votre génération ?
William Gibson : Avant de commencer à écrire de la « littérature de genre », j’ai obtenu un baccalauréat en littérature anglaise, à l’Université de Colombie-Britannique. J’ai été accepté en « Honours program » [un programme spécialisé qui peut servir de tremplin entre un baccalauréat et une maîtrise ou un doctorat pour les étudiants, NdlR] et mon domaine de spécialisation était les méthodologies critiques littéraires comparatives. J’ai donc pris pour acquis la frontière de plus en plus poreuse entre le « grand art », dit respectable, et la pop culture. C’est tout naturellement que j’ai souhaité ardemment effacer cette distinction dans la science-fiction. Cela m’a appris à casser les codes. Le Neuromancien, par exemple, est né du mélange de deux sous-genres que sont le thriller et l’espionnage.
Quelle a été l’inspiration pour votre idée du « cyberspace » ?
William Gibson : Un soir, je me suis retrouvé à jeter un coup d’œil dans une salle d’arcade, lorsque les jeux vidéo étant encore bien primitifs. J’ai été frappé par la posture des joueurs, par leur désir évident de rejoindre physiquement et de participer pleinement au monde virtuel qui s’animait derrière l’écran. Cet instant fut précisément mon moment d’inspiration.
Dans Le Neuromancien, vous décriviez le cyberspace comme « une hallucination consensuelle vécue quotidiennement, en toute légalité, par des dizaines de millions d’opérateurs… » Au final, les réseaux sociaux sont très éloignés du psychédélisme et de l’expérience transcendantale collective. Que s’est-il passé entre l’utopie et la pratique (internet, les réseaux sociaux…) ?
William Gibson : Je n’ai jamais imaginé le monde du cyberespace comme une utopie. Il existe un passage dans le Neuromancien, durant lequel le lecteur surprend un publi-reportage expliquant que la plupart des utilisations du cyberspace sont totalement banales. Comme nous sommes dans une œuvre de fiction noire, il y a un aspect sombre et sexy dans l’utilisation de cette technologie mais c’est la banalité qui prend le pas sur toute expérience psychédélique et libératrice.
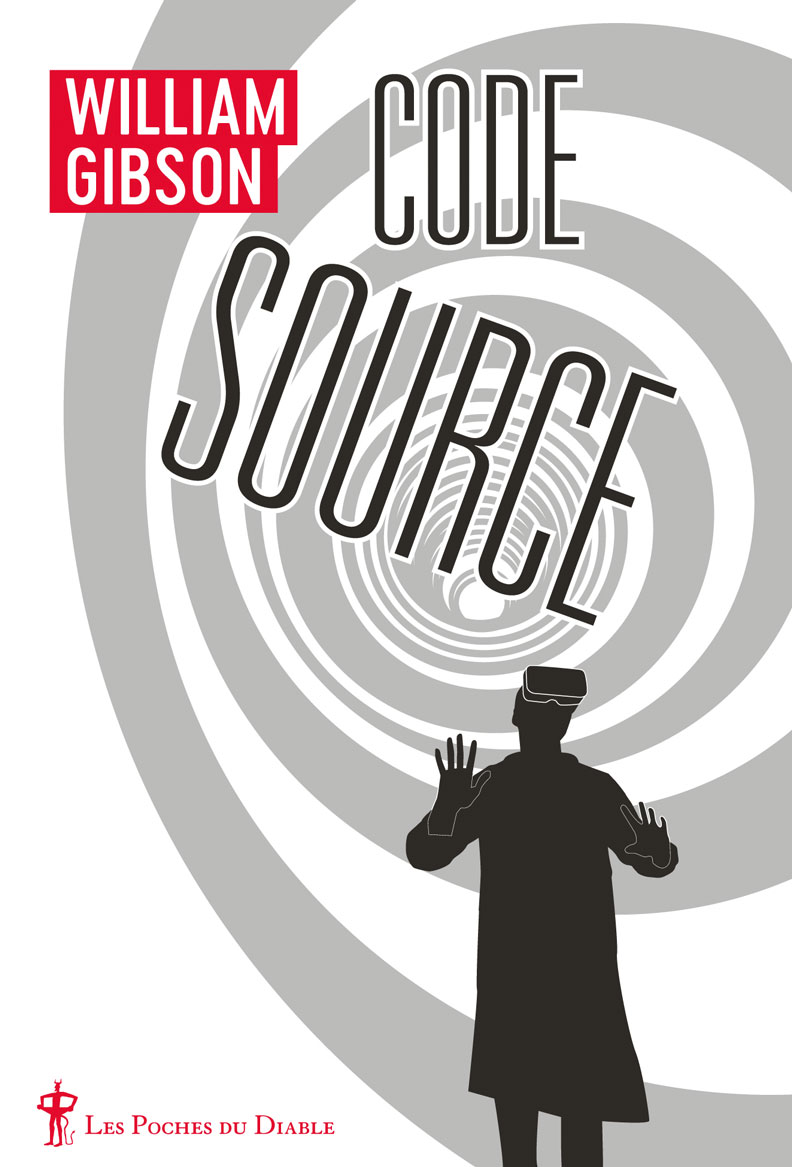
Après Gravé sur le chrome et Le Neuromancien, Code source était-il une tentative d’écrire la chronique de notre monde en voie de « cyberpunkisation » ?
William Gibson : Pas vraiment. Je ne croyais pas et je ne crois toujours pas que la SF traite directement de l’avenir. C’est une façon de comprendre le présent. Code source est une histoire contemporaine racontée comme si le présent était un futur imaginé.
Néanmoins, les GAFA ressemblent-elles aux « mégacorporations » que vous aviez imaginées ?
William Gibson : Oui, bien qu’elles soient terriblement banales, dépourvues d’intérêt et pas sexy pour un sou !
Quelle est votre opinion sur le cyberpunk aujourd’hui ?
William Gibson : Le cyberpunk est aujourd’hui un rétro-futurisme parmi d’autres. Mais avec une forme d’ancrage dans le réel et c’est là que cela devient plus intéressant. Pour autant, sa force me semble tenir avant tout d’une forme de nostalgie… que je ressens également.

Quelle est votre opinion sur la vision de l’avenir des transhumanistes ? Et quelle est sa différence fondamentale avec le cyberpunk ?
William Gibson : Les pires méchants tirés du cyberpunk ont prédit avec une grande précision ce que serait le transhumanisme. C’est la figure de l’antagoniste qui néglige que toute technologie émergente échappe spontanément à tout contrôle.
Vous vous interrogez parfois sur votre héritage littéraire ? La plupart des œuvres de science-fiction concernent notre fascination pour l’avenir, mais The Peripheral est beaucoup plus axé sur la trace que nous laisserons à l’avenir.
William Gibson : Le présent est déjà bien suffisant pour que je m’en inquiète ! Le fait que nous ayons un avenir, dans lequel quelqu’un trouve de l’intérêt pour mon travail me semble déjà extrêmement optimiste !
Vous considérez-vous comme un écrivain subversif ? Et la science-fiction l’est-elle toujours selon vous ?
William Gibson : Je me considère plus comme un écrivain curieux que subversif. Je ne cherche pas de réponses qui soient en lutte aux questions posées, mais plutôt des questions dont je me suis rarement soucié d’essayer de répondre. La science-fiction fut subversive car ce fut un courant très mineur à l’époque de mon enfance. Personne ne se donnait la peine de la censurer.
Vous avez écrit un essai dans le livre intitulé Punk: An Aesthetic (2012). Quel est votre rapport au punk et au rock ? Est-ce de là que vient votre goût pour les marginaux, les rebelles ou les personnages déviants ?
William Gibson : Mon rapport à cela tient vraiment beaucoup plus de mes expériences en tant que jeune homme dans les années 1960. J’ai été influencé par The Velvet Underground et Lou Reed, autant que par n’importe quel écrivain de « fiction » que j’ai pu lire.
Comment décririez-vous la direction que pourrait prendre votre écriture à l’avenir ?
William Gibson : Je n’en ai aucune idée ! Je suis en grande partie contrôlé par mon sens du zeitgeist [l’esprit du temps, de l’époque, NdlR]. Il faudra donc attendre et voir…
Extrait du magazine Gonzaï numéro 30 consacré au cyberpunk, disponible sur commande juste ici.
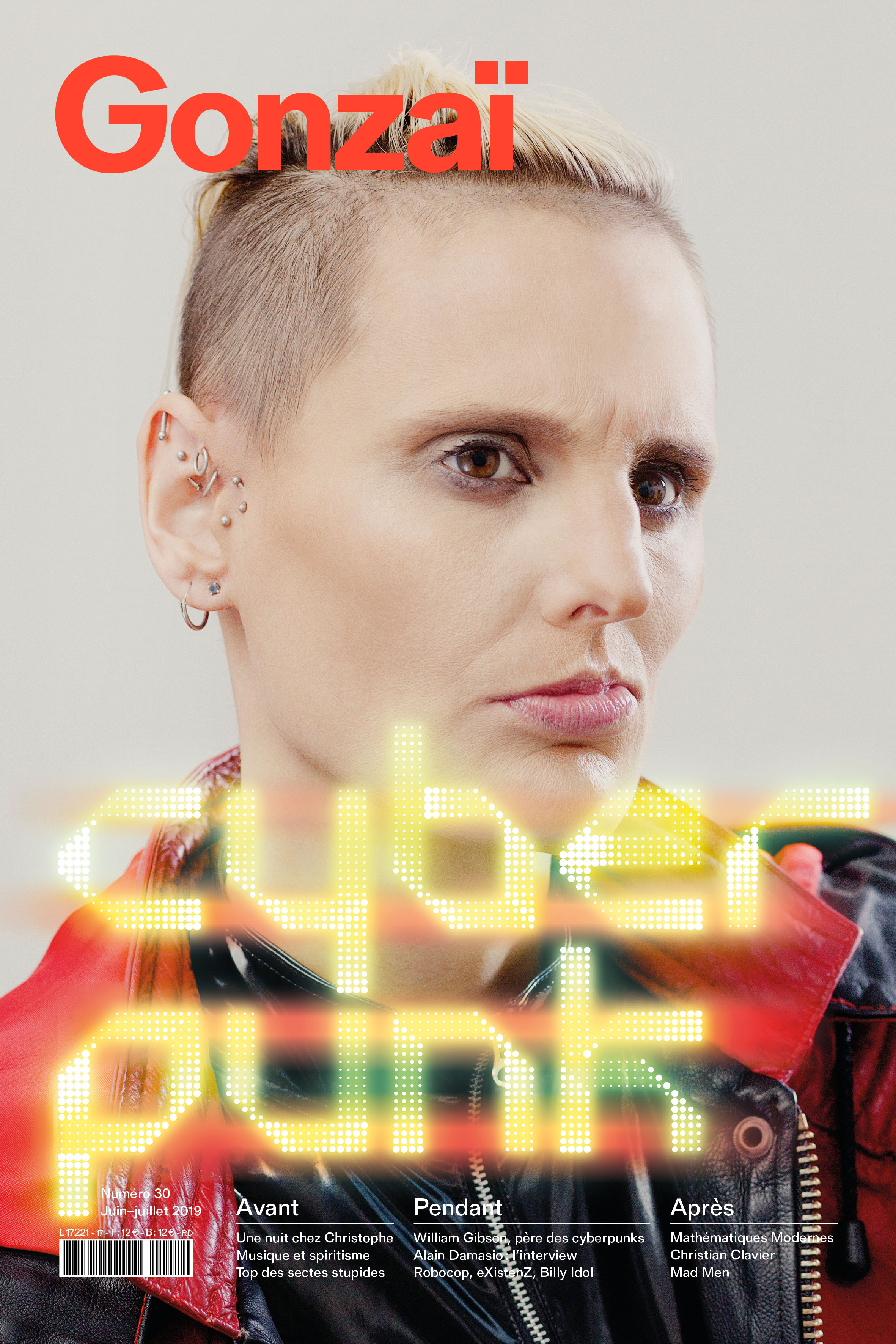









4 commentaires
MoMo VI est un grane z’ami de komme Junk
je lance d es cailloux sur le rhytme de gang of 4 (anthrax)
il a la bouille du feu mathematicien d-c-d-, non ?