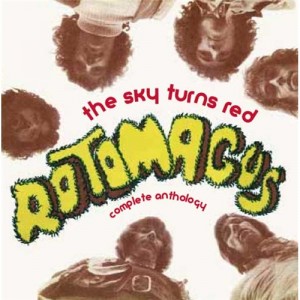 La place du mort, c’est souvent une fatalité silencieuse : crever parce qu’on n’est pas au volant, se planter parce qu’on a le malheur d’être au mauvais endroit au mauvais moment. La place du mort, c’est aussi cette place un peu bancale où l’on trouverait presque plus de rockeurs français tombés pour leur patrie que de soldats morts à Verdun. Du débarquement des yéyés en 1965 à l’arrivée du punk dix ans plus tard, le nombre de groupes français tombés pour rien est tellement édifiant qu’il n’y a pas assez de pierres tombales pour tous les enterrer. De cette période mouvementée mais pas mémorable, l’histoire aura tout au plus retenu les Variations de Marc Tobaly, le prog rock efficace du groupe Triangle, et pourquoi pas le Magma de l’affreux Christian Vander qui, dans le genre illuminé pour fans de Soft Machine reconvertis en professeurs chiants de ZEP communistes, se pose tout de même là. Quant aux autres accidentés du rock français, rien d’autre que de pâles copies de trucs déjà entendus ailleurs, et en mieux. C’est dire si l’anthologie posthume de ce groupe fier de ses racines — Rotomagus est le nom gallo-romain de la ville de Rouen — a de quoi laisser perplexe. S’agit-il d’une énième sortie du caveau sans intérêt, rééditée par un fan des Charlots et autres gauloiseries dispensables ? Sommes-nous là face à une véritable pépite oubliée, aussi surprenante qu’auraient pu être celles d’un Clapton exilé avec Cream au fin fond de la Normandie ? Faudra-t-il réécrire les manuels scolaires à la bougie avec « The Sky Turns Red » posé sur la table de chevet ? Ça fait beaucoup de questions pour un groupe dont on n’a, jusque là, jamais entendu parler. Et, au final, c’est un peu tout ça à la fois.
La place du mort, c’est souvent une fatalité silencieuse : crever parce qu’on n’est pas au volant, se planter parce qu’on a le malheur d’être au mauvais endroit au mauvais moment. La place du mort, c’est aussi cette place un peu bancale où l’on trouverait presque plus de rockeurs français tombés pour leur patrie que de soldats morts à Verdun. Du débarquement des yéyés en 1965 à l’arrivée du punk dix ans plus tard, le nombre de groupes français tombés pour rien est tellement édifiant qu’il n’y a pas assez de pierres tombales pour tous les enterrer. De cette période mouvementée mais pas mémorable, l’histoire aura tout au plus retenu les Variations de Marc Tobaly, le prog rock efficace du groupe Triangle, et pourquoi pas le Magma de l’affreux Christian Vander qui, dans le genre illuminé pour fans de Soft Machine reconvertis en professeurs chiants de ZEP communistes, se pose tout de même là. Quant aux autres accidentés du rock français, rien d’autre que de pâles copies de trucs déjà entendus ailleurs, et en mieux. C’est dire si l’anthologie posthume de ce groupe fier de ses racines — Rotomagus est le nom gallo-romain de la ville de Rouen — a de quoi laisser perplexe. S’agit-il d’une énième sortie du caveau sans intérêt, rééditée par un fan des Charlots et autres gauloiseries dispensables ? Sommes-nous là face à une véritable pépite oubliée, aussi surprenante qu’auraient pu être celles d’un Clapton exilé avec Cream au fin fond de la Normandie ? Faudra-t-il réécrire les manuels scolaires à la bougie avec « The Sky Turns Red » posé sur la table de chevet ? Ça fait beaucoup de questions pour un groupe dont on n’a, jusque là, jamais entendu parler. Et, au final, c’est un peu tout ça à la fois.
Road to Rouen
Les fossoyeurs compulsifs ayant, à force de rééditions et d’injustices tardivement réparées, fait le tour de la question anglo-saxonne, le cas de Rotomagus s’avère particulièrement intéressant. Il faudrait, pour mesurer le nombre d’emmerdes accumulées en si peu de temps, lire en entier les notes de pochette de l’anthologie publiée ces jours-ci par Martyrs Of Pop, label également rouennais. Car, dans la catégorie des groupes à qui l’histoire n’a pas fait de cadeau, celui des frères Peresse se glisse sans peine en haut de la pile, quelque part entre Anvil, les Élucubrations d’Antoine et the Zombies. Les Rotomagus, s’ils étaient nés dans la banlieue londonienne ou dans un bled paumé du Colorado, auraient eu plus de chance de percer. Pas de bol, tout commence à Rouen. Ici même où, quinze ans plus tard, les Dogs et les Olivensteins se décideront, avec les moyens du bord, à creuser un tunnel sous la Manche.
Back to 1963. Âgé de seulement 13 ans, Sylvain Peresse monte pour la première fois sur scène avec son frère qui, pour l’occasion et faute de matos à disposition, construit lui-même les guitares. Cinq années passent, pendant lesquelles les Peresse brothers enquillent dates et concerts sous différents noms, fortement influencés par un vent de british beat qui se traduit chez eux par des reprises de standards, des instrumentaux ; bref, la vie de tout groupe français au milieu des sixties. Sur leur route, les deux croisent le trio d’un certain Philippe Lhommet — par la suite membre de Dynastie Crisis, qu’on retrouve furtivement en backing band de Polnareff au début des 70’s. Début 1968, tout ce beau monde entre au studio CBE — tenu par Bernard Estardy, clavier de Nino Ferrer — pour enregistrer un premier 45 tours qui sort en mai, pendant les émeutes ouvrières. Premier problème de timing. La période est aux chœurs angéliques agrémentés d’un abominable chant en français, de rigueur pour — déjà — plaire aux directeurs artistiques. C’est le temps de titres dispensables comme Nevada ou Le Haut du pavé, suivis deux ans plus tard d’un autre 45 tours ampoulé où l’on entend, un peu médusé, un clin d’œil classique au Peer Gynt d’Edward Grieg — et à la flûte s’il vous plaît — sur Eros. Bon, il faut bien avouer que les Rouennais d’alors ne s’embarrassaient pas avec le bon goût, les foulards en soie et les postures efféminées en vogue de l’autre côté de l’Atlantique. C’était le temps de l’insouciance, c’était le temps des cerises. En fait, c’était surtout le temps de passer à autre chose.
Road to ruin
 Dans ces mêmes notes de pochette, Sylvain Peresse l’avoue sans détour, « beaucoup de groupes français [de l’époque] chantaient en anglais pour faire illusion. Malheureusement, nous n’avons pas eu de tubes comme les Irrésistibles avec ‘My Year is a Day’ [composé par William Sheller, encore hippie] ou Aphrodite’s Child avec ‘Rain & Tears’. » Ce qui, rétrospectivement, apparaît comme une bénédiction, est alors un grand drame pour Rotomagus. Pas de passage en radio, aucun soutien de la presse écrite. Trop radical pour se plier aux demande des producteurs, le groupe se disloque lentement et perd la moitié de ses membres, bien trop heureux de partir cachetonner dans la variété plutôt que de rester là à compter les mouches. « Notre erreur fut de ne pas avoir écrit au moins un titre bubblegum, assume Sylvain, du coup CBS a refusé de sortir le 33 tours promis, et nos ventes sont restées misérables. » Paradoxalement, c’est là que l’histoire devient intéressante.
Dans ces mêmes notes de pochette, Sylvain Peresse l’avoue sans détour, « beaucoup de groupes français [de l’époque] chantaient en anglais pour faire illusion. Malheureusement, nous n’avons pas eu de tubes comme les Irrésistibles avec ‘My Year is a Day’ [composé par William Sheller, encore hippie] ou Aphrodite’s Child avec ‘Rain & Tears’. » Ce qui, rétrospectivement, apparaît comme une bénédiction, est alors un grand drame pour Rotomagus. Pas de passage en radio, aucun soutien de la presse écrite. Trop radical pour se plier aux demande des producteurs, le groupe se disloque lentement et perd la moitié de ses membres, bien trop heureux de partir cachetonner dans la variété plutôt que de rester là à compter les mouches. « Notre erreur fut de ne pas avoir écrit au moins un titre bubblegum, assume Sylvain, du coup CBS a refusé de sortir le 33 tours promis, et nos ventes sont restées misérables. » Paradoxalement, c’est là que l’histoire devient intéressante.
Réduit à une formule power trio à rapprocher du Jimi Hendrix Experience, de Deep Purple ou même Led Zeppelin (si, si), Rotomagus durcit le ton. Fini le jazz à la papa. Le groupe gratte ses chansons jusqu’à l’os, laisse pousser ses cheveux et troque ses vêtements de chanteurs à la croix de bois contre la tenue des mauvais garçons. Le résultat s’avère sidérant, brutal, bruyant, sale, sacrément bordélique et diablement éphémère. De 1970 à 1972, Rotomagus compose une poignée de titres que tout le monde va rapidement oublier. Pourtant, les salves électriques que sont Shout Now, Runnin’ for Life ou Laureline s’écoutent encore aujourd’hui sans rougir. Un peu comme si les baby rockers d’hier – Naasts, Plasticines et consorts – décidaient subitement de se défoncer de l’intérieur au marteau-piqueur pour accoucher d’un nouveau répertoire digne de Quicksilver Messenger Service. Tout ça au beau milieu du no man’s land normand. On croit rêver.
Le talent ne suffit pas toujours. En dépit d’un virage à bâbord, le bateau Rotomagus prend l’eau de toutes parts et cette anthologie ne fait qu’en chanter les misères. Après 1972, silence radio : « Cela n’a pas été beaucoup plus loin, car nous n’avions pas d’argent pour assurer la promotion. À l’époque, il fallait une chanson suffisamment porteuse pour se faire accepter par les programmateurs des radios. Si tu ne les ‘arrosais’ pas, ils ne passaient pas ton disque. Le 45 tours n’a donc pas marché, et les gens étaient déçus quand ils nous voyaient sur scène, car ils s’attendaient à voir le Rotomagus ancienne formule. »
Il faudra finalement attendre 2005 et la remontée des profondeur par un nerd ricain — auteur d’une compilation hommage aux groupes français des 70’s, « Têtes lourdes » — pour que les Rouennais ressuscitent dans l’inconscient collectif ; à tel point que Julian Cope manquera de se luxer le poignet lors d’une critique ô combien élogieuse. Ainsi va la vie des miraculés du rock français, on est toujours sauvé trop tard. La pochette de ce testament n’est certes pas très belle, le mastering de l’anthologie pas optimum et toutes les chansons d’avant 1970 plutôt médiocres ; n’empêche que la destinée de ces accidentés de la (banque)route aurait certainement mérité un autre virage, un coup de volant plus heureux qui, à l’inverse de Grace Kelly, aurait permis à Rotomagus d’éviter le ravin. Mais, comme le conclut sobrement le bassiste, « il fallait bien gagner sa vie, donc nous avons fini par jouer dans les bals ».
Rotomagus // « The Sky Turns Red : Complete Anthology » // Martyrs of Pop & Lion Productions
Sortie CD & Double vinyle







