Son premier livre, Warm up, fit un petit scandale à sa sortie en 2003. Dans ce court recueil de nouvelles très hot, Bénédicte Martin, avec un style mi évaporé mi super-sexuel, raconte des scènes de cul. Le projet semble a priori banal, et pourtant, en le lisant, j’y ai trouvé un tas de choses peu ordinaires en littérature, domaine dans lequel, comme au cinéma, les personnages ne font jamais caca et ne puent jamais de la bouche le matin. Et bien là, dans Warm up, pour une fois, on parle de choses normales mais intimes. Certes, Guillaume Dustan aussi l’a fait de parler de tout, du goût d’une bite ou de l’odeur d’une sodomie. Mais Bénédicte Martin est une femme, et le monde, ce milieu d’hommes, attend(ait) évidemment autre chose d’une femme. Bref, un jour, il y a quinze ans, Bénédicte Martin débarque en littérature avec ça :
« La demoiselle a eu ses règles dans son bain. J’étais à côté d’elle, et la regardais. Pas de mousse, pas d’huile, pas de savon… L’eau était pure ; au détour d’un regard sur son entrecuisse, j’ai vu la tache. Rouge rubis, ronde, flottante à quelques millimètres du fond de la baignoire, elle se diluait imperceptiblement, auréolant le nuage vermeil d’un rose discret. L’aspect du saignement était plutôt joli. Elle s’en rendit compte à cause de mes yeux qui ne la caressaient plus, mais qui baignaient dans son petit sang. Ses joues chaudes et luisantes se mirent à rosir sous le coup de l’émotion. Elle éprouva une honte soudaine. Pas moi. Le sang qui se répandait sur l’émail semblait être celui d’un animal blessé, résigné par sa plaie.
C’est alors que mon désir a surgi comme des larmes. Mes yeux se firent plus ronds et je mouillai mes lèvres. Elle m’adressa un regard entendu et se dressa dans son bain. Le sang coula de son sexe et des goutes roulèrent le long de ses jambes humides. Les règles avaient rendu son corps fiévreux, chaud, odorant. Elle me dit qu’elle se sentait vivante dans ces moments-là. Elle se colla à moi et m’étreignit très fort. Mon clitoris mit à bander de manière assez violente. Mes mains s’accrochaient à ses bras, son dos, ses cuisses, ses fesses. L’eau bouillait joyeusement sous ses pieds, tellement elle trépignait de désir. L’ardeur sexuelle rugissante qui m’envahissait était liée à cette forte odeur de sang qui passait dans son souffle. L’amour que nous fîmes fut ensanglanté et inquiétant, mais au fond tellement inoffensif. Le sang s’était répandu partout. La salle de bains était inondée, mais nous, on était bien quand après la bataille on s’est enfoncées toutes les deux dans l’eau rose et encore chaude du bain. »
Elle et moi avons quelques amis en commun. C’est PNL (Paul-Nicolas Loesh) qui l’a d’ailleurs évoquée brièvement en ma présence il y a quelque temps, un soir neigeux où nous nous amusions tous deux à produire des concepts foireux d’émissions TV en descendant du champagne. Je n’avais fait que la lire, et j’ai eu l’envie de la rencontrer, de lui parler. Elle s’apprêtait à sortir un nouveau livre, Brisa. Le thème : sa vie à travers l’histoire de ses grands-parents. Je lui ai donc adressé un message pour lui réclamer son Brisa en vue d’une interview. Elle a dit Oui, et elle m’a envoyé le pdf. J’ai dit « Quand ? » Elle m’a dit « Dans deux jours, à 14h30, ça vous irait ? » J’ai dit « D’accord, où ? » Elle m’a dit « Aux Fauves, en bas de la Tour Montparnasse, juste à côté de feu le Sphinx » [un bordel qui a fermé en 1946]. J’ai dit « Ok, à dans deux jours. »
Le ciel était menaçant ce jour-là. C’était juste après le jour de l’an. Pour aller au rendez-vous, j’ai mis un col-roulé Dries Van Noten en alpaga parce qu’il faisait froid et un ciré jaune parce qu’il risquait de pleuvoir. Juste avant de partir, j’ai cassé accidentellement mon vieux réflex Canon. J’ai donc pris le petit Minolta Hi-Matic qui traînait dans un coin de ma piaule. Je suis arrivé en avance au rendez-vous, face aux Fauves – un café, somme toute, très ordinaire. J’ai allumé une clope et, pour patienter, j’ai été mater la vitrine du magasin de jouets juste à côté. Je n’ai jamais aimé les jouets, mais là, il y avait des manèges miniatures qui me rappelaient certaines peintures d’Authouart, ces toiles qui m’obsédaient quand j’étais môme.
Elle a débarqué sur son scooter blanc. Je l’ai aperçue en train de grimper sur le trottoir pour se garer et je me suis dit que l’on avait tous l’air de cons avec un casque de moto sur la tête. Elle semblait soit souriante, soit inquiète, je ne sais pas. Je la pensais plus grande. J’ai jeté ma clope, je lui ai serré la main pour faire féministe, et nous sommes rentrés dans le café. J’ai commencé par lui dire que j’aimais beaucoup son dernier livre (ce qui était vrai) et que j’étais heureux de la rencontrer parce que je m’ennuyais fort en attendant la sortie du mien (ce qui était vrai aussi). Peut-être dois-je aussi préciser que dans Brisa, elle lâche des merveilles de phrases comme : « La pluie, c’est Dieu qui pisse. La neige, c’est Dieu qui jute ! — Sois pas vulgaire. » Ou que je trouve ce paragraphe d’auto-analyse, parmi d’autres, sublime :
« Je ne suis née qu’en 1978 mais je sais maintenant pourquoi j’ai toujours eu le désir du boucan et de la flamboyance. Pourquoi la déliquescence des cadavres m’obsède, pourquoi la pestilence des charognes a un goût sucré à mon nez. Pourquoi je fais mal la différence entre le pur et l’impur. Pourquoi la décadence des femmes me plaît, le courage des hommes en armes m’attire, pourquoi j’aime écrire sur les sexualités périphériques, pourquoi je n’ai jamais su choisir entre la sueur des aisselles des filles et le liquide blanc des gars. »
J’ai donc commencé par lui parler de son bouquin :
À quel moment as-tu ressenti le besoin d’écrire au sujet de ta famille ?
Il y a eu un élément déclencheur : c’est quand j’ai dit à ma grand-mère que j’étais amoureuse d’une fille. J’avais vingt ans. Ma grand-mère a très bien réagi ; elle s’en est presque amusée. Cela fait donc plus d’une dizaine d’années que je porte ce livre, et je ne voulais pas le sortir du vivant de mes grands-parents, mais puisqu’ils sont désormais morts… Ça a été dur de l’écrire. Surtout que je vis toujours dans leur appartement, un endroit habité par des fantômes… Mais ça va, je crois que je suis saine d’esprit.
C’est une enquête sur toi-même ?
Oui, c’est autant un livre sur moi que sur mes grands-parents.
Pourtant, je trouve qu’il s’agit de ton premier texte pudique.
Ma pudeur est ailleurs. Mon corps, on l’a vu beaucoup. Ça m’est beaucoup plus difficile de me confier ou d’écrire que de faire des photos.
Ton fils est aussi très présent dedans.
Je me pose souvent la question de la transmission. Quand j’étais enceinte de lui, ma grand-mère m’a offert une bague, que je porte toujours et que je transmettrai un jour. À l’époque où j’étais en analyse, j’ai parlé à ma psy des Aventures de Télémaque (Fénelon), roman qui aborde la question de la transmission. En fait, je crois que c’est une des questions centrales de ma vie. Mon prochain livre aussi portera sur ça, et plus précisément sur la difficulté que j’éprouve à avoir un fils alors que l’univers des garçons m’est assez inconnu ; j’aurais sans doute trouvé cela plus facile d’élever une fille ; un garçon, ça me perturbe. Physiquement, il est différent de moi ; il a son caractère ; je me retrouve en terres inconnues avec lui. Je ne me suis d’ailleurs jamais reconnu dans les discussions entre mamans ou les réunions parents-profs. Ce rôle de mère ne m’est pas naturel. Et pourtant, ça m’intéresse de me questionner sur ce que je peux lui transmettre malgré cette difficulté effective dans la transmission, donc d’écrire là-dessus.

Dans Brisa, tu traites de plusieurs époques, plusieurs thématiques historiques comme la guerre, la décolonisation et les crises que cela a généré à Paris comme en Algérie, et à chaque fois, tu te gardes bien d’émettre la moindre opinion radicale sur ces sujets, comme si tu prenais garde à ne froisser personne, à rester politiquement correcte.
C’est vrai, mais si j’avais fait cela, si j’avais émis des opinions plus personnelles ou plus radicales, j’aurais aussi dû juger mon grand-père. J’ai, par exemple, beaucoup adouci son rôle dans cette histoire. Je ne voulais pas non plus me brouiller avec toute ma famille. J’ai encore eu, la semaine dernière, une discussion avec ma tante qui a lu le livre et qui me disait : « Papa se retournerait dans sa tombe en lisant ça ! » À un moment, j’ai failli faire ce livre sur lui plus spécifiquement, en m’interrogeant sur comment il avait pu passer du rôle de résistant pendant la guerre à commissaire de police pas fidèle à Maurice Papon mais pas opposer non plus à lui dans un premier temps, ni à ses hommes, les casques bleus, et à leurs pratiques. Après, il a aussi aidé le M.N.A. (Mouvement national algérien) en leur fournissant des armes. Puis, vers 1962, une lettre ouverte de policiers opposés à Papon a été diffusée, et mon grand-père, signataire de cette lettre, a été muté à Saint-Ouen après cet événement. Il n’a pu réintégrer un commissariat parisien – celui de Javel, dans le XVe arrondissement – qu’après le départ de Papon de la préfecture de police.
Et je me suis aussi dit qu’il fallait que je fasse très attention en abordant les années qui concernent la crise algérienne. J’ai l’impression qu’il s’agit d’un sujet encore assez peu exploré en littérature, et j’ai préféré prendre des pincettes en traitant ce thème. Surtout qu’à notre époque, il faut être vigilant à ce que l’on écrit.
Mais toi, quel regard portes-tu sur les grands moments historiques que tu abordes dans Brisa ?
Personnellement, j’éprouve beaucoup d’empathie pour le peuple algérien ; ma mère est née dans une colonie et a vécu la décolonisation, et je vois bien que les gens la tutoient facilement, ce qui est un genre de petit racisme ordinaire.
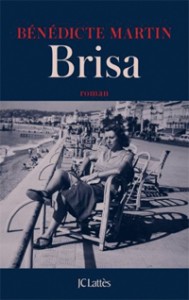 Fin de l’interview pour la partie Brisa. Je crois que, à ce moment-là, nous avions fait le tour du sujet. Ce n’est pas que son bouquin ne méritait pas d’avantage de questions, mais plutôt que Bénédicte est le sujet de ses propres livres, et que la questionner sur elle me paraissait, à ce stade de l’entretien, plus utile que de jouer à l’enfilanthrope de drosophiles qui pinaille sur des détails de forme et de fond ou des interrogations métaphysico-littéraires qui n’intéresseront, de toute façon, personne.
Fin de l’interview pour la partie Brisa. Je crois que, à ce moment-là, nous avions fait le tour du sujet. Ce n’est pas que son bouquin ne méritait pas d’avantage de questions, mais plutôt que Bénédicte est le sujet de ses propres livres, et que la questionner sur elle me paraissait, à ce stade de l’entretien, plus utile que de jouer à l’enfilanthrope de drosophiles qui pinaille sur des détails de forme et de fond ou des interrogations métaphysico-littéraires qui n’intéresseront, de toute façon, personne.
Nous avons alors poursuivi notre conversation en déviant vers son rapport à la vie et à l’écriture – notions ô combien similaires pour beaucoup d’écrivains. Elle a commencé avant même que je pose la moindre question :
Je pense que ça ne sert à rien d’écrire si l’on n’est pas sincère. J’écris parce que c’est mon moyen d’expression, le seul médium que j’ai trouvé pour pouvoir communiquer avec les gens. Parce que je ne m’exprime par forcément bien à l’oral, que je suis quelqu’un qui ne montre pas de preuves d’amour physique, que je ne suis pas tactile ; quelque part, je suis handicapée socialement. Et j’aime particulièrement cette citation de Duras dans laquelle je me retrouve : « Écrire aussi ne pas parler. C’est se taire. C’est hurler sans bruit. »
Dans ton dernier livre, tu écris : « Je crois au passif successoral sensoriel. » C’est quoi, le « passif successoral sensoriel » ?
Je pense qu’il y a des gestes sensuels, voire sexuels, qui me sont dictés par mes ancêtres. J’ai l’impression que si ma main rampe sur la joue d’une fille qui me plaît, ce n’est pas uniquement la conséquence de l’expression d’un désir spontané mais plutôt le résultat d’une éducation que j’ai reçue, des sensations d’enfance dont je me souviens ; c’est comme si cette main sur une joue n’était que le résultat, la fin d’un long cheminement qui m’avait mené jusqu’à là, cette joue. Je ne me sens cependant pas comme une marionnette dirigée par ma famille ou mon passé, mais je ne peux pas nier que je me sens dirigé, dans mes choix et mes envies, par la manière dont j’ai été touchée, bercée, trimbalée. C’est ça que j’appelle le passé sensoriel.
« J’ai toujours été très sensible à tout ce qui est organique. »
Et ça te protège ou ça te plombe, ce rapport particulier au passé ?
Les deux. Pendant un moment, je pensais que ça m’emprisonnait. Mais en vieillissant, je m’aperçois que ce passif sensoriel m’a parmi de m’ouvrir aux autres et au monde avec beaucoup de facilité ; je touche qui j’ai envie de toucher.
Ta fascination pour le corps, sur ce que le corps émet, fait, provoque, ça te vient de là ?
J’ai toujours été très sensible à tout ce qui est organique.
Oui, ça j’ai bien compris, mais pour être clair, j’ai l’impression que je ne lirai jamais un livre de Bénédicte Martin sans descriptions minutieuses d’éjaculations, de mouille, de frissons. Dans Warm up, tu racontais par exemple une scène où tu allais, pour le sortir de la misère sexuelle le temps d’un instant, baiser avec le clochard qui vivait en bas de chez toi ; tu parlais de l’odeur de sa bite en le suçant, de la sensation de ses mains rugueuses et sales contre ton corps… Ça dépasse le cadre de la simple sensibilité à l’organique ça, non ?
Oui, mais là, on revient à la question d’honnêteté dans l’écriture. Mon premier fantasme, mes premiers émois, la première personne à laquelle j’ai pensé en me masturbant à l’époque, ce n’était pas le beau mec du lycée mais plutôt le prof de sport, le type toujours en jogging, que j’imaginais sentant la sueur ; ça m’excitait à cause de la charge érotique interdite que cela comportait. Si je sonde mes souvenirs, mes premiers désirs sexuels n’avaient donc rien de fleuris ou d’enchantés. Je crois d’ailleurs que les jeunes filles se masturbent plus en pensant à des monstres qu’à des beaux hommes. Après, heureusement, ça se raffine en vieillissant. Je ne suis personnellement plus très branchée « monstres », même si j’aime toujours les gueules, les vraies.
Sinon je pense que toutes mes émotions passent par mon corps. Enfant, je faisais beaucoup de crises d’angoisse, des crises physiques ; c’est avec mon corps que je perçois le monde. L’idée de la photographie thermique par exemple, sur laquelle on ne voit que la chaleur des organismes, ça me plaît beaucoup. Et quand j’ai eu mon fils, j’ai été fasciné d’avoir produit moi-même un corps humain, un organisme ! Je me suis demandé comment j’avais réussi à faire des orteils, des yeux des mains… ça m’a semblé incroyable.
« Je m’arsouille au Xanax depuis vingt ans. C’est une béquille. »
Tu te voyais devenir mère ?
J’ai toujours eu envie d’avoir un enfant. Il était très désiré. Bon… évidemment, il y a des choses que je n’ai pas vécues à cause de la maternité. Et ça me manque parfois de sortir beaucoup, mais j’ai l’impression que je n’aurais plus l’énergie pour le faire.
Et comment es-tu devenue écrivain ?
Je faisais mes études de philo, et mon job étudiant, c’était habilleuse sur les défilés de mode. Puis j’ai été débauchée par Dior pour devenir l’assistante de l’attachée de presse de la haute couture. Ça ne me plaisait pas du tout. En même temps, je venais de signer un contrat avec une agence londonienne, et j’étais souvent là-bas. Bref, je papillonnais, j’écrivais de petits textes pour moi, pour des magazines comme Trax, et lors d’une soirée, j’ai rencontré Stéphane Million. Il m’a dit qu’il aimait bien mes articles et quand je lui ai dit que j’avais d’autres textes en réserve, il m’a donné rendez-vous. Je m’en souviens encore : nous devions nous retrouver vers République ; j’avais un panier en osier, et sur le chemin, j’ai fait tombé mon panier et toutes les feuilles de mon manuscrit se sont envolées place Saint-Michel ; c’était l’été, c’était bondé ; les voitures roulaient dessus ; j’étais catastrophée. Mais, il a bien aimé les feuilles que j’avais réussi à sauver. Il m’a aussi parlé de sa revue, Bordel, et deux jours plus tard, j’ai reçu un coup de fil de Beigbeder qui avait lu mes textes. Il en voulait d’autres pour faire un livre. C’est devenu Warm up.
Dès la sortie, je me suis sentie piégée par cette petite notoriété soudaine ; j’ai compris que je ne pouvais plus faire marche-arrière ; que désormais, mon visage était associé à un personnage, et que ça resterait ainsi. Mais j’ai aussi vite compris que cette notoriété ne s’étendait pas au-delà de Paris, qu’elle durait deux mois tout au plus, et qu’un petit écrivain en chassait un autre tous les trimestres dans ce milieu. Après ça, je me suis mise en retrait, j’ai rencontré le père de mon fils [Jean-Paul Rouve] et j’ai arrêté de sortir.

Peut-être que je me trompe, mais j’ai l’impression que tes livres ont été écris sous Xanax ; tu fais des phrases belles mais cotonneuses, presque comme si tu étais parfois extérieure à toi-même.
C’est vrai : je m’arsouille au Xanax depuis vingt ans. C’est une béquille. Après avoir essayé beaucoup de trucs, le Xanax est finalement ce qui me convient le mieux. Beaucoup picolent pour écrire ; moi, ça ne me réussissait pas. Prozac et Xanax, ça fait un bon petit duo ; ça m’équilibre à mort. J’adore cette sensation cotonneuse, le flou dans lequel ça me met ; j’ai l’impression de vivre dans une sorte de halo pastel. En plus, c’est une drogue légale. Et même mon médecin trouve que j’écris bien sous benzodiazépines.
Comme elle avait aussi écrit un livre sur Simone de Beauvoir et qu’elle était souvent présentée dans les médias comme une féministe convaincue et presque militante, la questionner sur cette thématique m’a soudain paru comme étant une idée judicieuse :
On te classe souvent dans la case « féministe pro-sexe ». Ça te convient ?
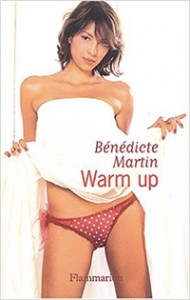 C’est exact que l’on me colle toujours dans cette case. J’abordais ce sujet avec Frédéric Beigbeder, mon premier éditeur : Warm up, ça m’a stigmatisé comme quelqu’un qui fait de la littérature de genre, comme une fille légère parce que je posais dévêtue sur la couverture de mon livre et qu’en littérature, ça ne se fait pas. Les gens ont pris au sérieux ce qu’il y avait d’écrit en quatrième de couverture de mon premier livre : « Bénédicte Martin ne fait rien ». Et le côté fille tête à claques qui ne travaille pas et qui est éditée facilement est resté… J’ai eu le droit au procès classique : elle est éditée parce qu’elle est jolie, parce qu’elle a probablement couché avec Frédéric Beigbeder ; en gros, on m’a accusé d’avoir profité d’une promotion canapé et de trop passer à la télé, et aussi d’avoir grandi dans les beaux quartiers de Paris, comme si c’était de ma faute. Or, il y a méprise : je ne suis pas spécialement conne. Les gens, jusqu’à certains de mes ex, sont par exemple étonnés que je lise des choses comme Romain Rolland ou que je puisse avoir une licence de philo.
C’est exact que l’on me colle toujours dans cette case. J’abordais ce sujet avec Frédéric Beigbeder, mon premier éditeur : Warm up, ça m’a stigmatisé comme quelqu’un qui fait de la littérature de genre, comme une fille légère parce que je posais dévêtue sur la couverture de mon livre et qu’en littérature, ça ne se fait pas. Les gens ont pris au sérieux ce qu’il y avait d’écrit en quatrième de couverture de mon premier livre : « Bénédicte Martin ne fait rien ». Et le côté fille tête à claques qui ne travaille pas et qui est éditée facilement est resté… J’ai eu le droit au procès classique : elle est éditée parce qu’elle est jolie, parce qu’elle a probablement couché avec Frédéric Beigbeder ; en gros, on m’a accusé d’avoir profité d’une promotion canapé et de trop passer à la télé, et aussi d’avoir grandi dans les beaux quartiers de Paris, comme si c’était de ma faute. Or, il y a méprise : je ne suis pas spécialement conne. Les gens, jusqu’à certains de mes ex, sont par exemple étonnés que je lise des choses comme Romain Rolland ou que je puisse avoir une licence de philo.
Tu crois que le milieu littéraire parisien, qui n’est pas peuplé que de gens beaux, t’en veux d’être belle ?
Oui, c’est possible, aha. Pourtant, ils baisent beaucoup entre eux. Je n’y suis pour rien ; j’ai la gueule que j’ai, et je n’aime d’ailleurs pas tous les jours ma gueule. Mais le respect ou la reconnaissance, je les obtiendrai à l’usure, par mon travail et seulement par mon travail.
Et en vieillissant, on t’emmerdera moins avec ton physique.
Oui. Mais peut être que je ferai des injections ou de la chirurgie pour ne pas trop vieillir. On dira : « en plus, elle n’est pas naturelle ! »
« Ça me gave de jouer l’écrivain érotico-féministe de service. »
Tu penses que ton image de fille légère de la littérature germanopratine tient donc à la couverture de ton premier livre ?
J’en ai un peu voulu à mon éditeur pendant un moment. Lorsque Frédéric Beigbeder est parti de chez Flammarion, une fournée d’auteurs qu’il avait signés n’a pas été prolongée par la maison, et moi, je suis restée. Sauf qu’étant toujours trop connotée « Beigbeder », je ne m’y suis plus sentie bien ; on ne m’y prenait pas au sérieux ; Florian Zeller a eu le même problème à l’époque. Je me souviens d’un article publié dans Marianne où l’on nous qualifiait, en gros, de gens beaux mais cons. Et j’en ai donc voulu à mon éditeur, parce que j’étais jeune et naïve, de m‘avoir laissé faire la couverture de mon bouquin avec une photo légère de moi ; je ne voyais pas ce qu’il y avait de choquant là-dedans ; venant de la mode, ça me paraissait normal ce genre d’image. Or, Frédéric Beigbeder savait très bien le scandale que ça allait provoquer : un auteur en petite culotte sur sa propre couverture de livre, ça n’a pas plu ; au mieux, ça a amusé. Puis il faut aussi dire que nous n’avions pas prévu ça au départ ; à la base, ça devait être la photo d’une fille, par Terry Richardson. Mais au dernier moment, la mannequin a refusé que la photo soit utilisée parce que l’image sulfureuse de Terry Richardson la gênait pour la suite de sa carrière. Donc je l’ai remplacée au dernier moment ; on a pris la photo à la volée, dans un coin du bureau, en rigolant tous ; j’ai levé ma robe et c’est devenu la couverture de mon premier livre. Résultat : après mon passage chez Ardisson, j’ai arrêté de prendre le métro parce que je me faisais traiter de pute.
Et tu penses que tu es féministe ?
Ça me gave de jouer l’écrivain érotico-féministe de service. Je n’aime ni les églises, ni les castes, ni les groupes : je trouve cela dangereux. Et pour moi, le problème du féminisme, c’est le phénomène de meute que cela génère. Dès qu’on est plus de quatre, on est une bande de cons. J’ai aussi l’impression qu’être féministe aujourd’hui, c’est tellement facile, tellement convenu… c’est propre d’être féministe ; on en fait même des t-shirts chez Dior. La moindre petite actrice américaine se revendique désormais féministe pour faire carrière. C’est une chose complètement galvaudée. Je pense plutôt que toutes les femmes sont féministes à leur manière ; il s’agit d’une chose individuelle ; si quelqu’un m’emmerde, j’ai toujours su et je saurais encore me défendre. Je suis féministe toute seule ; je n’ai rien à prêcher. Et J’espère que les futures femmes n’auront pas forcement besoin de se regrouper pour se défendre.
Et ça consiste en quoi, ton féminisme à toi ?
Je veux juste que l’on me laisse mener ma vie comme je le désire ; si j’ai envie d’être vulgaire, grossière, si j’ai envie de m’habiller sexy, je le fais. Je veux juste être aussi libre que n’importe quel individu au monde, qu’il soit homme ou femme. Puis, le simple fait de mettre un mot sur cette lutte des femmes, ça m’agace : le féminisme n’est qu’un humanisme comme les autres. Les questions de genre(s), telles qu’elles sont posées à notre époque, m’agacent tout autant. Je trouve d’ailleurs que ce mouvement actuel, qui consiste à « balancer son porc », est contre-productif. En France, les zones grises existent et ne doivent pas être réglementées ; entre la galanterie et la goujaterie, on ne sait pas trop… Et personnellement, j’aime bien les caractères cavaliers.

Et toi, tu n’as personne à dénoncer ?
Non, je suis plutôt du genre à envoyer des mafieux ukrainiens en représailles… Mais plus sérieusement, moi aussi, des mecs m’ont fait chier. Cependant, je n’éprouve pas le besoin de dénoncer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il n’y a que par mon travail que je me venge… mais je finis toujours par me faire la personne à l’écrit, un jour ou l’autre.
« Dans ton article, tu écriras que je suis méchante, comme ça les gens me craindront… »
Vraiment ?
Tu veux un exemple ?
Oui.
À la sortie de Warm up, un présentateur télé m’avait invité à son émission. Puis il m’avait proposé de venir assister à l’enregistrement d’une autre émission qu’il animait. J’y suis allée. Une fois sur le plateau, je réalise que toutes ses assistantes ont l’air à la fois gênées par ma présence et habituées à ce qu’une jeune fille accompagne ce monsieur au travail. En fait, j’étais certainement la quatrième gonzesse de la semaine qu’il ramenait ainsi. Entre chaque prise, il essayait donc de m’impressionner, il me faisait des clins d’œil, il me lançait des vannes… Bref, traquenard ! Puis il m’emmène dans son bureau. 22 heures : l’immeuble commence à se vider. Et il me saute dessus… Je suis parvenue à m’en dégager ; j’ai minaudé en lui disant : « tu sais, ce n’est pas convenable, pas comme ça ». Et je suis partie. Je n’ai pas vécu cela comme un grand traumatisme mais je m’en suis souvenue.
Donc tu ne l’aimes pas beaucoup, ce présentateur ?
Ce qui m’a mise hors de moi, c’est que, dans l’un de ses livres, il décrit un personnage qui me correspond en tous points, qui est moi, et qu’il me faisait passer pour une fille amoureuse de lui, complétement baba d’admiration devant sa personne. Bref, tout un tas de conneries. Il m’a prise pour une petite minette en DEUG de lettres qui serait touchée par cette « hommage ». Alors que pour moi, ce n’était qu’un vieux schnock qui puait de la gueule.
T’es rancunière ?
Dans ton article, tu écriras que je suis méchante, comme ça les gens me craindront…
S’est abattue sur nous une averse monstrueuse. Mais nous étions à l’abri. En attendant que le ciel se calme, je l’ai prise en photo encore quelques fois. Elle m’a montré les portraits des personnages de Brisa qu’elle trimbalait dans son sac. En déconnant, elle m’a lâché qu’elle aurait aussi fait un « parfait petit pédé » si elle était née garçon. Ça m’a fait rire. Je lui ai dit « T’es dans la merde avec la pluie et ton scooter ». Elle m’a répondu qu’elle passerait d’abord au Monoprix pour faire quelques courses. Avant de partir, je lui ai demandé Y a-t-il un livre que tu rêverais d’écrire ? Elle m’a dit Probablement le livre que Mireille Havet n’a pas eu le temps d’écrire. J’ai enfilé mon ciré, on s’est fait la bise et j’ai tracé.
Trois jours plus tard, j’ai récupéré les photos que j’avais prises avec le Hi-Matic. Un massacre. Quelque chose dans l’appareil était défectueux, l’objectif, l’ouverture, le mécanisme, je ne sais pas (en fait, il était juste flingué m’a dit le gars du magasin de photo où j’ai mes habitudes). Tout était flou. Je suis donc retourné prendre un café avec Bénédicte un matin, à 8h30, pour refaire des photos avec un Pentax ME, une petite merveille.
C’était plus fun que la première fois aux Fauves. Nous avons parlé de son livre qui venait juste de sortir… dans un silence presque total. Je trouvais les journalistes parisiens injustes avec elle ; son livre est bon, bien meilleur qu’un album d’Eddy de Pretto ou de Chaton, par exemple, ces deux nouvelles figures fragiles, anti-phalliques, aux styles respectivement issus du Moyen-Âge et du Néolithique qui font kiffer les rédacteurs incultes et sans envergure des Inrocks ou de Libé, ces torchons subclaquants sous perfusion désormais moins lus qu’un skyblog et que l’on aurait dû ranger aux rayon des vestiges de la presse de genre depuis longtemps. Alors puisque ces cons sont incapables de te l’écrire, je vais le faire : Bénédicte, Brisa est un beau livre qui mérite d’être lu et tu es une vraie écrivain.
Bref, je suis sorti de ce second rendez-vous avec une seule chose en tête, cette certitude, vague mais ferme, que Bénédicte est un être admirable.
PS : En y repensant, je me suis dit que la seule chose que j’ai oublié d’écrire dans cette interview, c’est que Bénédicte est aussi égérie pour une crème de beauté à la bave d’escargot en Corée du Sud (elle succède à Sophie Marceau), et que ça m’impressionne toujours énormément, ces carrières futiles dans des pays lointains.






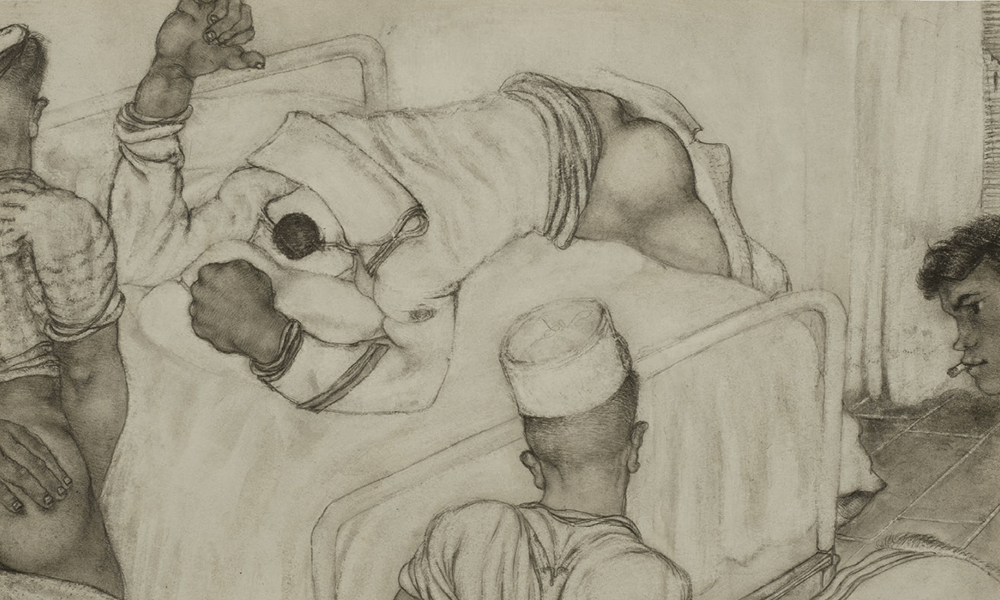

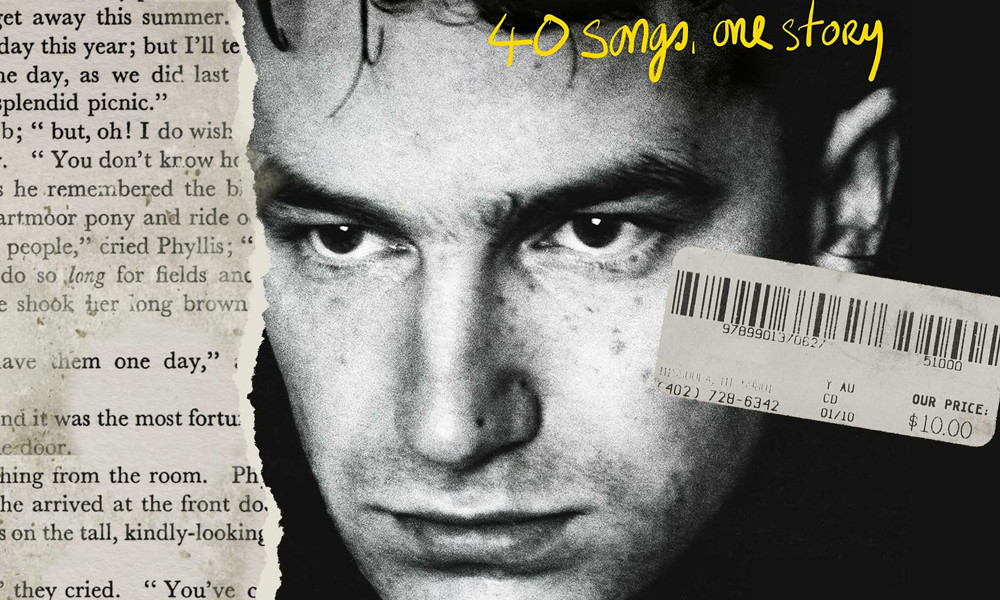

12 commentaires
qu’elle essaye aussi d’entrer dans le cerveau de Genesis Breyer P-Orridge, & là nous commencerons @ la prendre…………………….au serieuex………….
gros gros malaise ces vieilles vidéos d’ardisson
Bonsoir, je suis madame berkani chantal pas de justificatif requis en vue de soutenir toute personne en situation difficile, Cette vision pluraliste et internationale de
l’investissement m’a conduit vers un nouveau type d’investissement qui est le prêt. En effet, j’offre mes services à des particuliers
honnêtes qui sont dans le besoin d’appui financier pour soit créer des activités lucratives soit pour s’assurer d’un lendemain meilleur avec un taux d’intérêt selon la demande que vous feriez.
En bref, c’est un peu un justificatif des nombreux prêts que je fais.
Je ne voudrais en aucun cas violer la loi sur l’usure. Je prête à toute personne honnête et sérieux , pouvant bien sûr me rembourser dans un délai raisonnable. Votre demande doit contenir le montant dont vous
avez besoin, de l’utilité du prêt. N.B.: Mon but est de faire des prêts aux personnes dans le besoin.
Veillez me contacte à mon mail privée: berkani.chantal@hotmail.com
Mme; Berkani chantal
elle était bien contente d’aller chez Ardisson et de se frotter à begbeder dans les cocktails. c’est n ‘importe quoi ces réponses sur les plateaux télé, tu as juste envie de lui envoyer trois beignes tellement c’est idiot.. pas de sincérité et beaucoup de cynisme. c’est une pauv’ petite chose la martin quand même. rien d ‘admirable et toujours la même laideur de perversion. encore à mettre aux chiottes…rien de changer derrière tous ses mensonges .
Ça pue le « journaliste » qui essaye de se pécho la meuf. Il est pathétique cet artickle.
Elle me donne l’envie de vomir… Elle transpire la bêtise. Glauque à souhait. Brrrrrrr….
Personne n’en parle parceque c’est juste de la merde, comme tous ses autres livres d’ailleurs. a part parler le cul, montrer le sien et allumer son monde cette fille ne sert à rien. rlle a serieusement morfler depuis son la couvertuere de son premier livre, elle fat toute tapée.
j’avais un petit coup de blues mais MERCI GONZAI, vous m’avez redonné espoir. Quand je lis des torche-culs comme celui ci (disons les choses comme elles sont) je me dis qu’il y en a qui vont vraiment mal. Quelle déprime cette pauvre femme rance et rongée par l’aigreur, starlette ratatinée de son micro monde en toc et sans la moindre consistance. Merci mes petits choux. Bisous-bisous