 C’est un soir comme un autre, un soir que les journalistes à qui on envoie des disques ont l’habitude de connaître. Sur l’étagère, il y a une petite pile de CD’s promo qui attendent patiemment leur tour, personne dans les parages pour vous casser les pieds, enfin un peu de temps à perdre pour une écoute à tête reposée. Par un geste qui doit beaucoup au hasard, l’un des CDs gagne son accès à la platine. C’était pas gagné : l’objet est gravé à la va-vite (le packaging est une chose très importante pour les fétichistes désabusés que nous sommes) et il est l’œuvre d’un type que l’on situe plutôt en seconde division et dont on n’attend rien en particulier. Enfin… pas ce disque-là.
C’est un soir comme un autre, un soir que les journalistes à qui on envoie des disques ont l’habitude de connaître. Sur l’étagère, il y a une petite pile de CD’s promo qui attendent patiemment leur tour, personne dans les parages pour vous casser les pieds, enfin un peu de temps à perdre pour une écoute à tête reposée. Par un geste qui doit beaucoup au hasard, l’un des CDs gagne son accès à la platine. C’était pas gagné : l’objet est gravé à la va-vite (le packaging est une chose très importante pour les fétichistes désabusés que nous sommes) et il est l’œuvre d’un type que l’on situe plutôt en seconde division et dont on n’attend rien en particulier. Enfin… pas ce disque-là.
Le premier morceau passe, bien plus vite que ses six minutes au compteur, et stupeur, il s’est passé un truc. Pourtant, ça tient à rien : un beat, un motif électronique, une ligne de basse qui nous renvoie aux grandes heures de la new-wave, et la voix de Georg Levin (collaborateur régulier du label allemand Sonar Kollektiv) qui se noie progressivement dans une mélancolie insondable. Ah si : il y a aussi un break dément (vers 3’30), et celui-ci semble résumer à lui seul toute la passion qui transpire de ce truc-là. Bon. Deuxième morceau, construction et esthétique similaires au premier, une nana a pris le relais au chant, c’est toujours aussi élégant, d’une évidence presque désarmante, genre de pop vulnérable qui s’invite sur le dancefloor : deuxième hit potentiel pour les radios « indie ». Troisième titre, changement de ton : une lente odyssée ascensionnelle à situer quelque part entre krautrock et disco sous tranxène, hantée, totalement addictive. Parvenu à ce stade, on prie le ciel pour que le reste soit du même tonneau, parce que dans la multitude de disques électro qui voient le jour à notre époque, peu débutent de cette façon-là. Alors très logiquement, on appuie sur la touche « stop ». Par crainte de ce qui pourrait suivre, et surtout pour revenir à ce Golden Ratio inaugural qui se pose déjà comme l’un des hits de l’année.
Premier single extrait de l’album dont il est ici question, Golden Ratio est sorti il y a six mois, et personne ou presque ne l’a remarqué. Nous non plus, d’ailleurs. Pourtant, ce morceau porte en lui la quintessence de la pop « indie » d’obédience anglo-saxonne : c’est un classique instantané, fédérateur mais délesté de toute matière grasse, empli de ce romantisme que seuls des gens du calibre de New Order parvenaient jadis à amener sur la piste de danse. Vous allez me dire : des prototypes de hits indie-dance, il en est sorti pas mal depuis cette époque pionnière où la pop célébrait ses noces avec la musique électronique. Certes, mais il est beaucoup plus rare qu’ils aient été conçus par un type qui officie essentiellement dans la house « de niche », underground et exigeante. Jusque-là, Tim Paris produisait et défendait de la musique pour un public bien défini. En un seul titre, il s’est offert le droit de voir beaucoup plus loin. « J’ai un rapport assez particulier à Golden Ratio. Je l’ai fait de manière isolée et je l’ai gardé pour moi pendant presque quatre ans, parce que je ne me sentais pas prêt à revendiquer ce côté pop de ma musique. Et puis j’ai changé d’avis… C’est le premier titre que j’ai envoyé au label pour l’album, ils m’ont tout de suite dit que ça serait le premier single. J’ai produit le reste de l’album ensuite. Dancers est donc un peu écrit autour de ce titre, même si curieusement j’ai du mal à le rattacher aux autres. » Le point de départ étant posé, il s’agissait donc ensuite de réaliser un album qui puisse venir entériner ce coup d’essai. Pas une mince affaire, car il faudrait trouver le juste équilibre entre ses éventuelles déclinaisons et la culture musicale beaucoup plus large de Tim, que beaucoup appréhendent comme un artisan discret de la house – point à la ligne. Et c’est un peu normal, puisque c’est son domaine de prédilection.
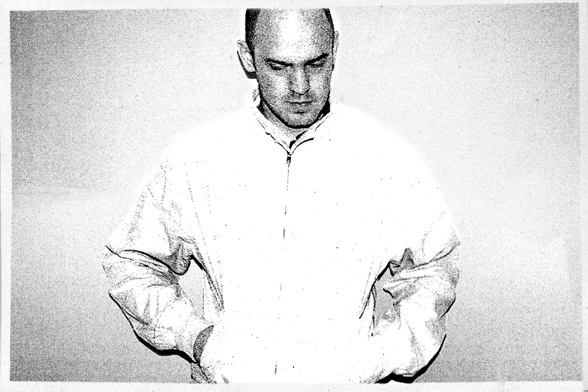
Tim Paris est une valeur sûre mais discrète de la house française depuis bientôt vingt ans. Il s’est pris de passion très tôt pour les musiques électroniques, a commencé à mixer dans la foulée, obtenu sa première date au Rex à l’âge de 19 ans. Au même moment, il rentre en stage chez Universal et y décroche bientôt un boulot. Seulement voilà, Tim ne se reconnaît pas dans la philosophie de cette major, et il ne tarde pas à rejoindre des labels indépendants de house (Silver Network puis Crack & Speed) qui traduisent alors l’effervescence d’une scène alternative à Paris. Alternative, car éloignée des enjeux et de l’esthétique propres à la French Touch naissante, moins centrée sur elle-même, plus ouverte sur l’international via des réseaux parallèles. En cela, Tim fait partie d’une génération « assez maigre de la dance music, coincée entre les gens qui ont découvert le mouvement en Europe au début des 90’s, et ceux qui ont amené cette musique vers le succès dans les années 2000. » Alors dans sa vingtaine, il rencontre tous les acteurs de la scène house du moment, fait des fêtes interminables, se lance à fond dans le DJ-ing, qui reste aujourd’hui encore son activité principale. Bref : il promeut cette musique par tous les moyens possibles, mais il ne touche encore que sporadiquement à la production, à ces logiciels qui se démocratisent et lui permettraient, peut-être, d’apporter sa propre pierre à l’édifice.
En cela, 2005 est une année charnière à bien des égards. Depuis plusieurs mois, Tim s’attèle plus sérieusement à la production, et il finit par décrocher un premier hit d’estime dans les milieux autorisés (son remix de « Future Now » sur le label 2020 Vision de l’Anglais Ralph Lawson). En parallèle, il vient de monter son propre label, Marketing Music, qu’il souhaite ne pas limiter au seul registre de la house. « J’ai toujours géré des labels, j’adore ça. C’est une manière de rendre à la musique ce qu’elle m’apporte, et je crois vraiment faire quelque chose de productif en faisant découvrir au public des artistes qui me passionnent. » Mais surtout, il déménage à Londres pour y tenter sa chance en tant que musicien. Pas simple : si la « ville-monde » est l’objet de mille et un fantasmes, elle est aussi réputée pour être difficile d’accès lorsqu’on n’est pas issu d’un certain sérail. « C’est le challenge qui m’a attiré. A Paris, je sentais que je commençais à trouver mes marques, alors je me suis dit qu’il était temps de partir. J’avais envie d’un contexte plus « international », besoin de m’isoler et de travailler sur la musique. Ça n’a pas été la période la plus agréable de ma vie, mais les premières années à Londres m’ont permis de connaître et de sentir beaucoup mieux la production. Et puis pour un amoureux de musique, l’Angleterre est vraiment un pays hors du commun : ici, elle est l’industrie culturelle principale, il y a une diversité et un foisonnement inédit en Europe. » Tim commence par travailler seul avec ses machines, dans sa cave, mais il a entre-temps retrouvé sur place un ami de longue date : Ivan Smagghe. Le prince noir du clubbing français est également installé à Londres, lui aussi en a eu sa claque de Paris, et il a quitté l’aventure Black Strobe (laissé aux commandes d’Arnaud Rebotini). Assez logiquement, les deux hommes se lancent dans un nouveau projet en 2008 (production et mix à quatre mains) : It’s A Fine Line. Ils ont en commun une passion pour la musique qui va bien au-delà des questions de genres ou de chapelles, des goûts qui puisent naturellement dans les marges. Mais ils sont complémentaires : l’un prend la lumière mais représente sa part d’ombre, l’autre préfère rester dans l’ombre pour y trouver sa lumière. Devinez qui est qui.
 Or donc, on attendait vaguement un album estampillé It’s A Fine Line (ils travaillent toujours dessus), et voici que déboule sans crier gare le premier solo de Tim Paris. Un disque à la tonalité « indie », de surcroit, que l’on sait très présente dans l’approche esthétique d’Ivan Smagghe, mais beaucoup moins dans le travail de Tim, qui ne s’en cache pas. « Dancers est teinté de rock et de new wave, mais ce sont des musiques auxquelles je ne me suis intéressé qu’assez récemment, finalement. C’est une sorte d’instantané de ma musique aujourd’hui, ça aura certainement changé d’ici quelques mois (…) Bien sûr, on pourra toujours trouver des similitudes avec la musique d’It’s A Fine Line, c’est Ivan qui m’a orienté vers le rock 50’s ou les Cramps. Mais dans l’approche et la philosophie, la musique que je fais seul est très différente. Je crois que l’on prend plus de risques esthétiques avec It’s A Fine Line, et c’est vraiment génial d’expérimenter avec Ivan. Lorsque je travaille seul, je recherche quelque chose de moins radical, de plus axé sur le plaisir de l’écoute ». S’il est donc difficile de mesurer l’influence plus ou moins consciente de leur projet en commun sur « Dancers », il n’en reste pas moins que ce dernier est signé du seul Tim Paris. Et à deux ou trois titres près (si on veut faire la fine bouche), c’est une réussite intégrale. Qui nous dit aussi, en filigrane, que son auteur en aura encore sous le coude lorsqu’il s’attaquera à d’autres influences pour un éventuel prochain disque. Mais pour l’heure, de quoi est-il fait au juste, ce « Dancers » ?
Or donc, on attendait vaguement un album estampillé It’s A Fine Line (ils travaillent toujours dessus), et voici que déboule sans crier gare le premier solo de Tim Paris. Un disque à la tonalité « indie », de surcroit, que l’on sait très présente dans l’approche esthétique d’Ivan Smagghe, mais beaucoup moins dans le travail de Tim, qui ne s’en cache pas. « Dancers est teinté de rock et de new wave, mais ce sont des musiques auxquelles je ne me suis intéressé qu’assez récemment, finalement. C’est une sorte d’instantané de ma musique aujourd’hui, ça aura certainement changé d’ici quelques mois (…) Bien sûr, on pourra toujours trouver des similitudes avec la musique d’It’s A Fine Line, c’est Ivan qui m’a orienté vers le rock 50’s ou les Cramps. Mais dans l’approche et la philosophie, la musique que je fais seul est très différente. Je crois que l’on prend plus de risques esthétiques avec It’s A Fine Line, et c’est vraiment génial d’expérimenter avec Ivan. Lorsque je travaille seul, je recherche quelque chose de moins radical, de plus axé sur le plaisir de l’écoute ». S’il est donc difficile de mesurer l’influence plus ou moins consciente de leur projet en commun sur « Dancers », il n’en reste pas moins que ce dernier est signé du seul Tim Paris. Et à deux ou trois titres près (si on veut faire la fine bouche), c’est une réussite intégrale. Qui nous dit aussi, en filigrane, que son auteur en aura encore sous le coude lorsqu’il s’attaquera à d’autres influences pour un éventuel prochain disque. Mais pour l’heure, de quoi est-il fait au juste, ce « Dancers » ?
Le premier écueil dans lequel Tim Paris aurait pu tomber était de faire un album house, avec tout ce que cela engendre de titres certes bien produits mais essentiellement destinés au dancefloor. Un album dans lequel on pioche, comme il en sort aujourd’hui des brouettes, mais qui a oublié la fonction première de ce type de format : l’écoute domestique, sur la durée. Le spectre musical couvert par le bonhomme va heureusement bien au-delà, et puise dans l’électro robotique de Detroit (Disco Ellipse), le rock venimeux et millésimé (The Grip) ou des choses nettement plus crépusculaires (You’ll never know). Le deuxième écueil, à ce propos, était de faire un inventaire de chacune de ces influences, piste par piste, en séparant distinctement leurs grammaires. Sauf que rien n’est ici figé : par le choix de leurs textures, des ambiances, tous les morceaux portent en eux une forme d’étrangeté, de déviance, ils se répondent sans que l’on comprenne vraiment comment (et c’est bien sûr très bien comme ça). Enfin, il y a ces quelques merveilles qui, par leur immédiateté pop et leur sensualité trouble, emboitent directement le pas à Golden Ratio. Elles sont également portées par des voix plutôt méconnues du plus grand nombre (bonne idée), ce qui exclue d’emblée l’option de l’album à featurings opportuniste. Les noms de Coco Solid (Rain), Forrest (Backseat Reflexion) et Sex Judas (Minireich) ne vous disent rien ? Qu’importe, ils sont à l’origine des titres les plus évidents de l’album, ceux contre lesquels toute forme de résistance est vaine. « Cela ne m’intéressait pas de faire un album pour DJs : je voulais au contraire essayer d’exprimer mon amour pour la pop et les chansons. D’ailleurs, je me suis rendu compte que cela m’était plus facile à faire que des remixes club… Chaque collaboration est issue d’un désir, d’une idée. J’ai la chance inouïe que tous les chanteurs que j’ai approchés aient accepté les morceaux. » Ajoutons que faire tenir sur un même album les voix de Georg Levin et Ben Shemie (leader du groupe Suuns – déjà remixé par It’s A Fine Line) relève d’une certaine gageure, tant le rendu final est homogène.
 Etonnamment, « Dancers » ne sort pas sur le propre label de Tim, Marketing. Mais pouvait-il en être autrement pour ce disque protéiforme, et surtout de la part de quelqu’un qui a toujours favorisé les connexions avec le meilleur de l’électronique underground ? C’est donc les Canadiens de My Favorite Robot, très prisés depuis quelques temps (on vous recommande l’écoute de leur récente compilation Crossing Wires), qui ont pris l’affaire en main. « J’avais vraiment envie de partager cet album avec d’autres personnes. Il fallait qu’un bon label ait envie de porter le projet avec moi, et quand l’équipe de My Favorite Robot m’a approché lors du Sonar 2012, je n’ai pas hésité une minute. C’est vraiment le label indépendant de demain pour moi : il a réussi à développer une électro de qualité, orientée pour le dancefloor mais pas seulement. » Sortir du lot commun de la production électro est aujourd’hui de plus en plus difficile, et les ambitions esthétiques des parties en présence se rejoignent à plus d’un titre. Pour exister, plus que jamais, il ne s’agit plus d’être le garant d’un son, d’une école, mais plus de trouver sa raison d’être au carrefour de multiples influences. « Dancers », contrairement à ce que son intitulé pourrait laisser croire, n’est pas le disque d’un homme qui vise les jambes d’un public bien particulier (celui des clubs) mais plutôt celles des gens qui appréhendent la musique comme un élément central de leurs vies, bien au-delà des questions de styles. C’est un disque de musique électronique, à n’en pas douter. C’est surtout, et plus simplement, un disque de plus à notre chevet.
Etonnamment, « Dancers » ne sort pas sur le propre label de Tim, Marketing. Mais pouvait-il en être autrement pour ce disque protéiforme, et surtout de la part de quelqu’un qui a toujours favorisé les connexions avec le meilleur de l’électronique underground ? C’est donc les Canadiens de My Favorite Robot, très prisés depuis quelques temps (on vous recommande l’écoute de leur récente compilation Crossing Wires), qui ont pris l’affaire en main. « J’avais vraiment envie de partager cet album avec d’autres personnes. Il fallait qu’un bon label ait envie de porter le projet avec moi, et quand l’équipe de My Favorite Robot m’a approché lors du Sonar 2012, je n’ai pas hésité une minute. C’est vraiment le label indépendant de demain pour moi : il a réussi à développer une électro de qualité, orientée pour le dancefloor mais pas seulement. » Sortir du lot commun de la production électro est aujourd’hui de plus en plus difficile, et les ambitions esthétiques des parties en présence se rejoignent à plus d’un titre. Pour exister, plus que jamais, il ne s’agit plus d’être le garant d’un son, d’une école, mais plus de trouver sa raison d’être au carrefour de multiples influences. « Dancers », contrairement à ce que son intitulé pourrait laisser croire, n’est pas le disque d’un homme qui vise les jambes d’un public bien particulier (celui des clubs) mais plutôt celles des gens qui appréhendent la musique comme un élément central de leurs vies, bien au-delà des questions de styles. C’est un disque de musique électronique, à n’en pas douter. C’est surtout, et plus simplement, un disque de plus à notre chevet.
Tim Paris // Dancers // My Favorite Robot
soundcloud.com/tim-paris









3 commentaires
sample de Sun Ra!
YOUUUUUUUUUUUUUUPI
trés ,trés bon disque du boss de Marketing Music..