«C’est le livre de ma vie » m’assène du haut de ses dix-neuf ans un camarade de classe en me montrant les volumes bien alignés de La Recherche sur les étagères de sa chambre d’étudiant, Aftermath sur la platine et reproductions de Boticelli aux murs. Nous sommes dans une rue du XVIIème, un samedi de janvier, nous n’avons pas trente-cinq ans à nous deux.
S’il y a un âge auquel on peut se permettre le léger ridicule de ce genre de formules, c’est bien celui-là. Et c’est avec beaucoup de sérieux que l’on s’échange fébrilement titres et nom d’auteurs avec des formules souvent pompeuses, toujours définitives. L’Idiot, La Recherche, Belle du Seigneur, le Rivage des Syrtes ou La Chartreuse passent ainsi de mains en mains, des cafés à la cour du lycée, et aussitôt suivent les heures de lecture, les yeux rougis, le souffle court, et tout le reste loin, très loin. Il y aura d’autres révélations, plus tard, d’autre chocs, mais la peau est déjà moins malléable, les enthousiasmes plus difficiles, le sentiment d’urgence moins fort.
Et – oui- ces livres changent votre vie.
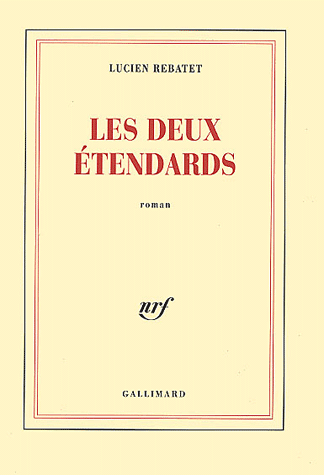 Comment oublier Le sous-sol, lu dans les souterrains de la ligne 10, ou Histoire de l’œil, pendant un mois d’avril apparemment inoffensif, alors que les pages de Bataille m’empêchaient de bouger ne serait-ce qu’un cil. Sans parler de Proust bien sûr. Chacun pourrait écrire sa propre liste, au rythme des amitiés défuntes et des heures d’ennui au lycée, ou à la fac. Au bout de la mienne et de la rangée de folios jaunis et cornés, qui la composent, un nom éclate comme un scandale : celui de Rebatet, et ses mille pages monstrueuses, irracontables, hors norme. Le titre : Les Deux Etendards, tirés de l’un des exercices spirituels de Saint Ignace. L’histoire : celle d’un amour à trois, sous fond de querelles religieuses et de mysticisme. Irracontable donc, malgré la piteuse quatrième de couverture que Gallimard consacre à la dernière édition.
Comment oublier Le sous-sol, lu dans les souterrains de la ligne 10, ou Histoire de l’œil, pendant un mois d’avril apparemment inoffensif, alors que les pages de Bataille m’empêchaient de bouger ne serait-ce qu’un cil. Sans parler de Proust bien sûr. Chacun pourrait écrire sa propre liste, au rythme des amitiés défuntes et des heures d’ennui au lycée, ou à la fac. Au bout de la mienne et de la rangée de folios jaunis et cornés, qui la composent, un nom éclate comme un scandale : celui de Rebatet, et ses mille pages monstrueuses, irracontables, hors norme. Le titre : Les Deux Etendards, tirés de l’un des exercices spirituels de Saint Ignace. L’histoire : celle d’un amour à trois, sous fond de querelles religieuses et de mysticisme. Irracontable donc, malgré la piteuse quatrième de couverture que Gallimard consacre à la dernière édition.
Pourtant, les trente premières pages nous prennent par la main sur un terrain connu : Michel et Guillaume sont deux lycéens avides de littérature, ils s’ennuient, discutent métaphysique dans la cour du lycée, découvrent Paris, font des dettes, aiment Renoir et Proust, et, bien sûr rêvent de rencontrer l’amour, le vrai. Au pays natal du roman français, rien de nouveau : Frédéric Moreau et Lucien de Rubempré rient doucement assis au bord de la grand’route sur laquelle cheminent nos deux héros. Mais, d’un coup, le vent tourne. Une fille apparaît, et avec elle une histoire rocambolesque : Anne-Marie et Régis, deux adolescents pieux et ardents, tombent éperdûment amoureux. Une nuit, sous le coup d’une illumination mystique ils décident de dédier leur amour à Dieu, de se donner encore une année avant de rentrer chacun dans les ordres. Michel, le nitzchéen ricane. En sous-main, il est troublé, le lecteur aussi. Il rencontre le couple d’amoureux, ils sont sincères, intelligents, elle est belle à couper le souffle et lui rit au nez à la nuit tombante, il l’aime du premier coup entièrement et sans appel, elle s’est donnée à Dieu et à un autre. Le livre peut commencer.
C’est alors que le roman sort des parapets pour basculer dans le précipice d’un amour fou, hors normes. Les histoires d’amour impossibles sont la moelle épinière de ce roman bourgeois français qui, de Dominique à La Princesse de Clèves, a donné tant de chef d’œuvres, mais Les Deux Etendards, grand roman religieux, choquant peut être, asséchant sans doute, inégalable sûrement, sort indubitablement de ce cadre balisé.
Anne Marie rentrera-t-elle dans les ordres ? Michel va-t-il réussir à la sauver comme il l’entend et à s’en faire aimer ?
Rebatet étire ainsi mille pages de torture morales, de digressions théologiques et d’envolées lyriques. Ennuyeux ? Non. Malgré le côté abstrait du thème, peu de romans sont autant ancrés dans une solide réalité terrestre et sensuelle, lardé de traits vif, Peu d’auteurs ont cette capacité inégalée de Rebatet de manier d’une main le scalpel (la satire de la bourgeoisie lyonnaise égale Stendahl, ou les plus drôles pages de Proust), de l’autre part le lyrisme déchirant, tout en brossant des scènes d’une sensualité rare dans le roman français où finalement l’épineuse question du sexe est plus que de nécessaire élégamment reléguée dans un renoncement élégiaque.
Steiner comparait Rebatet à Tolstoï. Et c’est vrai que sur le pavé lyonnais scènes et personnages sont tout aussi vivants, déchirants, humains, inoubliables, que Natacha Rostov et les salons de Saint Pétersbourg. Il faudrait aussi mentionner encore le tour de force de la fin du livre : alors que l’histoire semble étirée jusqu’à l’extrême dans une tension qui ne se résoud jamais, Rebatet finit par assèner 50 pages haletantes après mille de mise en bouche. Un uppercut implacable, une plongée dans les eaux profondes, qui ne sont pas sans rappeler dans la façon la splendide descente accélérée des dernières pages de La Chartreuse.
Je me tiens en général soigneusement à l’écart des jérémiades des Sainte-Beuves de la dernière heure, et des catégorisations rassurantes. Cela dit, impossible de ne pas être troublé par l’écart immense entre l’homme bilieux, souffreteux, haineux et les ailes immenses de l’écrivain flamboyant. L’enquête, si on la commence, ne peut que laisser un goût amer. On peut finir par pardonner à Céline, mais pour une raison que j’ignore, pas à Rebatet. S’il est des auteurs dont on se méfie car ils ont l’air d’être tout de même de sacré salauds, d’autres qu’on aurait bien élus comme confidents, ou copains de beuverie, il en est certains qu’on aurait aimé ne jamais connaître. Rebatet en est.
Mais l’histoire s’est vengée.
Rebatet a fini son chef-d’œuvre sur le mauvais papier de la prison de Fresne, retraçant ses notes de mémoires, faisant défiler la centaine de tableaux et d’opéras dont il parle devant le vide aveuglant des murs de sa cellule. L’homme, devant qui des foules de lecteurs débordaient des trottoirs en 1942, n’est plus qu’un prisonnier hâve qui attend la sentence dans l’attente de la condamnation qui a emporté Brasillach (Cette histoire haletante est contée dans les stupéfiantes Lettres de Prison, que Le Dilettante a eu le cran de publier). La nouvelle finit par tomber : Rebatet est grâcié. A quel prix. Le chef-d’œuvre sort dans l’indifférence générale. Malgré les voix de Blondin, Nimier, ou Etiemble qui s’élèvent, Les Deux Etendards restent largement inconnus et ignorés, condamnés à l’opprobre, par le nom de leur auteur, ou aux admirations souterraine. Lle livre décourage ou rebute souvent, il n’a rien d’universel, il faut sans doute une résonance avec des obsessions intimes, une manière d’aimer les choses.
Chez moi, ça a pris tout de suite ; comme une évidence éclatante, je n’ai cessé de le lire et de le relire. La dernière lecture – faite à quatre yeux des Pyrénées à New York en finissant sur les banquettes des bistrots de Drouot – qui valaient bien je le pensais ceux de la Place Antique – m’a laissée sur le carreau, le livre finit mal, ce n’est pas un mystère, et la lettre d’adieu d’Anne-Marie avait dans les ombres des soirs d’octobres des accents cette fois-ci bien déchirants. La vie déjoue parfois les tours que les pages des livres nous tendent. Et pendant ce temps comme l’écrit si bien Blondin : « Les Deux Etendards déchirent toujours notre ciel. »








20 commentaires
C’est quand même un livre très bavard, où l’auteur s’écoute beaucoup geindre, s’exciter, hurler, ricaner… et puis c’est terriblement vulgaire ; l’obsession sexuelle de l’auteur est pathologique. N’est pas Céline qui veut. On peut écrire sans concession, dire des choses terribles ou même érotiques mais là, chez Rebatet on est en permanence dans le gluant, les sécrétions diverses, etc. On a l’impression de Rebatet a voulu impressionner le bourgeois, et il n’y a rien de pire qu’un petit bourgeois qui veut choquer ses pairs. Quant au héros, peint comme un petit bonhomme d’un mètre soixante et surtout préoccupé de sa mise, on a envie de lui ficher des claques. Sinon, le parallèle entre Lyon et Paris est amusant (et on se rend compte combien Paris a changé, en mal, en un siècle), il y a beaucoup de moments drôles, des descriptions caustiques et contrastées, une histoire intéressante, un véritable témoignage sur les années 1920. Le style aurait gagné à un dégraissage radical et à la suppression de quelques facilités, car Rebatet dans ce domaine était une sorte de virtuose, mais qui se retenait pas assez…
Tellement heureux d’en entendre dire, un des grands éblouissements de ma jeunesse de lecteur, auprès de la Recherche, des Syrtes et … de l’Education sentimentale . Grosse envie de bloquer une demi-semaine à le relire, il est grand temps .