Vous vous sentez perdu parmi les plus de 60 000 titres mis en ligne chaque jour sur Spotify ? Nous aussi. Mais on a quand même pris le temps d’en écouter certains et voici ce qui a retenu notre attention ce mois-ci.
Animal Collective – « Isn’t It Now ? »
Mood : Animal Collective qui sort en 2023 son meilleur disque depuis des siècles. « Qui l’eut cru ? Pas eux en tout cas » (Bouga, 2000)
Le twitter des amateurs de cinéma, c’est la guerre. Les mecs peuvent se menacer de mort s’il s’agit de trancher entre Scorsese et la franchise Marvel. L’une des polémiques il y a quelques temps, c’était de savoir si Avatar avait laissé une trace dans cette grosse baudruche qu’est la pop culture ? Ce qui n’est probablement pas le cas. Je me suis posé la même question au sujet d’Animal Collective : « Ont-ils marqué la pop music ? ». Après réflexion, je répondrai par l’affirmative.

Groupe phare du tournant des années 2000 et 2010, la tribu de Baltimore a réussi à enchaîner trois grands disques avec « Feels », « Strawberry Jam » et « Merriweather Post Pavilion ». Le dernier fait même partie des albums vraiment importants des vingt dernières années. Et il n’y en a pas tant que ça. Avec leur pop psychédélico-électronico-chamanique, ils ont été les enfants déglinguées des Beach Boys et du Pink Floyd de Syd Barrett conçus lors d’une soirée trop chargée à l’acide. Pourtant, ils n’ont plus sorti grand-chose de bon depuis « Merriweather… » (2009) en s’embourbant au fil des années dans les dérives d’une forme d’auto-caricature.
Il était donc difficile de prédire que l’écoute de « Isn’t It Now ? » se révèlerait aussi enthousiasmante. Panda Bear et ses potes y pratiquent un psychédélisme redevenu enfin comestible et finalement assez classique, très fin sixties. Il y a des titres courts et très pop comme Stride Rite qui ferait presque penser aux Beatles ou aux Beach Boys et où la voix de Deakin rappelle immédiatement celle de John Cale. Incroyable. Un gars sur Reddit a justement posté que c’était la chanson la plus « normale » qu’ils aient jamais écrite. A côté de ça, les très longues divagations psychés que sont les splendides Soul Capturer ou Genies Open trouvent un point d’orgue dans le single de 20 minutes Repeater. Œuvre monstrueuse en trois parties dans l’esprit du Siberian Breaks de MGMT. Ces derniers ont d’ailleurs aussi annoncé qu’il allait sortir un nouveau disque. Le revival psyché-fluo est prêt. Williamsburg va redevenir la terre sainte des hipsters. Emmanuel JEAN
The Chemical Brothers – « For That Beautiful Feeling »
Mood : si vous pensez qu’il faut compter sur les dinosaures de la techno pour tenir encore le baraque.
Comme pas mal de gloires des années 90, les Chemical se sont faits progressivement oublier au cours de la décennie suivante : le duo a l’âge de Jagger et Richards au moment de l’enregistrement de « Bridges To Babylon » en 1997. La probabilité pour que j’écoute leur dernier album était donc presque nulle; pensant n’avoir rien à attendre d’un groupe dont les derniers bons moments ont été publiés il y a plus de vingt ans. Je viens d’essayer de réécouter le précédent – « No Geography » – et c’est tout bonnement atroce, à faire dégueuler un rat. Le big beat n’était pas désagréable pour finir les soirées d’école de commerce ou servir de bande son aux pubs pour téléphones portables.
Vingt-cinq ans après, il reste une poignée de bons disques que plus personne de censé n’écoute : The Avalanches, Prodigy et Death In Vegas en tête. L’inspiration des Chemical s’est évaporé aussi vite qu’une goutte de poppers sur un buvard d’acide et leurs grosses ficelles sentent dorénavant le réchauffé. Ce n’est pas qu’ils soient devenus moins bons, c’est juste que l’époque a changé et que le côté Panzer électronique techno punk boom tchak a fait long feu.
La dichotomie entre le nom de leur groupe et leur charisme d’huître m’a toujours étonné, la preuve est que personne de normal ne sait distinguer Ed Simmons de Tom Rowlands (je suis allé vérifier l’orthographe de leurs blases sur Wikipédia, il se fait tard) : Simmons est celui qui a les dents du bonheur et des frisottis tandis que Rowlands est le grand échalas qui arborait une chevelure blonde filasse. Il arbore dorénavant une perruque en peau de fesse nous apprend Google Images.
La pochette est jolie et ressemble fort à celle de South Bronx Story d’ESG, produit par Martin Hannett : faut-il y voir là un hommage – conscient ou non – du duo au plus grand producteur mancunien ? L’album démarre fort avec une séquence chantée par Halo Maud, une Auvergnate : c’est inattendu et superbe. Il semble que les Chemical savent mieux choisir leurs invités qu’à une certaine époque (Noel Gallagher sur Setting Sun par exemple alors qu’il chante comme une savate). Les morceaux s’enchaînent bien ensuite, c’est léger, c’est pop et il n’y a de morceau trop bourrin qui pourrait gâter l’ensemble : c’était ma crainte car Simmons et Rowlands n’ont jamais été Ravel ou Debussy. J’aimerais bien faire mon malin et affirmer que j’ai reconnu plein de samples, mais ça n’est pas le cas. On croit entendre Brian Wilson chantonner à un moment – la chanson s’appelle Skipping Like a Stone – mais c’est juste Beck qu’ils sont allés chercher dans son bocal de formol et le résultat est bien meilleur que tout ce qu’il a pu sortir ces quinze dernières années.
Enfin, « For That Beautiful Feeling » est structuré sous la forme d’une épanadiplose, c’est-à-dire qu’il forme une boucle, les derniers instants du disque coïncidant avec le morceau introductif. Un exercice de style qui le rapproche de chefs-d’œuvre passés comme « Histoire de Melody Nelson », « Raven » de Kelela (meilleur album de la décennie en cours selon moi) et… « Homework », ce pilier de la musique électronique contemporain des meilleurs disques des Chemical Brothers. L’esprit critique et vieux con remarquera que les autres bons disques synthétiques de l’année 2023 ont été l’œuvre de dinosaures comme Laurent Garnier et Orbital (57 ans de moyenne d’âge). Mention spéciale au petit jeunot James Holden qui vient baisser les statistiques et qui n’a que 44 ans. La jazzification de la techno est en marche. Romain FLON

TV Girl – « Grapes Upon the Vine »
Mood : Un disque aux fortes influences baggy-Madchester pour ceux qui trainent sur Le Bon Coin.
J’ai découvert ce groupe par pur hasard à la radio. Je n’étais pas dans les meilleures conditions pour une écoute attentive : le morceau a commencé à jouer alors que j’étais en train de chercher désespérément une place pour me garer. Mon objectif était de récupérer une table à langer (modèle Ikea Sundvik) que j’avais achetée sur Le Bon Coin. C’était un soir en semaine, le rendez-vous était fixé à 19 h avec un mystérieux vendeur que j’avais enregistré dans mon répertoire téléphonique sous le nom ingénieux de « Table LeBonCoin ». Le lieu de rendez-vous se trouvait dans le 18e arrondissement de Paris, derrière la mairie. Pour ceux qui connaissent le coin, ils savent que tout était contre moi : embouteillages, gens pressés, scooters urbains zigzagants dans tous les sens comme dans Rollerball, et surtout d’interminables travaux en raison des Jeux olympiques. Le stress et la fatigue s’ajoutaient à tout cela, donc ça ne s’annonçait pas simple du tout. De plus, avant de trouver cet acheteur, j’avais déjà dû traverser d’autres épreuves. J’avais eu des échanges vifs et sérieux avec d’autres vendeurs potentiels, notamment une certaine Mamounette_du93. Elle m’avait donné rendez-vous la veille, près de la porte de Montreuil, pour conclure la transaction. Cependant, le jour du rendez-vous, Mamounette_du93 m’a fait faux bond : « En fait, je viens de me rendre compte que j’avais promis la table à une amie, donc je ne peux plus vous la vendre. Excusez-moi pour la gêne occasionnée, gna-gna-gna » (connasse).
C’est donc pendant ma quête désespérée d’une place derrière la mairie que ce morceau de TV Girl est passé à la radio. Malgré le stress et la fatigue, ce morceau m’a interpellé à un tel point que j’ai rapidement sorti Shazam pour l’identifier et l’ai sauvegardé pour plus tard.
Avec le recul, ce qui m’a touché, c’est le lien évident entre TV Girl et la scène musicale anglaise de la toute fin des années 80. On se retrouve ici dans l’univers de Madchester grâce aux rythmes baggy, au chant pop, aux hooks de piano house joués avec fougue, et aux incursions gospel qui donnent à l’ensemble un aspect christique et extatique. Il y a du The Farm, du Northside, World of Twist ou Supreme Love Gods dans tout ça.
C’est étonnant qu’un groupe indépendant du Michigan en 2023 revendique une telle influence, mais ils le font avec tellement de passion que c’est irrésistible. C’est un peu comme avec ma table à langer du Bon Coin : je n’ai plus posé de question, j’ai déjà traversé trop d’épreuves pour en arriver là, je l’ai prise. Gérard LOVE.

Slowdive – « Everything is alive »
Mood : Tu penses souvent à l’empire romain ?
Il y a quelques jours, un animateur de la radio NTS a préféré passer Shine, titre des débuts de Slowdive, car il avait été selon lui « incapable de trouver un bon morceau » sur le dernier disque des vétérans de Reading « everything is alive ». Le mec est chaud et exagère un peu : il y a peut-être deux, trois compositions potables sur cet album et encore ce sont des quasi instrumentaux (Shanty, Prayer Remembered). Pour résumer, la forme est là, les arrangements « vaporeux » ou « évanescents » (ces adjectifs semblent avoir été inventés pour eux) sont bien présents et l’apport de synthés genre modulaires est plutôt agréable. Le problème est surtout que les Anglais ont oublié d’écrire des chansons, ce qui était encore le cas dans leur « disque du come-back » de 2017. Le packaging est bien foutu mais ça tourne à vide et c’est quand même très mièvre. En étant totalement transparent, je ne suis pas forcément très objectif avec ce groupe dont je n’ai jamais véritablement compris le retour de hype après plus de vingt ans d’absence. Au début des années 90, ils étaient plutôt à ranger dans la deuxième division de la vague shoegaze malgré quelques grands titres et un très bon album sorti trop tard (« Souvlaki » en 1994). Cela même si leur musique s’apparentait plutôt à ce qui deviendra plus tard la dream pop dont raffolaient tous les ados émos des années 2000. Sur Spotify, ils ont quand même plus d’écoutes que My Bloody Valentine ce qui paraît insensé. A ce compte-là, il vaut mieux se renvoyer « Loveless », « Nowhere » de Ride ou « The comforts of Madness » de Pale Saints. Au final, et pour rester dans le rayon ex-fan des nineties, ce n’est pas pire que le rock à charentaises du dernier Teenage Fanclub. Respect éternel les gars mais il fallait s’arrêter quand Gerard Love – le musicien, pas le type de Gonzaï – s’est barré en 2018. Emmanuel JEAN
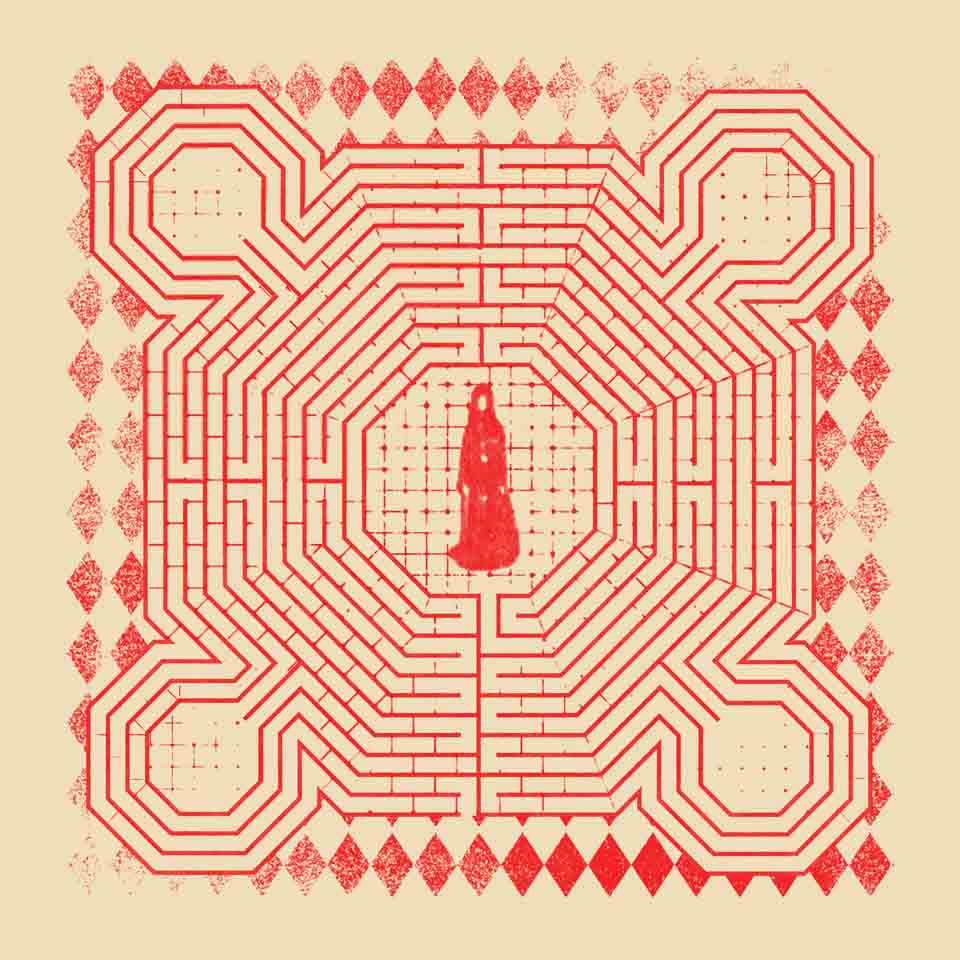
Immy Owusu – « LO LIFE ! »
Mood : Pour ceux qui aiment l’ambiance de FIP en journée mais pas forcément les morceaux qui y passent. Vous voyez ce que je veux dire ?
C’est un véritable plaisir. Une fusion entre la musique ghanéenne et un rock psychédélique doux, tout en restant résolument pop. On y trouve un mélange entre les premières œuvres de Tame Impala et William Onyeabor. Tout ici est à la fois brut et sensuel. C’est comme si vous étiez dans une boutique anversoise de pulls tricotés à la main par un créateur, mais en même temps, il y a une démarche vraiment alternative. Je pourrais vous parler en détail des morceaux sublimes comme Holy Shoulders ou Flashback, mais étant donné que nous évoquons des pulls de qualité en prévision de l’hiver, permettez-moi de mentionner un élégant gilet en laine d’Écosse de la marque Howlin’ dont j’ai fait l’acquisition tout récemment. C’est une marque d’Anvers, et c’est d’une douceur incomparable, même si cela peut représenter un investissement d’environ 260 euros pour un pull aux teintes pastel. Certes, ce n’est pas à la portée de toutes les bourses, mais avec l’âge, j’essaie de soigner mon style pour tenter de ressembler à ce que je qualifierais de « bobo fan de Pantera habillé comme Liam Gallagher au festival Glastonbury en 1994 (scène du petit chapiteau) ». Pour moi, c’est important, car ma plus grande crainte est de ressembler à un rocker alternatif de Rennes fan de Nick Cave avec un pull aux coudières et une casquette gavroche à la Jean Gabin. En somme, tout le contraire d’Immy Owusu. Gérard LOVE.
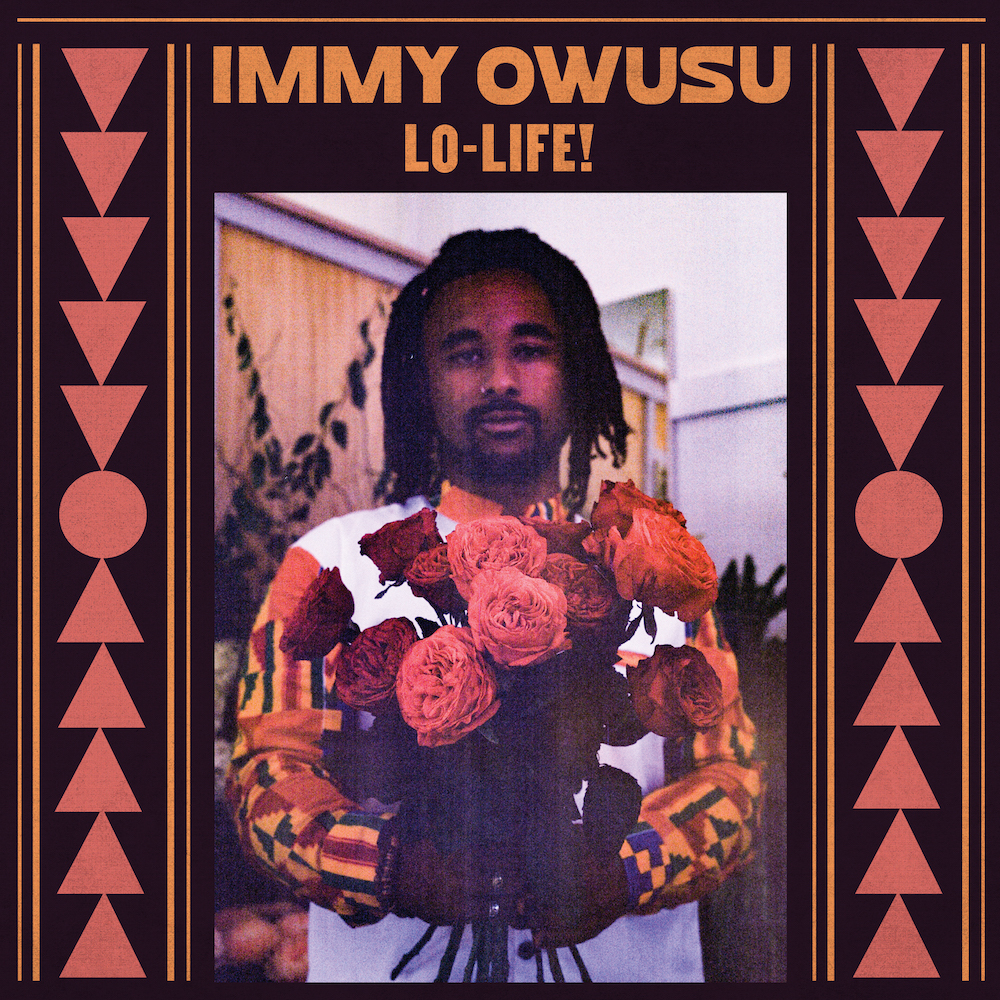
Sūtra – 2
Mood : se rappeler des riches heures de la French Touch lorsque le monde était moins merdique.
Encore un duo qui a versé dans la musique électronique à la fin des années 90 ! Cette fois, ce sont deux Français aux manettes de la console : Thomas Bourdeau et Patrick Vidal. Ce dernier n’était pas un novice et a officié en tant que bassiste un peu avant 1980 au sein du groupe Marie et les Garçons, les B-52s lyonnais. Vingt ans plus tard, il est approché à la fin d’un concert par le sémillant Thomas Bourdeau qui lui propose une collaboration musicale et c’est ainsi que démarrèrent les bidouillages électroniques de Sūtra.
Comme nul n’est prophète en son pays, la reconnaissance est venue de l’autre côté de la Manche lorsque leur premier album – le joliment nommé « Suicide » – publié l’année où l’Equipe de France de football remporta sa première Coupe du monde. « Suicide » fut mixé par Christophe Monier qui a publié un superbe album acid deux ans plus tard avec les Micronauts : « Bleep To Bleep ». Cela nous fait deux groupes injustement oubliés de la période French Touch dans le même papier, c’est toujours ça que les Allemands n’auront pas.

On dit qu’une vie est faite des bonnes rencontres au bon moment et c’est bien là où les deux musiciens n’ont pas eu du bol : si leur premier coup d’essai fut produit par Mirwais – alors en pleine traversée du désert dix ans après la dissolution Taxi Girl – il planta le groupe au moment de l’enregistrement du deuxième album, trop occupé par la conception de son premier album solo, modestement intitulé « Production », et « Music, » le disque qui participa à la renaissance de Madonna amorcée avec le superbe « Ray of Light ». Il n’est pas interdit de se demander si le résultat des expérimentations électroniques de Mirwais aurait été aussi réussi sans ce galop d’essai. Peut-être a-t-il une pensée émue pour Sūtra tandis qu’il compte ses tas de biffetons au bord de sa piscine.
Et c’est bien de ce deuxième album dont il est question puisqu’il vient enfin de paraître plus de vingt ans après son enregistrement : le résultat est remarquable. Plus varié que son prédécesseur, les compositions de 2 creusent un peu plus les sillons house et downtempo en en élargissant le spectre musical : des décors urbains se succèdent, on traverse des scènes de film qui n’existent pas, on y retrouve l’esprit de certains morceaux de Barry Adamson – encore un bassiste – et d’Andy Weatherall. Le titre de l’album est une invitation aux duos et des invités comme Miss Honey Dijon ou Jenny Bel’Air donnent une coloration camp affirmée à l’ensemble, aidée en cela par la pochette mappelthorpienne. L’absence de Mirwais donne étonnamment plus d’éclat à la production de cet album qui n’aurait jamais dû paraître sans l’opiniâtreté de Thomas Bourdeau. Pleine réussite pour un disque qui donne envie d’aller réécouter Super Discount, Kid Loco et Motorbass, et de se replonger dans une époque révolue. Romain FLON
Tirzah – « trip9love… ??? »
Mood : grand disque mais le batteur ne s’éclate pas.
Il ne doit pas y en avoir tant que ça, des artistes ayant sorti trois premiers disques vraiment réussis. Vite fait, peut-être Portishead ou les Strokes. Et encore, certains trouveront certainement à redire sur leurs deuxièmes disques. Souvent, le premier est le plus réussi, ou le deuxième déçoit ou alors ça se vautre sur le troisième en essayant de « tenter un truc ». J’ouvre d’ailleurs le débat, c’est le genre de défis qui cartonnent en ce moment sur twitter : « Citez un disque avec un chien sur la pochette », « Citez le meilleur album de votre mois de naissance ».
Avec le risque de me tromper, je pense que Tirzah a réussi son « hat-trick » seulement cinq ans après l’impeccable coup d’essai « Devotion ». Le deuxième « Colourgrade », enregistré durant sa grossesse, se voulait déjà plus dépouillé et expérimental, tout en s’éloignant du R’n’B/dubstep des débuts.
Toujours accompagnée de Mica Levi pour la partie instrumentale, l’Anglaise aime prendre des risques. Son troisième album au titre ressemblant à un SMS envoyé tout seul depuis sa poche de pantalon est un pari audacieux. Je ne m’en étais pas forcément rendu compte au départ mais la boucle rythmique – assez basique et breakée – est exactement la même tout au long des dix titres. Je n’ai pas en tête d’autres exemples dans ce cas. La première écoute est d’ailleurs assez rebutante et donne l’impression d’écouter toujours la même chanson. Pourtant, et à la manière d’un riddim jamaïcain, ce sont quelques notes de pianos ou de guitares inversées ou ralenties, qui permettent à l’ensemble de marcher. Et il y a surtout la voix d’ange de Tirzah qui survole et apporte à chaque fois une mélodie différente et son lot d’émotions et de mélancolie. A chaque fois renouvelée et toujours aussi inventive, sa musique reste donc parmi les plus passionnantes venues d’Angleterre. Emmanuel JEAN

François Sagat – « Videoclub »
Mood : Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul.
François est reconnu pour sa renommée en tant qu’acteur et modèle, mais il est aussi célèbre pour sa personnalité bien trempée et son physique remarquable, caractérisé par un membre de 21 centimètres et des fesses particulièrement musclées. Au fil des années, il est devenu une véritable icône pop, jouant dans des films d’auteur, se prêtant au mannequinat, et bien plus encore. Aujourd’hui, il s’essaie à la musique avec la sortie d’un nouvel album résolument punk, car elle embrasse ses imperfections. L’accent anglais de Sagat peut parfois trahir ses origines, mais il est admirablement rattrapé par la passion qui transparaît dans ses paroles. Écoutez simplement ce monologue introspectif sur la piste « Sagat Planet » pour en être convaincu. Les productions, signées Tommy Marcus, ne sont peut-être pas révolutionnaires, mais, à vrai dire, cela importe peu. Car cet album respire le désir de se faire plaisir, de créer un univers d’évasion pour ses auditeurs.
C’est un disque qui s’inscrit dans la culture gay, avec un esthétisme audacieux et des sonorités à mi-chemin entre l’électroclash cuir et la house de diva que l’on peut entendre rugir sur les ondes de FG ou dans les bars du Marais. Il s’agit en réalité d’une œuvre généreuse, humble, et empreinte d’une certaine sensualité. C’est un peu comme une rencontre entre Mylène Farmer et The Hacker.
Vous pourriez vous demander pourquoi une critique d’album de culture gay et techno-pute trouve sa place dans ces colonnes. Peut-être n’en avez-vous pas encore pris conscience, mais Gonzaï initie une révolution. Non, nous ne voulons plus seulement de ces collectionneurs de vinyles et de DVD, ces mâles cisgenres valides. C’est une autre révolution à bras ouverts que nous prônons ici. Gérard LOVE.

Laurel Halo – « Atlas »
Mood : Une Américaine (fait de l’ambient) à Paris.
Après avoir écouté le dernier album de Laurel Halo « Atlas », j’ai été surpris que Spotify enchaîne automatiquement avec toute une série de musiques dites « de relaxation » sans véritables noms d’artistes et des pochettes avec des forêts tropicales ou des bouddhas sur fond violet. Signe des temps difficiles, les gens ont besoin de tout lâcher avec de l’ambient bon marché pour se relaxer le cortex à coup de 432mhz.
Le huitième album de l’Américaine n’est pourtant pas à ranger au rayon des onguents new age pour actifs surmenés par un supérieur psychopathe et le dérèglement climatique. Enregistré au fameux studio du Groupe de Recherches Musicales (GRM) de Paris, « Atlas » se situerait plus dans une veine de musique contemporaine minimaliste. J’avais précédemment un peu de mal à suivre la musique d’Halo souvent cryptique et assez bizarre finalement mais cette nouvelle direction est vraiment réussie. Principalement sur son piano, elle est accompagnée de James Underwood au violon, de Lucy Railton au violoncelle et de Bendik Giske au saxophone. Sur des titres assez courts elle excelle dans ce qui me plaît tellement quand la musique ambient est réussie : soit des sortes de paysages mentaux immenses aux reliefs dessinés par les différents arrangements et nappes (Late Night Drive, Atlas). Comme si c’était en trois dimensions. A côté de ça, elle lorgne sur le jazz avec seulement quelques notes de piano et la voix de l’Anglais Coby Sey (vu chez Tirzah) avec Belleville ou le classique sur le magnifique Sick Eros. C’est sombre et tourmenté mais majestueux comme du Stars of The Lid. J’en profite d’ailleurs pour saluer la mémoire de Brian McBride, moitié du duo, récemment décédé. Emmanuel JEAN
Motorpsycho – « Yay ! »
Mood : pour ceux qui ont aimé Kyuss mais qui sont désormais usés par la vie et le prix de l’essence.
Rendez-vous compte : ce groupe norvégien existe depuis l’époque de Kurt Cobain. Ils ont sorti leur premier disque – un mélange d’Alice In Chains et Melvins – quelques mois seulement après la sortie du « Nevermind » de Nirvana. Près de trente ans de carrière sous les radars, à tourner sans relâche dans des conditions pas toujours idéales, avec environ 28 albums à leur actif et des changements de line-up justifiés par des musiciens fatigués qui jettent l’éponge. Et puis, contre toute attente, les rescapés du groupe nous offrent un magnifique album de folk psychédélique, réalisé par des quinquagénaires en marge de tout. Produit par Reine Fiske (connu pour son travail avec Melody’s Echo Chamber et Dungen), Motorpsycho suit les traces du légendaire Crosby, Stills, Nash & Young. C’est beau, serein, proche de la perfection, des cieux, des étoiles, et, plus largement, de l’univers des grands maîtres de l’ordre du chaos, qui trônent aux côtés de l’ange Gabriel. Gérard LOVE.
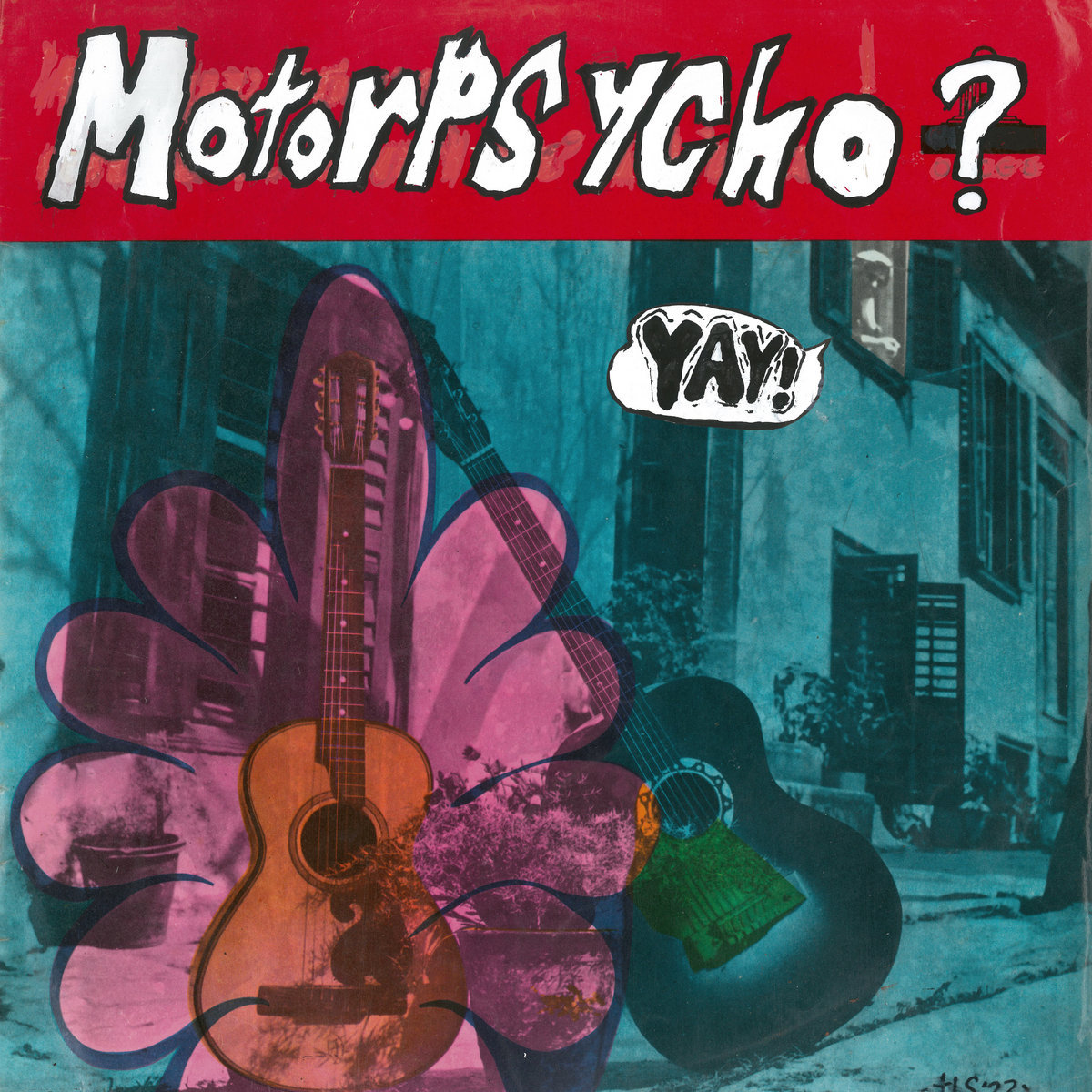
Loraine James – « Gentle Confrontation »
Mood : l’avenir de l’IDM passera par les femmes.
J’ai eu beau essayer, je n’ai pas trouvé d’angle d’attaque pour aborder le nouvel album de Loraine James. C’est peut-être dû au fait que sa musique s’affranchit de plus en plus des influences hyper pop et club de ses débuts pour créer une véritable identité encore difficile à définir. Après un essai réussi dans l’ambient sous le nom Whatever The Weather et une relecture assez poignante du jazzman maudit Julius Eastman (« Building Something Beautiful For Me »), elle a choisi cette fois de faire dans l’intime autant dans les thèmes que dans la « couleur musicale ». Elle y évoque en douceur le décès prématuré de son père (2003), sample des repas de famille à l’ambiance jamaïcaine (Cards With The Grandparents) avec une grande pudeur. Son chant parlé est très présent mais elle sait aussi s’accompagner de différentes voix pour développer son R’n’B mutant. Il y a des touches de breakcore, de jazz et même une déclaration d’amour à l’IDM (I DM U) avec la batterie free-jazz du membre de Black Midi Morgan Simpson qui rappelle ce que pouvait faire Squarepusher. Elle tente beaucoup de choses, lançant un titre de drum’n’bass qui finit par s’adoucir ou du glitch ce qui pourrait la rapprocher des récents travaux de Kelela. Si le disque est peut-être un peu trop long, il est clairement celui de la confirmation d’une artiste vraiment singulière. Emmanuel JEAN
Pleasure Pill – « Wonder How »
Mood : Je me sens supersonique / donne-moi un gin-tonic.
Oui, là, évidemment, on est à fond dans le truc. Ce n’est pas un album mais trois singles que sort ce groupe de San Diego. Le long format devrait suivre mais je les follow, je leur donne gras de la force. Coupe au bol, anorak jusqu’au menton, guitare avec potard à fond, refrain de hooligans alcoolisé et chant empli d’arrogance anglaise circa 1996. En pleine Oasismania mid-90’s, j’avais poussé le vice jusqu’à acheter tous ces disques d’artistes qui étaient des clones des Mancuniens. Je parle d’ Ocean Colour Scene, Embrace ou des trucs plus obscurs (et nuls) comme Heavy Stereo. Le groupe Pleasure Pill sonne donc comme un groupe brit-pop alors que les membres ne semblent pas avoir connu cette époque. Étrange. Et puis les pochettes font évidemment référence au travail du photographe Brian Cannon (Oasis, The Verve, etc). Des chansons qui vont vous donner envie de vous procurer un anorak couleur kaki. Gérard LOVE.

Sonic Boom / Panda Bear / Adrian Sherwood – « Reset In Dub »
Mood : Jah live.
J’adore le dub. Si on était obligé de n’écouter plus qu’un seul genre de musique, peut-être que je choisirais le dub. Les fréquences de ce genre collent parfaitement à celles de mon cerveau, elles suscitent une forme de bien-être finalement assez dénué d’émotions. Les titres peuvent s’enchaîner sans véritablement qu’on les distingue mais la basse, les reverbs et tout ce qui ce qui s’y rattache me procurent toujours un plaisir restant en boucles à l’état stationnaire. Je parle surtout du dub originel, celui de King Tubby ou de Scratch Perry pour les plus connus, fait avec des noix de cocos, trois diodes et une sirène d’ambulance. Pas forcément le dub électronique qui a pullulé dans les années 90. D’ailleurs, à cette époque c’était la mode des remix dub d’albums venus d’autres genres musicaux, le « No Protection » avec Mad Professor de Massive Attack étant parmi les plus connus.

En 2023, le modèle est relancé par Panda Bear et Sonic Boom. Depuis qu’ils sont voisins à Lisbonne, le batteur et chanteur d’Animal Collective et la moitié de Spacemen3 sont devenus super potes et n’en finissent plus de sortir de la musique ensemble. Ils ont choisi de faire retravailler à la sauce dub leur excellent dernier disque « Reset » de 2022 et tapé dans le haut du panier du genre avec Adrian Sherwood. Le sexagénaire a travaillé avec pas mal de légendes jamaïcaines, a fondé le label On-U Sound Records, a flirté comme producteur avec l’indus’ et déjà remixé Depeche Mode ou Primal Scream. Et, aussi étonnant que ça puisse paraître, l’espèce de rockab’-mariachi-psyché de « Reset » se prête à merveille aux effluves dub du vieil anglais. Tout est là : reverb’ à fond, basse bondissante et tous les petits arrangements qui font le charme du genre. Si les voix de Noah Lennox et de Pete Kember n’ont pas grand-chose à voir avec celles des grands toasters, ça fonctionne parfaitement et il est finalement assez difficile d’y reconnaître les titres originaux. Emmanuel JEAN
Prison – « Upstate »
Mood : Ça fait combien de temps que tu n’as pas écouté l’album « Funhouse » des Stooges ?
Ce sont des punk rockers d’un quartier assez atypique de New York – Rockaway Beach, dans le Queens; des branleurs marginaux, moitié artistes fauchés et skaters fatigués qui n’ont pas baissé les bras contre l’agressivité du système. Ils se réunissent pour des jams improvisés avec pas mal de vin rouge bon marché afin de jouer jusqu’à pas d’heure une sorte de garage-punk-psychedelioque. Il y a 5 morceaux sur ce premier disque. Le premier dure dans les 15 minutes. C’est un des plus courts. Les autres font dans les 20 minutes. Putain, c’est du Krautrock, quoi. C’est Amon Düül qui rencontre les Stooges. Gérard LOVE.











4 commentaires
ta cop_in mais lente nichons importe le conflit avec le hamas en france in daube
kill kill kill qui tu sait! espéce de sot!!!!!!
le prison ok mais pas a 45 batons!
hamasse arrasse ta rasse