Vous vous sentez perdu parmi les plus de 60 000 titres mis en ligne chaque jour sur Spotify ? Nous aussi. Mais on a quand même pris le temps d’en écouter certains et voici ce qui a retenu notre attention ce mois-ci.
Beyoncé – Cowboy Carter
Mood : pour les fans de Nick Cave aux cœurs froids, remplis de lierres.
Le dernier groupe de kraut-garage parisien qui enregistre des morceaux crasseux dans une cave de Belleville attire beaucoup de monde à Gonzaï. Mais même si notre lectorat est majoritairement composé de vieux fans tristes de Nick Cave, cela ne signifie pas que je vais m’abstenir de parler du dernier album de Beyoncé.
Personnellement, j’ai toujours aimé Beyoncé. J’ai même acheté son premier maxi Crazy In Love pour soutenir sa carrière solo. Mais au fil des années, nos chemins se sont éloignés ; je me contentais de prendre de ses nouvelles en déambulant au hasard dans un supermarché. Pourtant, son dernier disque « country » mérite qu’on s’y attarde. Soyons clair : ce n’est pas vraiment un disque de country. Non, c’est plus intelligent. Même si l’album comporte quelques moments consensuels, dans l’ensemble, c’est une belle réussite, mêlant pop et esthétique sonore rock, avec une reprise splendide des Beatles (Blackbird). Cela me rappelle l’approche innovante de Missy Elliott et son hommage au hip-hop old school des années 80, dans son disque « Under Construction » (2002, produit par Timbaland). Écoutez les titres de Beyoncé comme American Requiem, Protector, Texas Hold Em. Sur le titre 16 Carriages, la production y est novatrice : comment faire sonner ambiance botte de foin, seulement avec quelques sonorités de slide (à peine) et une rythmique tapée sur la caisse d’une guitare. Et le son est ample, énorme, pop.
Avec « Cowboy Carter », Beyoncé parvient à captiver, offrant une sincérité nouvelle. Queen B pourrait-elle trouver sa place dans le cœur de pierre des fans de krautrock-garage enregistré dans une cave ? Peut-être pas, mais Beyoncé est prête à vous attirer avec son lasso. YEPAH ! Gerard LOVE
Mount Kimbie – The Sunset Violent
Mood : laissez le revival post-punk/shoegaze à des mecs qui ont le groove.
La première fois que j’ai écouté « The Sunset Violent » de Mount Kimbie, je l’ai trouvé franchement quelconque. Encore du post-punk, du shoegaze, encore la participation de King Krule… Puis j’ai eu l’occasion de devoir démonter une dizaine d’étagères en métal équipées d’au moins 200 boulons dans un espace exigu. Armé d’oreillettes de mauvaise qualité, cette tâche passionnante et mécanique est devenue si hypnotique que, sans le vouloir, j’ai laissé tourner le disque des deux Anglais une demi-douzaine de fois en boucle. Cette expérience d’écoute hardcore a eu pour effet d’entrer profondément les compositions dans mon cerveau anesthésié. J’ai toujours eu une affection particulière pour Mount Kimbie. De leurs débuts ultra-hype dans le post dubstep squelettique à leur virage post-punk ou leur DJ Kicks qui déchire, ils arrivent toujours à apporter une forme de groove très caractéristique à leur musique. Leurs playlists d’écoutes doivent être un véritable bordel.

Depuis déjà quelques années, ils expérimentent la relation longue distance. Dominic Maker vit à L.A. et produit du très lourd dans le hip-hop/R’n’B (Jay-Z, Travis Scott, Rosalia) et Kai Campos est resté à Londres, plus passionné par l’électronique expérimentale. En 2022, leur album « MK 3.5: Die Cuts | City Planning », en fait deux albums solos réunis en un seul, donnait l’impression d’un préalable au divorce que j’ai à peine écouté. Ce qui aurait pu être leur « Recurring » à la Spacemen 3 n’était pourtant qu’une escapade ponctuelle. Réuni pendant six semaines dans une maison du désert californien au fin fond de la Yukka Valley, le tandem a repris le vrai fil de sa discographie pour donner « The Sunset Violent ».
Alors que je m’acharnais sur un boulon un peu trop récalcitrant dans cette tâche métronomique, j’ai été pris par le rythme kraut de Empty Silent. Apparemment, ils étaient obsédés pendant l’enregistrement par la légendaire boîte à rythme Linndrum. Cela se ressent dans ce titre qui sort totalement du lot. Le chant de king Krule, qui a tendance à me fatiguer en solo, apporte une mélancolie pop impeccable. Ailleurs, le disque renvoie à The Cure, My Bloody Valentine ou Stereolab avec cette patine légèrement dance propre à deux mecs bercés par le dubstep. La voix d’Andrea Balency-Béarn rappelle aussi vraiment celle de Tirzah ce qui amène un parallèle inévitable avec le travail de leur compatriote. L’influence de Tirzah commence à se ressentir par endroits et c’est totalement mérité. Comme chez la Danoise ML Buch dont le dernier album est un véritable enchantement. Jamais vraiment là où on les attend, les deux collègues de Mount Kimbie poursuivent ainsi leur chantier protéiforme de la meilleure des manières. Emmanuel JEAN
MGMT – Loss of Life
Mood : bonne nuit les petits.
Cela fait dix ans que j’ai les jetons lorsque MGMT publie un nouvel album : ce groupe est pour moi le meilleur en activité mais il est capable aussi de pondre des boursouflures qui tournent à vide. A vrai dire, je n’ai qu’un exemple de déception mais elle fut marquante : l’effrayant « MGMT » paru en 2013, un monument d’ennui écouté une bonne cinquantaine de fois dans l’espoir d’en percer les secrets, convaincu que cette épreuve me permettrait de voir la grâce au bout du tunnel et de rédiger une critique mémorable pour le site où vous lisez ces lignes à l’instant. Si j’ai pris du plaisir à rédiger ce papier, mon été 2013 reste marqué par cette purge auditive infligée plusieurs fois par jour.
Plus jeune, cette démarche avait très bien fonctionné avec « Astral Weeks », album que j’avais trouvé pourtant insupportable durant les deux cents premières écoutes. Je suis depuis dingue de ce disque et la voix de chèvre agonisante de Van Morrison m’émeut profondément désormais. Comme quoi. Je suis convaincu qu’un certain nombre d’œuvres se méritent et exigent qu’on se les inflige avant qu’elles ne s’offrent à nous après tous ces efforts et cette sensation d’avoir touché du doigt le cœur et l’intention de l’artiste est merveilleuse. Je retarde le moment où je concentrai tous mes efforts afin d’apprivoiser « Trout Mask Replica » et m’imagine déjà braillant Dachau Blues sous ma douche avant d’aller bosser.
Ma déception en écoutant « MGMT » était d’autant plus grande qu’il succédait à « Congratulations », authentique chef-d’œuvre paru trois ans plus tôt. Le moment de grâce de l’album, une pavlova intitulée Siberian Breaks relevait le gant que les Beatles avaient laissé tomber à terre et rappelait la deuxième face d’« Abbey Road » en combinant des morceaux pop hyper élaborés mixés les uns aux autres. Du grand art, assurément. L’admiration pour la pop anglaise portée par Andrew VanWyngarden et Ben Goldwasser, ce sont les noms des deux têtes pensantes du groupe, s’incarnait dans des titres comme Song for Dean Tracy et Brian Eno. On ne saurait être plus clair. Et ce tropisme européen affirmé donnait une coloration irrésistible à leurs compositions. Un titre comme Flash Delirium contient plus d’idées que toute la discographie des pourtant sympathiques The Strokes.
Je n’attendais plus rien de MGMT quand fut publié « Little Dark Age » en 2018, sous une pochette rendant hommage à Munch et la Sécession viennoise : c’est le meilleur disque des années 80 même s’il fut publié presque trente après leur achèvement. La moindre composition me donne envie de m’enduire le corps de monoï, de me saper comme Bryan Ferry et d’aller déguster un Canada Dry sur mon yacht, ou à défaut, au bord d’une piste d’auto-tamponneuses. Cet album remarquable contient les plus belles chansons écrites ces dernières années, je pèse mes mots. VanWyngarden (qui doit être champion de scrabble avec un blaze pareil) et Goldwasser parviennent à aligner dix super titres dans des styles différents : When You Die et ses paroles vénères – Go fuck yourself! You heard me right, ce genre d’amabilités – aurait pu être écrite par Robert Smith avec ses inspirations japonisantes, James est le slow ultime qu’on aurait aimé danser avec la bombasse du lycée quand One Thing Left to Try donne envie de se mettre à l’aérobic, etc. Passé cette claque, MGMT a fait patienter son public en publiant le 11 novembre 2022 un live enregistré le 11 novembre 2011 et fort justement intitulé « 11•11•11 ». Barré et lysergique comme il faut, c’est un bon album.
L’attraction suscitée par la musique de MGMT est probablement liée à une légère dissonance, une inquiétante étrangeté qui la rend irrésistible. C’est un vrai tour de force de pouvoir concilier simplicité et complexité, deux notions qui paraissent s’opposer à première vue. Le monde de MGMT est celui de l’enfance et il devient passionnant quand il sort des rails. Si Richard D. James et McCartney s’étaient un jour enfermés dans le même studio – on peut toujours rêver – je suis convaincu que le résultat aurait approché des compositions les plus remarquables des deux New-Yorkais. Ces pensées m’occupaient l’esprit tandis que je bourrais ma pipe après une dure journée de labeur et démarrant l’écoute de « Loss of Life », le petit dernier paru fin février.
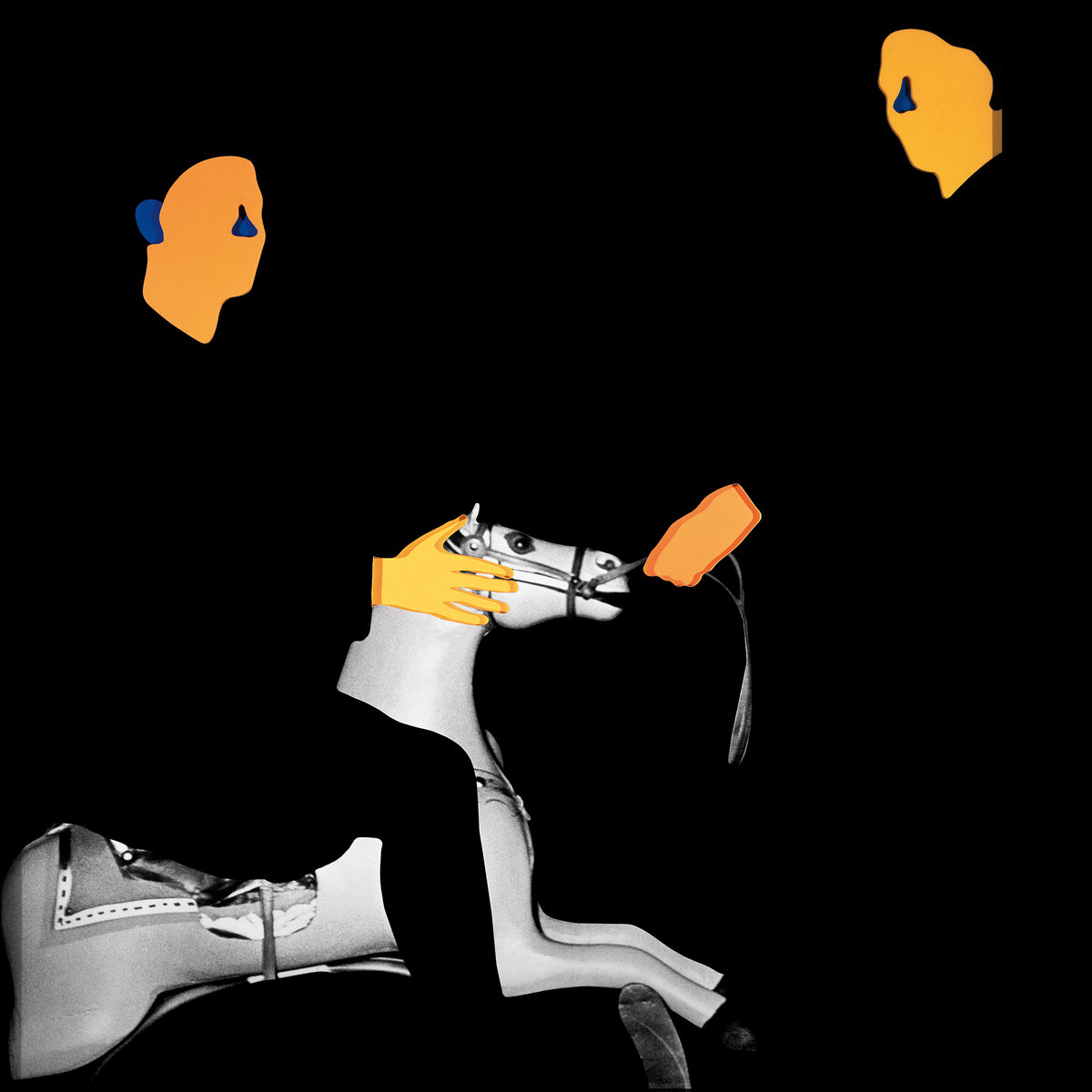
Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps mais ce disque est une daube inoffensive dont plus personne ne parlera dans trois mois. Un morceau surnage, c’est Bubblegum Dog, et le reste est chiant comme une gastro, à l’image de l’affreux duo avec Christine and the Queens. Pourtant, je suis fan de l’artiste mais je crains toujours de l’appeler par son mauvais pseudo, de la mégenrer et de passer pour un affreux fasciste. Mais Redcar a visiblement disparu et c’est son premier pseudonyme qui apparaît dans les crédits de l’album. Je me demande à quel moment Chris, Goldwasser et VanWyngardense se sont dit que leur travail commun méritait d’être sur l’album. Peut-être qu’ils ont trouvé cela merdique mais n’ont pas eu le courage de se l’avouer après ces quelques jours de collaboration. Tout de même, on pourrait quantifier le temps perdu avec ce Dancing in Babylon – c’est son titre – et ses 4 minutes et 50 secondes… Mettons que cette chanson ait été écoutée 300 000 fois depuis sa parution (c’est une hypothèse, ce n’est pas beaucoup puisque Kids a été diffusée 766 216 458 sur Spotify, j’ai la statistique sous les yeux) et bien cela représenterait 87 000 000 de secondes soit 24 167 heures gaspillées à entendre cette scie. J’ai la flemme de convertir en années mais vous voyez l’idée.
Tout l’album est fait du même bois, les deux musiciens sont devenus adultes et produisent dorénavant de la musique sans saveur à écouter distraitement sans y prêter attention. Ils savent y faire, ça passe tout seul comme une douche tiède. Vu le rythme de leurs dernières publications, le prochain album de MGMT paraîtra en 2030 : ils seront proches de la cinquantaine et la probabilité d’avoir une belle surprise paraît bien faible, le confort et l’âge émoussant la créativité musicale. Si tout se passe comme prévu, le grand frisson nous sera proposé à ce moment-là par des artistes nés autour de 2010 qui considérerons MGMT comme un groupe de dinosaures. Rendez-vous dans six ans.
Romain FLON
Alice Coltrane – The Carnegie Hall Concert
Mood : coupes afros, jazz et cosmos dans une salle mythique de New-York en 1971.
Attention, on parle ici de musique sacrée ; de ces créations qui touchent au divin, au mystique. Elles arrivent à créer un lien direct avec un éventuel créateur. Il n’y a pas de messages ou de mécaniques particulières. Seulement une alchimie propre à l’élévation de l’âme. Pour ma part, ces musiques sont souvent instrumentales, je ne l’explique pas, et se retrouvent dans des genres comme l’ambient, l’IDM ou les bribes de musique classique que je peux connaitre. On le retrouve finalement assez peu dans la pop, à part chez les Beach Boys bien évidemment. Ils y parviennent d’ailleurs presque seulement avec des voix. Et il y a le jazz, principalement et comme son nom l’indique, ce qu’on appelle aujourd’hui le spiritual jazz.
Je ne sais pas quelle était l’aura d’Alice Coltrane dans sa grande époque des années 70. A la suite de son décès en 2007 à 69 ans, elle est devenue une sorte de caution de bon goût. Cette hype grandissante mêlant new age gentrifié en vogue en Californie, bouffe bio et yoga a même atteint son paroxysme ces derniers temps pour finir en inspiration de l’album de flûte d’André 3000 ou via l’utilisation au générique de la série The Curse des chants mantra enregistrés dans son Ashram des années 80. Cela n’enlève rien à la magie de sa musique et ça lui a permis de ne plus seulement être la veuve de John, soit l’un des plus grands génies de la musique contemporaine mort en 1967. Alors, après toute une série de rééditions, Impulse ! publie son concert de 1971 au Carnegie Hall joué en faveur de l’institut de yoga de son gourou indien. Il est donné seulement une semaine après la sortie de son Magnum Opus « Journey In Satchidananda », nommé ainsi en hommage à celui qui l’a convertie à l’hindouisme lors d’un voyage en Inde pour tenter de guérir de son deuil conjugal. Et pour finir dans l’informatif, elle dispose dans la mythique salle new-yorkaise d’une équipe de choc avec deux saxos du gabarit de Pharoah Sanders et Archie Shepp, deux bassistes (Jimmy Garrison et Cecil McBee) et deux batteurs (Ed Blackwell et Clifford Jarvis). De quoi faire chauffer le pacemaker d’un lecteur de Jazz Magazine.

Je n’ai jamais aimé les live, je ne comprends pas vraiment l’intérêt de revivre un moment justement fait pour être éphémère. J’ai peut-être aussi été vacciné à l’adolescence par les doubles cd live bootlegués de Metallica au son pourri et aux pochettes photocopiées. Mais il faut bien avouer qu’avec Alice Coltrane, il y a un aspect de document historique. Quelle chance ont eu les gens d’y assister, même si aujourd’hui il doit y en avoir certains qui ne s’en rappellent plus. Assez parler contexte.
Pour résumer, la prestation est scindée en deux parties. Les deux premiers titres issus de son album tout juste sorti retranscrivent son ambiance « indianisante » et méditative mais dans un registre encore plus apaisé. Notamment grâce à Shepp qui prend la place de soprano de Sanders relégué à la flute, et une harpe plus en retrait. Le thème du titre Journey In Satchidananda est ici plus rêveur et il y a une forme de psychédélisme qu’on retrouve ensuite dans Shiva Loka. Plus fidèle au disque, il provoque avec deux sopranos cette fois le même enchantement sur basse bondissante et harpe du paradise. Après cette entame en apesanteur de près d’une demi-heure, la représentation prend une tournure nettement plus free. Passée au piano, Alice Coltrane rend hommage à son défunt mari avec deux reprises de son répertoire. Africa est une chevauchée incroyable alternant phases tribales avec les deux batteurs, et qui repart plusieurs fois en tension douce par des solos de basse qui font même applaudir le public sélect du coin. Les solistes touchent une forme de grâce et le piano de Coltrane est cosmique. C’est probablement la pièce centrale du set. Son jeu au clavier se veut ensuite beaucoup plus délié et frénétique sur Leo avec une démonstration de ce qui était son instrument premier. Avant d’un peu trop longs solos de batterie et un final grandiose tout en rugissements de cuivre. Voilà, ce n’est pas évident de se sentir légitime quand il s’agit de parler de JAZZ. J’aurai au moins essayé grâce à cette sacrée, Alice. Emmanuel JEAN
JB Dunckel – Paranormal Musicality
Mood : si vous en avez marre de « Moon Safari ».
Il est beaucoup question de la reformation anniversaire du groupe Air à l’occasion d’une série de concerts commémorant leur premier album, « Moon Safari ». En parcourant divers articles à ce sujet, je reste perplexe : de nombreux critiques considèrent ce premier opus comme leur meilleur, voire suggèrent que la suite de leur carrière est moins pertinente. De plus, la dernière tournée de Air en 2016, sous forme de best-of, a été accueillie dans un silence gênant.
Ce que je veux dire, c’est qu’il ne faut pas écouter les « footix » de la musique. Les Versaillais de Air ont réalisé de belles œuvres – en solo ou en duo – et continuent de proposer des créations étonnantes. C’est le cas de Jean-Benoît Dunckel (celui avec la mèche de Playmobil) qui sort ce disque de piano solo. Certains pourraient évoquer la Sofianepamarisartion de cette orientation, mais Dunckel prouve qu’il est un amoureux de cet exercice – lui qui s’entraîne plusieurs heures par jour, tel un athlète. Il s’agit d’un exercice de piano nu, sans aucun ajout de nappes de synthés ou de lignes de basse. Il ne s’agit pas non plus d’un exercice masturbatoire de grande musique classique, du genre : « moi aussi, je connais Rachmaninov ». Il s’agit plutôt d’une collection de sonates emplies de mélodies naïves dans le plus pur style de Air. Le disque qui s’en rapproche le plus est l’album qu’ils ont réalisé pour Charlotte Gainsbourg (« 5:55 », 2006). Quatre clefs de sol selon Télérama. Gerard LOVE
Adam Wiltzie – Eleven Fugues For Sodium Pentothal
Mood : seul dans la forêt en plein nuit, poursuivi par un producteur d’ambient zombie.
Ça va faire bientôt un an que j’essaye de finir L’infinie Comédie de David Foster Wallace. Ce livre culte chez les hipsters des années 2000 est probablement le plus difficile qu’il m’ait été donné de lire. C’est aussi brillant que décourageant. Il peut y avoir 50 pages de pur génie décrivant un gars qui attend sa livraison d’herbe, une overdose hardcore chez des junkie travestis, la prédiction 20 ans avant de l’isolement lié aux réseaux, le sevrage d’un mec qui se vide dans les chiottes pendant des journées entières ou des Canadiens en fauteuil roulant ultraviolents. A côté de ça, des milliers de lignes éprouvantes vont seulement décrire un bâtiment de radio, des techniques de tennis ou les composants chimiques des drogues. Si j’arrive un jour à le terminer, j’en parlerais chez Gonzaï. L’histoire est quasi impossible à décrire mais le cœur du bouquin tourne autour d’une vidéo tellement addictive que les gens qui la regardent finissent tous par en mourir.
Dans le dossier de presse autour de son disque « Eleven Fugues For Sodium Pentothal », Adam Wiltzie parle d’un rêve récurrent dans lequel les personnes qui écoutent sa musique meurent instantanément. Avec, en outre, un titre d’album sur un anesthésique pouvant entraîner la mort, l’ambiance est posée. Rien n’est stipulé sur le sujet mais Wiltzie a dû faire face en aout dernier au décès de Brian McBride, son ancien compère chez Stars Of The Lid. Si les deux Américains n’avaient plus sorti de musique ensemble depuis leur chef d’œuvre de 2007 « And Their Refinement of the Decline », la perte de cet ami de longue date avec qui il avait publié l’une des plus belle musique ambient qui soit a forcément dû le marquer. Connu également pour ses projets The Dead Texan, Sleepingdog ou A Winger Victory For The Sullen, Wiltzie sort aujourd’hui son premier disque sous son nom chez Kranky.
Enregistré en Belgique, son pays d’adoption, et bénéficiant des cordes de l’orchestre de la radio nationale hongroise et du mixage de Robert Hampson de Loop, cet album est une magnifique promenade dans le noir absolu. Autant dire que si cette musique se lançait la nuit dans une maison vide et reculée, absolument tout le monde flipperait sa race. On y retrouve les nappes lancinantes propres à Stars Of The Lid (Stock Horror, Mexican Helium), la tension générée par les cordes (le premier morceau au titre à rallonge, As Above Perhaps So Below) ou des merveilles ambient (We Were Vapourised, Tissue Of Lies). Cet album dont le thème central semble être le trépas n’est pas à mettre entre toutes les mains mais sa beauté provoque des émotions profondes. Après plusieurs écoutes, personnellement ça va, j’espère que tout va bien se passer pour tout le monde à sa sortie. Emmanuel JEAN
Klein – Prodrome (sortie 19 avril)
Mood : la France tient-elle enfin son guitar hero ?
Sans trop l’expliquer, j’ai cette tendance à créer des parallèles ou des rapprochements entre des artistes qui n’ont rien à voir entre eux. Par exemple, j’ai toujours associé Leonard Cohen à John Cassavetes. Je ne sais pas trop pourquoi, probablement une certaine ressemblance physique et toute cette esthétique US des années 70. Plus étonnant, je crée un lien inexistant entre Scott Walker et Michael Cimino. Peut-être l’aspect jusqu’au boutiste du crooner expérimental et du réalisateur mégalo à en finir ermites. Dans le flux des mails de RP de suggestions d’artistes, je n’ai pas eu trop de mal à associer Klein à Vini Reilly, l’homme derrière Durutti Column. Le Français ne s’en cache pas, le nom du Mancunien est cité dans le dossier de presse. Personne ne va le blâmer, ils ne sont quand même pas dix mille à s’en inspirer en France. Et c’est quand même mieux que d’entendre des resucées de saloperies comme Idles.
Au rayon bio, le Parisien Benjamin Porraz avait fondé le groupe Agua Roja et a joué de la guitare en tournée pour différents artistes dont Clara Luciani. Je n’ai jamais été dans le délire de spécialistes : « écoute ce guitariste mec, il a un son de ouf ». Il y a en a même assez peu dont le jeu m’a réellement marqué. Je pourrai peut-être citer Hendrix (forcément), Frusciante ou John Squire. Tout ça pour dire que Porraz sait jouer de la guitare et il vaut mieux quand on souhaite s’inspirer de Vini Reilly. Les arpèges si particuliers de la colonne Durutti sautent aux oreilles dès l’entame Prodrome mais Klein a le bon goût d’y associer une rythmique motorik très Neu !. L’influence de l’Anglais se mêle aussi à une guitare surf sur Le Pont, titre qui a tendance à faire taper du pied ce qui est assez rare finalement. Ça se retrouve aussi sur le très entraînant Les Valeureux, belle réussite de ce disque totalement instrumental.
Ce serait quand même très injuste de le résumer seulement à l’aune de Reilly. Comme dans ce meme qui circule sur internet avec Orson Welles devant un château qui dit « ça vous plait ? C’est français », il y a aussi quelque chose de très hexagonal dans l’esprit du revival frenchie des années 70 amorcé il y a déjà longtemps par Air. On le retrouve dans Eros Neros et son côté enfantin rappelant De Roubaix. C’est aussi le cas avec Au vent et cette petite guitare acoustique si caractéristique en fin de morceau. Si tout ne m’a pas convaincu et que le son a tendance à être un peu trop clean pour ce genre de musique, ça vaut le coup de s’y attarder. D’ailleurs, et pour parler encore ce groupe devenu honni aujourd’hui que sont les Red Hot, le mec a des faux-airs d’Anthony Kiedis jeune. Emmanuel JEAN









1 commentaire
Thomas Ducres pour un titre qui se revendique de la free press underground us et consorts vos gout musicaux sont ultra mainstream on se croirais dans un rayon disque d’hypermarché carrefour : Beyoncé ,MGMT ,JB Dunckel ,sérieux vous avez pas honte Gonzaï .? vous défrichez que dalle ,c’est le top 50 chez vous et encore je suis gentil vous faite vraiment pitié