Comme le dit la phrase désormais consacrée, « c’était l’un des grands derniers ». Décédé chez lui le samedi 24 septembre à l’âge de 81 ans, l’un des pères du jazz mystique et spirituel laisse derrière lui une discographie moins reposante qu’il n’y paraît et à laquelle on aura du mal à tout comprendre à moins d’avoir obtenu un master John Coltrane. Rédigé à la hâte sans aucune préparation, et foncièrement subjectif, l’article qui suit devrait permettre aux novices d’y voir un peu plus clair ou, au moins, de disposer d’un double des clefs de cette œuvre pharaonique.

« Pharoah’s First » (1965)
Comme l’indique le titre de l’album, ce n’est pas le deuxième album du saxophoniste qui a fait ses gammes derrière John Coltrane. Pharoah avouera d’ailleurs plus tard n’avoir jamais vraiment compris pourquoi l’homme derrière « A love supreme » l’avait engagé. Pas encore plongé dans la culture africaine et indienne, l’objet semble encore ancré dans les années 50 et peine à émerger contre un chef d’œuvre fulgurant, à moins que vous soyez passé expert du port du collier de barbe et détenteur d’une sacoche en cuir offerte par le service abonnement de Télérama.
« Tauhid » (1967)
Comme Sun Ra ou Miles Davis, Sanders profite des années 60 pour, très jeune, regarder par-delà l’Atlantique. Direction l’Egypte et l’Afrique (et même les gammes japonaises), pour ce qui plus tard donnera naissance au mouvement afro-futuriste, avec musicalement, des ambiances et atmosphères qui donnent prennent le pas sur le jazz à la papa, au sens strict. Nettement moins mélodique que les essais similaires de Cannonball Adderley sur « Accent on Africa », plus expérimental aussi.
« Karma » (1969)
Troisième album de l’Américain, « Karma » sonne étrangement plutôt comme un premier ; le premier du moins à s’affranchir de pas mal des codes du genre. Celui qui aussi, visuellement, trace une ligne Maginot assez claire entre le commun des jazzmen et lui. L’élévation de l’âme, la transe et la dissolution de la raison dans un grand tout ; voici en quelques mots le programme de ce disque dont la première piste (The Creator has a master plan) est tellement longue qu’elle devra être splittée sur les deux faces du vinyle. Rien que ce titre permet de donner un aperçu de l’état mental des auditeurs de la fin des années 60, tant les longues divagations finissent par ôter tout doute quant au potentiel spiritual jazz de celui qui n’a encore que 29 ans. Avec le recul, et quoi qu’en pensent les gardiens du temple, le tout est un peu pénible sur la longueur pour qui refuse de lire ses notifications Instagram pendant les 38 minutes que dure cette expérience.
« Jewels of Thought » (1969)
Bien après avoir commercialisé cet album, Pharoah Sanders avouera au New Yorker que « la plupart du temps, il ne sait pas ce qu’il veut jouer ». La simple écouté de Sun in Aquarius permet de vérifier cette promesse ; le titre est littéralement inécoutable. On peut aussi, à l’inverse, se délecter du Hum-Allah-Hum-Allah-Hum-Allah en face A, qui prouve que question titre aussi, l’homme n’aimait pas non plus faire simple. Au micro, c’est le fidèle Leon Thomas qui colmate les brèches, comme possédé. On ne parle pas encore de jazz cosmique, mais de soul jazz impossible à écouter dans les soirées cocktail.
« Thembi » (1971)
A la façon d’Herbie Hancock, le Pharaon va profiter du début des années 70 pour partir en voyage. Et alors que l’élève de Miles pond « Mwandishi », Sanders commence à insérer un peu d’air dans ses compositions. C’est notamment le cas sur le titre Astral traveling qui, étonnamment, fait pas mal penser à l’introduction du « Caravanserai » de Santana, de loin le meilleur album du guitariste à moustache. Accessible, rythmé et plus précis que les essais antérieurs pour sa capacité à démocratiser le jazz dit cosmique, « Thembi » est bien l’une des œuvres pivot du saxophoniste ténor.
« Elevation » (1973)
Nombreux sont ceux à s’être fait couillonner par la pochette de ce faux album studio ; en vérité un enregistrement live réalisé à Los Angeles sur trois soirées de 1973. Sur internet, on peut lire le commentaire d’un dénommé Dave Brubeck (sic), résumant l’affaire ainsi : « Un des albums de Pharoah Sanders les plus faciles d’accès, pour une fois sa musique ne fatigue les oreilles et c’est pas plus mal, du Sanders sans le principal défaut, une vraie réussite ». Faire beau et simple, parfois c’est bien. Et présentement, c’est un autre sommet.
« Village of the Pharohahs » (1973)
Au premier abord, ce huitième album ressemble au caprice d’un dictateur africain ayant affamé son peuple pour s’offrir un joujou dissonant. C’est un peu rapide comme jugement, et à réécouter la trilogie d’ouverture, on comprend mieux où des musiciens hybrides comme Etienne Jaumet ont été cherchés leurs inspirations. Plus classique que « Karma », cet « opus » comme disent les Latinistes, a au moins le mérite de faire le même effet qu’un hublot dans un avion ; c’est une parfaite introduction au ciel pour qui a le poil qui hérisse à la première stridence. De ce point de vue, des titres comme Memories of Lee Morgan devraient être obligatoires sur toutes les compagnies aériennes.
« Love in us all » (1974)
On dirait une grosse publicité pour des pulls Castelbajac, mais non, « Love in us all », comme on l’aura compris, est un message d’amour universel ; un thème très en vogue au milieu des années 70 – et étonnamment, beaucoup moins dans la Russie de Vladimir Poutine. Pas de black power ici, mais une direction positive pour la communauté afro-américaine. Un aveu de modestie aussi, puisqu’il faut attendre la huitième minute de Love is everywhere pour entendre le maestro souffler dans son instrument. En face B, un titre (To John) à écouter comme un hommage au mentor, Coltrane.
« Shukuru » (1985)
Petit saut dans le temps, histoire de crisper tous les ayatollahs puristes qui n’oublieront pas de pointer du doigt que ce papier est rempli d’oublis, avec, scandale, un disque des années 80. Oui, Sanders le prophète, comme Miles, est tombé dedans. Et ça s’entend, puisqu’il y a des… synthés. Certes, ce n’est pas au niveau d’Erasure niveau vulgarité, mais quand même. « Shukuru » est surtout l’album des retrouvailles avec Leon Thomas, sur deux titres dont le néanmoins très beau Sun Song, moins avant-gardiste que dix ans plus tôt. Par respect pour les morts, on fera l’impasse sur le reste de la discographie des années 80, au graphisme douteux et dignes des compilations Esso. Pas vraiment la note bleue, quoi.
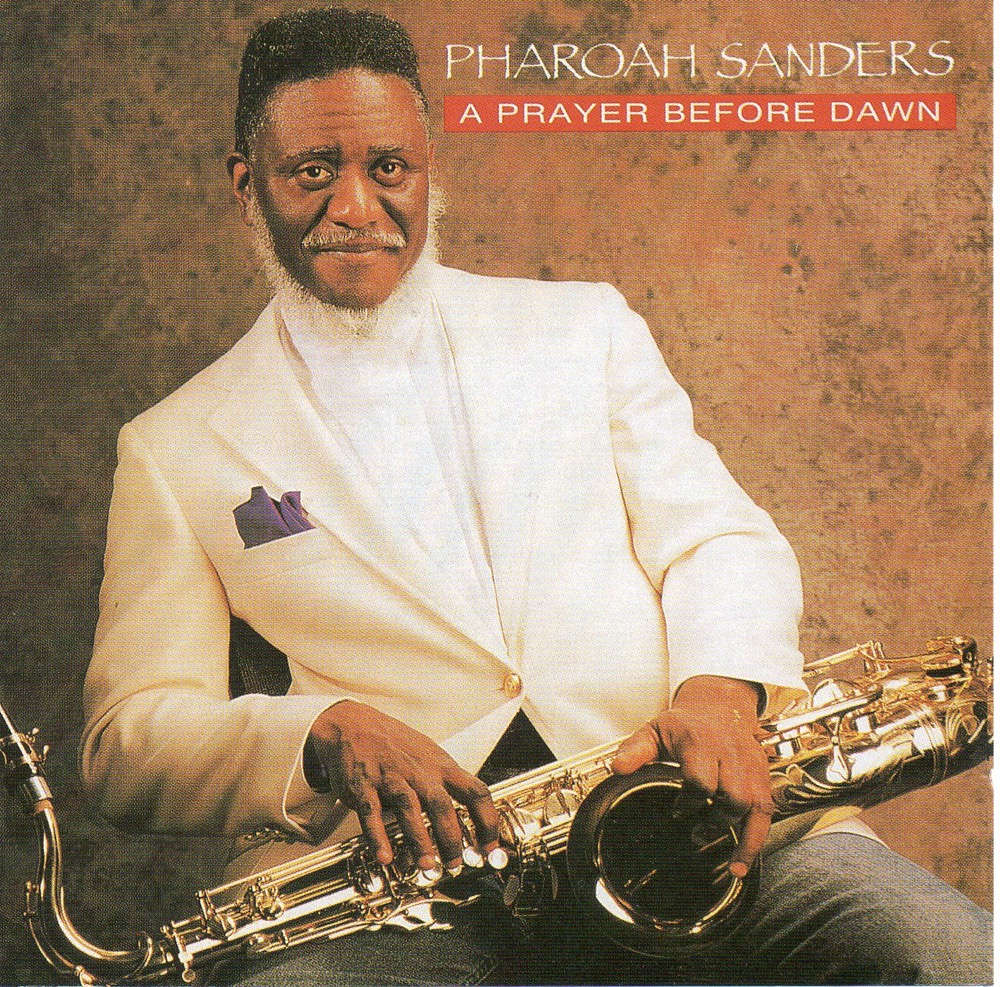
« Live in Paris » (2020)
Enregistré le 17 novembre 1975 au studio 104 de la Maison de la Radio, à Paris, « Live in Paris » a finalement droit 45 ans plus tard à sa réédition sur le label Transversales. Et au-delà du « coup commercial » réalisé par son co-fondateur Jonathan Fitoussi, le disque laisse découvrir une face mésestimée du personnage, à savoir le sentiment de joie qui se dégage de certaines de ses compositions. Love is here ou Farrell Tune débordent d’une énergie adolescente, et l’on croirait presque voir un jeune teckel mettant la maison sens dessus dessous. A la fois free, soul et même gospel, le disque mériterait d’être offert à celles et ceux craignant la trop grande complexité des enregistrements Coltrane.
« Promises » (2021)
Parmi les nombreuses collaborations du zigue tout au long de sa carrière, de Sun Ra à Jah Wobble en passant par Alice Coltrane, on n’aurait pas misé sur celle avec le DJ anglais planqué derrière son blase Floating Points. C’est pourtant avec lui que Sanders, alors âgé de 81 ans, va retrouver la lumière à un âge où la majorité des jazzmen tremblent dans un EPHAD en attendant la note finale. Sur « Promises », largement acclamé par la presse à sa sortie, le terme jazz cosmique retrouve toutes ses couleurs, toute son envergure, toute sa splendeur ; la plus grande réussite de Floating Points ayant sans doute été de capter l’essentiel en faisant le vide autour du saxophone. En neuf mouvements tous liés les uns aux autres, et avec le London Symphony Orchestra en trame de fond, le disque à la fois ambient et minimaliste laisse entendre un Sanders littéralement a cappella pendant 46 minutes, le temps d’un éloge testamentaire qui sonne à la fois comme une parfaite introduction au reste de l’œuvre, et peut-être comme le meilleur album, toutes époques confondues, de celui qui aimait souffler vers le ciel.









1 commentaire
Donc le mec ne savait pas pourquoi Coltrane l’avait engagé ? c’est pourtant assez clair, il joue super bien de l’aspirateur et de la souffleuse à feuilles.