Lydia Lunch. Rien que le nom me fait penser à ce festin de Burroughs qui dresse en même temps un sourire sur vos lèvres, et vos cheveux sur votre tête. Vous savez d’où ça lui vient ce patronyme?
Deux versions s’opposent. La première c’est que cette punkette-avant-l’heure fauchait de la bouffe à ses copines friquées (ou non) pour nourrir ses amis clodos. Ou punks. Ce qui revient un peu au même dans le Bowery. La seconde, c’est parce qu’elle refilait ses serviettes hygiéniques, garnies de poils, à Stiv Bators qui les engloutissait pendant les sets des Dead Boys. Festin de roi. Affaires de goût.
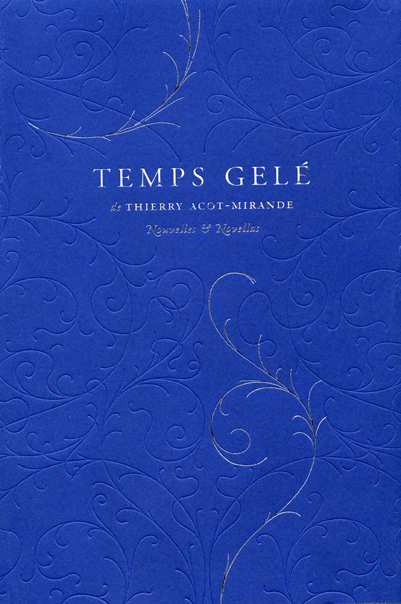 Par la suite, la dame devint une princesses morbide et obscène de la scène punk arty de N.Y., criarde ou morne selon les projets et les collaborations, apparaissant tantôt à l’écran, tantôt sur les inside-notes d’albums confus. Son autobiographie ressemblerait à du Antonin Arthaud que ça ne m’étonnerait pas. La bisexualité en plus.
Par la suite, la dame devint une princesses morbide et obscène de la scène punk arty de N.Y., criarde ou morne selon les projets et les collaborations, apparaissant tantôt à l’écran, tantôt sur les inside-notes d’albums confus. Son autobiographie ressemblerait à du Antonin Arthaud que ça ne m’étonnerait pas. La bisexualité en plus.
Lydia Lunch, c’est une incarnation du chaos. Toute éventualité de réalisation devient soudain plus imminente, plus statistiquement probable. Plus tentante aussi. Répugnance/attirance. L’enfer le plus noir et le plus brillant, comme une onyx faite chair de femme. Digne, touchante et intelligente. Et comme moi, Thierry Acot-Mirande en est intimement convaincu. Sa dédicace le prouve.
Moi non plus, je ne savais rien de ce type avant d’ouvrir ce bouquin.
Mais les éditions Monsieur Toussaint Louverture sont d’une mesquinerie sans pareil : impossible de ne pas caresser une telle couverture, ce bleu outremer, comme ciselé et paré de rabats 100mm, ses pages 300gr… Ce n’est plus du packaging, c’est un équipementier pour automobile de collection ! Les éditions MTL dealent, un point c’est tout. Encourage l’accoutumance. Alors j’ai plongé. Et ce n’était pas gagné.
Paré d’une prose qui trouverait plus sa place chez Breton, ou Vian s’il avait joué de la trompette comme James Chance du sax, on attendrait de cet auteur une place sur le premier bateau en partance pour le panthéon. Enterré avec les décrépis j’entends.
Mais les thèmes, mes enfants, les thèmes qu’il a choisi, eux ne peuvent se résoudre à l’enfermer dans un caveau. Pas encore.
 Il y a bien une poignée de nouvelles qui sentent le déjà écrit, les terrrrribles guerrrrres briseusent d’amour par exemple. Mais même là, on a l’impression de lire un à-la-manière-de Lovecraft ou Poe. Par contre, le reste… Les ambiances de salon, velours côtelé et boiseries drapées, les femmes dont on voudrait mordre le réalisme de la plastique, cette propension à tomber sur un corps difforme, cette obscène incitation tacite au cannibalisme… C’est entre Lynch et Cronenberg qu’on dîne ce soir. Viande froide servie dans son sang. Répugnance/attirance.
Il y a bien une poignée de nouvelles qui sentent le déjà écrit, les terrrrribles guerrrrres briseusent d’amour par exemple. Mais même là, on a l’impression de lire un à-la-manière-de Lovecraft ou Poe. Par contre, le reste… Les ambiances de salon, velours côtelé et boiseries drapées, les femmes dont on voudrait mordre le réalisme de la plastique, cette propension à tomber sur un corps difforme, cette obscène incitation tacite au cannibalisme… C’est entre Lynch et Cronenberg qu’on dîne ce soir. Viande froide servie dans son sang. Répugnance/attirance.
T.A-M. confesse une affection new wave, dont on devine le contour glacial dans ces personnages masqués, travestis, dans la nuit sur Tokyo dans une tour de verre, ces réflexions tordues sur les probabilités, l’ère du nucléaire qui ne finirait pas. Comme si Pacadis n’était pas encore mort. Mais déjà, on sent venir cette fascination pour un douloureux soleil argentin qui voit mourir les taureaux et fleurir les novellas. Pas les soap brésiliens. Les histoires, un peu plus courtes qu’un roman, un peu plus longue qu’une nouvelle. Informes, elles aussi.
Récemment, T.A-M. avouait que ses personnages ne croyaient pas en le futur. Lui non plus. A n’en pas douter. Il vit dans une perpétuelle projection d’un avenir qui fut moderne avant d’être suranné. Déplacé même. Un monstre inamovible à jamais protégé derrière sa vitrine de papier cartonné bleu. Comme verglacé.
Thierry Acot-Mirande // Temps Gelé // Editions Monsieur Toussaint Louverture (mars 2009)






