Son premier disque est sorti il y a presque dix ans. La trentaine déjà bien entamée. Depuis, Bertrand Belin fait « carrière » au milieu d’un champ de ruines où les maisons de disque vous montrent la sortie au premier échec (Sony l’a viré « pour manque de succès »), où les porte-monnaie ne s’ouvrent plus que pour s’abonner à Spotify et Deezer. Sinistré, le business de la musique ? Le Breton parle d’une « espèce de cataclysme », mais parce qu’on l’a amené sur ce terrain. Lui suit sa route. Depuis longtemps. « S’il t’en coûte, de voir une route, sans l’emprunter », chante-il sur « Cap Waller », son dernier disque. Bertrand Belin a fait son choix depuis un bail. « Je suis rien d’autre qu’un musicien, c’est foutu, quoi. » Évidemment, il n’en a pas toujours été ainsi. Évidemment, ça devait arriver. Autant vous prévenir et comme on est parti pour 10 000 signes, si vous baillez déjà, le bureau des bras qui tombent ne ferme jamais, il est encore temps d’aller procrastiner sur les réseaux sociaux.
Au petit jeu du rembobinage, le quadra confirme des débuts rockab avec son frère. On a même lu ici et là que la guitare avait été une planche de salut. Que son marin de père était violent. Lui évoque la nécessité de « négocier avec son passé » avant de coucher des mots sur le papier, avec ou sans guitare autour. Et confesse avoir « vécu dans un environnement violent, j’ai été battu, les gens autour de moi ont été battus, y avait du sang, ça castagnait tout le temps… » Silence dans la loge. Que pourrait répondre un inconnu à dictaphone à un inconnu à guitare ?
« Pisser debout »
Les débuts, donc. À jouer avec ou pour d’autres. À finir par connaître sur le bout des doigts tout Hank Williams et Johnny Cash, à développer ce drôle de jeu de guitare tout en souplesse et sans accords plaqués qui dit son refus de surligner et son goût prononcé pour les nuances. À apprendre le métier, quoi. Avec en toile de fond ce répertoire anglo-saxon qui fait qu’aujourd’hui un chanteur français pense en anglais quand il attrape sa guitare, malgré tous les Bescherelle et les subjonctifs de l’imparfait chers à l’Hexagone. Sing Sing, moitié de Arlt, qui a croisé le bonhomme un soir de concert commun à la Maroquinerie il y a seize ans, le dit autrement : « J’étais frappé par son jeu de guitare, dans lequel je reconnaissais cette pulsation venue du rock n’roll des pionniers. » Pas étonnant que les deux hommes se soient trouvé des accointances. Ce soir-là, ils ont parlé de Stravinsky, de Bartok et Marc Ribot, « d’orgasme et de pisser debout ». Vaste programme. Qu’ils ont décliné pendant plusieurs années, l’un bossant pour l’autre et vice-versa. « Ces moments étaient intenses et joyeux et nous les prolongions jusqu’à l’aube, dans les pires brasseries, en compagnie d’ivrognes et de boxeurs à la retraite… » se souvient Sing Sing. Le prix à payer ? Des gueules de bois en guise de compagne au réveil. « Chacun a tâté du canapé de l’autre et plus souvent qu’à son tour. »
 Arrivé là et sans avoir encore évoqué un seul disque de l’auteur-compositeur-interprète, on comprend que, dès le départ, on a fait fausse route. Par naïveté. Et un peu par paresse : des années passées à recevoir disques et bios finissent par donner de mauvaises habitudes. Et faire oublier l’homme derrière la façade promo. Les accidents, les difficultés, les doutes, les emmerdements, les envies par encore mûres, les années passées à travailler sa matière première ; à tailler dans le vif du sujet « quand bien même le sujet ne colle pas à la syntaxe », psalmodiait Léo Ferré. Bertrand Belin a donc pris beaucoup de chemins, avant que des attachés de presse n’impriment sa feuille de route avec son nom tout en haut de la bio. « J’ai pas démarré si tard, j’ai publié un disque à 35 ans. Publier et démarrer, c’est pas la même chose. Quand j’avais 18 ans, j’écrivais des chansons et je les chantais sur scène. J’avais pas fait de disque, la presse s’en foutait et ça a duré comme ça pendant de nombreuses années. »
Arrivé là et sans avoir encore évoqué un seul disque de l’auteur-compositeur-interprète, on comprend que, dès le départ, on a fait fausse route. Par naïveté. Et un peu par paresse : des années passées à recevoir disques et bios finissent par donner de mauvaises habitudes. Et faire oublier l’homme derrière la façade promo. Les accidents, les difficultés, les doutes, les emmerdements, les envies par encore mûres, les années passées à travailler sa matière première ; à tailler dans le vif du sujet « quand bien même le sujet ne colle pas à la syntaxe », psalmodiait Léo Ferré. Bertrand Belin a donc pris beaucoup de chemins, avant que des attachés de presse n’impriment sa feuille de route avec son nom tout en haut de la bio. « J’ai pas démarré si tard, j’ai publié un disque à 35 ans. Publier et démarrer, c’est pas la même chose. Quand j’avais 18 ans, j’écrivais des chansons et je les chantais sur scène. J’avais pas fait de disque, la presse s’en foutait et ça a duré comme ça pendant de nombreuses années. »
Résumons : un jeune Breton épris de mots, de rock et de bluegrass se lance dans la musique sans se douter qu’un jour il occupera une place à part dans la chanson française ; pas un trône, mais un fauteuil qu’aujourd’hui on n’aimerait pas voir vide. Lui non plus, d’ailleurs. Bertrand Belin n’est pas du genre à dire : « Ça me ferait chier de faire un four ». En interview comme dans ses chansons, le bonhomme pèse ses mots. Et maintient la distance. Une affirmation maladroite, entre tentative de copinage et compliment masqué à propos de sa singularité avec laquelle on voit mal comment il pourrait faire un tube ? Ça donne l’échange suivant :
Bertrand Belin : Y’a des gens qui sont très contents de faire un tube et après, d’aller acheter des chevaux.
Gonzaï : Vu ce que vous faites, ça m’étonnerait.
Bertrand Belin : Non, je dis simplement qu’il y a des gens que ça gêne pas de faire un disque qui fonctionne et puis d’arrêter et de devenir banquier… Mais y a des hasards dans la vie. D’abord, je me sens pas complètement à l’abri d’un tube, même par rapport à ce que je fais. Condamner ce que je fais à l’anonymat et à l’ombre, c’est pas une chose que je fais, je ne parie pas là-dessus.
Gonzaï : Faire un tube, c’est tout le mal que je vous souhaite.
Bertrand Belin : Je me le souhaite indifféremment, oui ou non, l’important, c’est d’être là, de pouvoir jouer, tant que ça dure, c’est ça qui compte.
Dont acte. Parlons musique, alors. Sa place dans le paysage musical français, on y reviendra plus tard.
Le mot juste
Bertrand Belin est un homme d’économies. Peu de mots, mais les bons, si possible. Qui font deviner ceux qui sont tus. Des arrangements ténus, hypnotisme sans gourou ni sentiments dictés, pour saisir sans violence. Interpeller en murmurant. Et ne plus lâcher prise… pour mieux faire lâcher prise. Le tout sans perdre de vue que l’auteur n’a pas grand-chose à voir avec la plupart de la chanson française, passée et présente : « Les clichés du rock je les ai pratiqués et dans mes chansons, j’essaye de prendre cette influence-là mais en coupant tout ce qui clignote trop, comme influence. » Son ami Sing Sing balaie quant à lui les raccourcis : « On l’a comparé à Murat, à Manset et à Bashung. Mmouais. Paresseux. » Pour le moins. Sur « Cap Waller », son dernier disque, il a tout de même passé… un cap. Il y a (un peu) plus de rythme. Chet Samoy, son manager, parle d’un « un album qui nous a fait danser en studio. Un pont imaginaire entre l’Europe et l’Afrique ». Pas faux. Mais Bertrand Belin reste très français. Son goût pour la langue l’empêchera toujours de faire autrement et en ce qui nous concerne, c’est très bien comme ça. Ces dix-mille signes ne sont pas là pour faire le procès de la médiocrité qui règne sur les ondes françaises, chacun écoutant bien ce qu’il veut. En revanche, quand un type de son calibre arrive à coincer son pied dans la porte, on applaudit de pouvoir prendre le nôtre juste en l’écoutant, immobile et transporté. Ils ne sont pas nombreux à nous demander d’être aussi attentifs puis, éventuellement, de s’abandonner. Encore moins face à pareille retenue. « On t’oubliera, on peut faire ça / mais pour l’heure, pour notre bonheur / soigne tes adieux, tu veux / il n’y a rien pour une fête ici / seulement le beau geste, seulement le mot juste. » Derrière, juste un arpège perdu à l’horizon, une batterie à l’os et au ralenti et trois notes de clavier pour tout ornement. Et puis il y a sa voix. Grave et lente la plupart du temps. Belin chante en retrait. Sing Sing, encore lui, le dit comme ça : « Il me semble qu’on a reconnu ensemble les vertus de l’ellipse, de la répétition, d’une certaine érosion du langage comme seule à même de tenir en un chant, un chant inquiet qui parle pour les morts, qui parle pour les fous, qui parle pour les choses et pour les animaux, qui célèbre la vie dans son effroi, sa joie, ses beautés, ses contradictions. »
La vie d’artiste
Devinez quoi ? Avec pareil cahier des charges, Bertrand Belin chemine à la marge. « J’ai failli ne pas faire Hypernuit. Pour cause de non rentabilité. » Après deux premiers albums chez Sony, c’est Cinq 7 qui a signé un artiste qui venait de perdre maison de disques et tourneur. La bouteille à moitié vide raconte une industrie musicale amputée de ses oreilles, les yeux rivés sur les bilans comptables, le reste de la bouteille rappelle qu’il existe encore dans ce métier des mecs capables de savoir ce qu’est un bon disque. Pour la conclusion définitive sur un business qui enchaîne mutations et chiffre d’affaires en chute libre, on passe la main aux experts. En revanche, ce qu’on retient, c’est que Bertrand Belin fait partie de ces gars qui ne peuvent pas faire autrement que de continuer à remplir ladite bouteille. Une pulsion créatrice qui n’empêche pas d’être lucide : « Sans France Inter, ça fait longtemps que je serais plus là. Ça fait ni une, ni deux ». Au moment d’appuyer sur REC, on n’aurait jamais imaginé pareille réponse. Mais puisqu’on y est, poursuivons. Bertrand Belin n’est pas qu’« un artiste France Inter ». Mais une partie de son salut semble être passé par là. Car l’exigence, encore elle, ne passe pas par tous les canaux. Difficile de savoir s’il s’en amuse ou s’en agace : « En étant présenté comme un chanteur littéraire, la poésie contemporaine, on met pas toutes les chances de son côté de toucher un très large public. » Il n’y a pourtant rien de compliqué, au premier abord, dans ses chansons. « Je sais, mais c’est pas ce qui est dit : on parle d’austérité, de surréalisme, de choses obscures, ça fout les jetons aux gens, ils ont pas envie de s’emmerder avec un croque-mort et je les comprends ! »
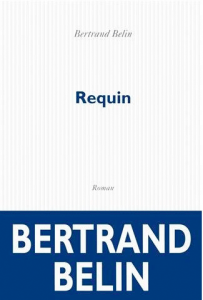 Récemment, Bertrand Belin a même aggravé son cas : il a signé son second roman, chez P.O.L. L’histoire de Requin ? Un homme en train de se noyer revient sur sa vie… Un récit qui a tapé dans l’œil du boss de la prestigieuse maison d’édition. Mais pas question de crier à un quelconque copinage ou une coquetterie d’un éditeur fan de la première heure : Paul Otchakovsky-Laurens n’avait jamais écouté ses disques avant de lire le manuscrit de Requin. C’est un ami commun qui l’a posé sur son bureau. « Mais s’il était arrivé par la Poste, le résultat aurait été exactement le même », précise Paul Otchakovsky-Laurens, qui n’a presque rien eu à faire : « Le travail d’édition a été basique. C’était parfait. » Cerise sur le gâteau, il en a vendu plusieurs milliers. Scoop : le troisième est en route.
Récemment, Bertrand Belin a même aggravé son cas : il a signé son second roman, chez P.O.L. L’histoire de Requin ? Un homme en train de se noyer revient sur sa vie… Un récit qui a tapé dans l’œil du boss de la prestigieuse maison d’édition. Mais pas question de crier à un quelconque copinage ou une coquetterie d’un éditeur fan de la première heure : Paul Otchakovsky-Laurens n’avait jamais écouté ses disques avant de lire le manuscrit de Requin. C’est un ami commun qui l’a posé sur son bureau. « Mais s’il était arrivé par la Poste, le résultat aurait été exactement le même », précise Paul Otchakovsky-Laurens, qui n’a presque rien eu à faire : « Le travail d’édition a été basique. C’était parfait. » Cerise sur le gâteau, il en a vendu plusieurs milliers. Scoop : le troisième est en route.
Le « pari fou fait il y a très longtemps d’écrire des livres » semble donc gagné. Quant au haut de l’affiche, Bertrand Belin, on l’aura compris, n’y compte guère. « J’ai l’impression que si ça avait dû arriver, ça serait déjà arrivé. On [lui et d’autres comme Albin de la Simone ou Babx] restera toujours dans une antichambre. » En attendant, il continue de monter sur scène et son « Cap Waller » est toujours dans les bacs. Son meilleur disque selon Sing Sing. À qui on laissera le mot de la fin. Pas par flemme, mais parce qu’on n’a pas trouvé mieux : « Dans Cap Waller, on trouve, toujours plus minérale, cette parole au bout des choses, à leur exact point d’incandescence terminale, cette parole de peu qui dit l’hébétude devant l’existence, qui fait tenir en une espèce de bégaiement burlesque et grave le très vif et le très inerte dans le même espace, le même plan, la même coupe. » Avouez que ça n’est pas donné à tout le monde.
Bertrand Belin // Cap Waller // Cinq 7-Wagram
Requin // P.O.L









6 commentaires
Mon Vernon, je ne connais que « Parcs », le précédent, que j’ai vraiment aimé.
Stimule moi, dis-moi en quoi « Cap Waller » s’en distingue… et je courrais l’acheter.
Exercice : ta réponse doit tenir en trois lignes.
Le tempo, un cran plus « rapide », inédit chez lui, si je ne m’abuse. Ajoute un art de l’épure qu’il arrive, dingue, à perfectionner : jamais os n’avait eu autant de chair. Et puis merde, BB arrive à faire rimer rock et littérature. Vite, une statue !
Son écriture est effectivement très singulière… et donne envie de s’intéresser à ses bouquins. En tous cas on est d’accord : il a toute sa place ici. Je m’en vais vite écouter « Cap Waller ».
J’ai lu les vingt premières pages de « Requin », c’est top.
très bon papier, merci !