Septembre 2022. Dix ans après son arrivée comme stagiaire, une femme succède à Joseph Ghosn et prend la tête d’un magazine emblématique qui – comme d’autres – rencontre quelques difficultés : Les Inrockuptibles. Impossible de ne pas rencontrer cette nouvelle tête de gondole d’une presse musicale en mode sinusoïdal.
Carole Boinet n’est bien sûr pas une rock critic au sens premier du terme. Même si elle a depuis plus de dix ans beaucoup écrit sur la musique, son terrain de jeu est bien plus vaste. Avant de prendre la tête des Inrocks, elle y était notamment chargée de la diversification et de la conception du numéro annuel spécial Sexe.
Les Inrocks… Créé en 1986 – une époque où trouver des informations sur des groupes de la scène indie s’avérait plus complexe que de décrypter une thèse de physique quantique rédigée en tamoul -, le fanzine a rapidement grandi, grossi, héritant en quelques années d’une aura quasi religieuse auprès d’une jeunesse se voulant différente. Construit autour d’une équipe historique peuplée de désormais grands noms essentiellement masculins – JD Beauvallet, Christian Fevret, Emmanuel Tellier, Serge Kaganski, Gilles Tordjman, Christophe Conte, Arnaud Viviant, etc – le magazine mutera en 1995 vers une formule hebdomadaire élargie. Les gamins avaient grandi, ils étaient temps pour eux de parler aussi de sujets de société, pas uniquement d’objets culturels. Puis la dématérialisation s’est pointée, distribuant des crochets dans le bide d’une presse culturelle remise en cause sur l’autel d’une démocratisation de l’histoire. Qu’ils se nomment E-mule, Napster, MP2-blogs, Bandcamp, Youtube, Deezer ou Spotify, les adversaires se sont révélés nombreux. Il a donc fallu se transformer, repenser le modèle pour continuer à avancer. En attendant le prochain opposant (l’intelligence artificielle?), Les Inrocks sont toujours là. Carole Boinet nous en parle.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Carole Boinet : Carole Boinet, 35 ans. Je suis la nouvelle directrice des Inrockuptibles. Ca fait 10 ans que j’y suis. Que voulez-vous savoir d’autre ?
D’où venez-vous ?
Carole Boinet : Je suis de Saint-Brieuc, la préfecture des Côtes-d’Armor. 40 000 habitants. Environ 60 000 avec la banlieue proche.
Jeune, comment vous vient le goût de la musique ?
Carole Boinet : En 1983, mes parents ont créé le festival Art Rock qui va fêter cette année ses 40 ans. De facto, j’ai grandi dans un environnement très culturel, très musical. En plus, ma mère était directrice de la com’ de la Scène nationale de Saint-Brieuc, et touchait aussi à la programmation. J’ai donc baigné très tôt là-dedans. J’allais souvent voir des spectacles, du théâtre, de la danse, des concerts…Mon goût pour la musique vient de là. Je n’ai pas eu à me battre pour découvrir une certaine culture. A la maison, il y avait des disques de Daft Punk, de Björk, des Sugarcubes. Ou une photo de Flavor Flav de Public Enemy – que mes parents avaient accueilli à Art Rock – par Richard Dumas dans notre salon. Cet environnement musical m’a donc été très familier, très tôt. Il n’y a jamais eu chez moi de distance avec le geste artistique. Qu’il soit théâtral, musical, visuel…. Tout était mis sur le même plan. Cela étant dit, au-delà de cet environnement familial très fort, j’ai aussi grandi avec la musique de mon époque, celle de ma génération, des copains de la cour de récré. J’ai donc aussi grandi avec les Spice Girls – qui faisaient hurler mes parents- avec les CD 2 titres que j’achetais à bloc, avec les Top NRJ, les Hit Machine, etc. Ma jeunesse musicale, c’est un grand mix des deux. Je n’aurais en tout cas pas été la même personne dans un autre contexte familial, je n’aurais peut-être même pas été journaliste.
Votre sœur Alice est pour sa part directrice du festival Art Rock.
Carole Boinet : Oui, elle programme le festival puisqu’elle en est la directrice artistique depuis que mon père est parti à la retraite en 2018 (Jean-Michel Boinet est décédé le 23 février dernier, ndlr). Ça se passe bien, même si ce n’est pas toujours facile. C’est pas une mince affaire. Primo, parce qu’elle l’a repris très jeune. Deuxio, parce que quand on reprend le festival de papa et maman, il faut prouver qu’on sait faire. C’est un métier. C’est pas parce qu’on est né dans cet environnement qu’on a les qualités et les compétences pour assurer ce genre de métier. Il n’y a rien de biologique là-dedans, ça n’est pas inné. J’enfonce une porte ouverte, mais c’est important de le rappeler. Elle s’en sort hyper bien, et je ne dis pas ça parce que c’est ma sœur. Elle arrive à garder l’esprit d’ouverture d’Art Rock, qui n’est pas un festival tourné vers Paris, mais plus vers la ville, les Côtes-d’Armor et plus largement vers la Bretagne. L’idée, c’était de proposer des spectacles qu’on ne voyait pas à Saint-Brieuc, en terme de musiques bien sûr, mais aussi de théâtre, de danse, d’arts numériques, qui est la spécialité du festival. Je trouve que ma sœur parvient à trouver un équilibre entre des blockbusters de type Angèle, Christine And the Queens, Clara Luciani, Lomepal ou Orelsan et des artistes plus indés, plus méconnus, – qu’elle fait jouer dans de plus petites salles – comme Teto Preto, Structures, ou encore, cette année, The Psychotic Monks, Sylvie Kreusch, Pelada…
« J’écoutais Björk comme j’aurais pu écouter des comptines de noël. Rien ne me paraissait hors de portée. »
J’en reviens à vous. Qu’est ce qui va vous donner envie d’écrire sur la musique, et pas seulement d’en écouter? Lisiez-vous déjà la presse musicale ?
Carole Boinet : Je me souviens précisément d’un moment à Saint-Brieuc. J’étais en quatrième et je suis allée à la bibliothèque municipale. Ils avaient notamment un abonnement à Rock & Folk. A l’époque, R&F mettait un cd dans le magazine. Je l’avais emprunté. Sur ce cd, il y avait un premier titre d’un jeune groupe qui s’appelait The Strokes. Ce titre, je l’avais essoré tellement je l’adorais. C’était la première fois que je ressentais une forme d’attache de chewing-gum à un morceau. Quoique j’avais déjà eu ce sentiment avec l’album blanc des Beatles en CM2 qui m’avait rendue dingue. Donc impossible de me détacher de ce morceau des Stokes que j’écoute en boucle dans ma chambre. A un moment, mes parents viennent me voir et me disent « Tu sais, souvent, un titre est relié à un album ». Ils m’amènent chez le disquaire et, avec mon argent de poche, j’achète mon premier cd, « Is This It » des Strokes. On était en 2001, et j’étais en quatrième. Ca a été ma première connexion avec la presse musicale. J’ai repris R&F à la bibliothèque, mais quand je le lisais, je ne comprenais pas vraiment ce dont ça parlait. Ca me paraissait un peu obscur, d’autant que je n’avais pas les références. Jusque là, j’avais un rapport très instinctif à la musique. Même si je baignais dedans, mes parents ne m’avaient jamais expliqué son histoire. C’était pas des parents « relous » qui me disaient « Il faut écouter ça, il faut connaître ça, tel groupe s’est créé en telle année ». Pas du tout. Ils nous laissaient juste prendre les cd qu’on voulait si on en avait envie, venir aux concerts ou aux spectacles si ça nous disait. Jamais ils ne nous ont dit « Il faut commencer par là pour atterrir à tel point ». C’était un environnement un peu sauvage, en tout cas avec un rapport très sensible, très primaire à la musique. Pas du tout intellectuel. C’était à mon avis une bonne chose puisque ça a annulé toute distance avec la musique. J’écoutais Björk comme j’aurais pu écouter des comptines de noël. Rien ne me paraissait hors de portée. Je n’avais pas l’impression de manquer de références pour accéder aux albums. Rock & Folk arrivait dans mon existence avec toutes les références, en termes d’écriture, de musique. J’essayais de me le coltiner mais c’était difficile.
Et Les Inrocks ?
Carole Boinet : Mes parents étaient abonnés, mais ça me faisait un peu le même effet que Rock & Folk. Au lycée, je comprenais pas bien de quoi on me parlait. J’avais toujours l’impression d’être à la rue, de ne pas avoir les bons trucs, de ne pas maîtriser toute l’histoire du vingtième siècle pour accéder à quelque chose. Ce qui m’a donné envie d’écrire sur la musique est finalement arrivé post-bac. J’adorais déjà écrire. Mais de façon personnelle et très fictionnelle. J’ai toujours écrit des fictions dans mon petit coin depuis toute petite. Le dimanche, je m’enfermais souvent dans ma chambre pour écrire une nouvelle, ou un roman, qui toutes et tous sont restés inachevés ! Petite, j’avais même cette grande ambition d’être écrivaine. Après le lycée, j’ai fait khâgne et hypokhâgne. J’étais très sérieuse, je voulais être prof de fac. Même si j’écoutais beaucoup de musique, ça n’était pas non plus au coeur de ma vie.

Alors que j’étais en khâgne spé philo, à Chateaubriand, à Rennes, je rencontre Marion et Anne-So, deux filles qui, elles, sont aux Beaux-Arts. Deux filles très éclatées, à l’opposé de moi. Elles ont des looks : vestes en cuir rose pour l’une, noire pour l’autre, coupes de cheveux travaillés, maquillage appuyé, mini-jupe ou slim. On écoutait la même musique tout en la vivant très différemment. Je suis alors très sérieuse, mais je me passionne pour le Velvet, Patti Smith, Talking Heads, Siouxsie and the Banshees, Gang of Four, Adam and the Ants, The Cure… Elles vivent aussi la musique dans leurs attitudes, que reflètent leurs fringues. Elles sont très rentre-dedans, elles gueulent, elles ont un discours, affirment leur goût. Ca me fascine, et on devient très amies au moment où elles montent Mademoiselle Âge Bête, un fanzine. Très rapidement, elle me propose d’y participer puisque je sais écrire. Elles se voient plus sur l’aspect graphisme, photo, visuel. Je me suis alors mise à écrire dans un cadre complètement libre, celui du fanzine. Il n’y avait pas vraiment de règles à respecter. On inventait plein de formes, plus ou moins réussies d’ailleurs. Il y avait des récits fictionnels, des interviews foutraques, des semblants de critiques musique sur des titres ou des albums… On disait ce qu’on pensait, avec la plus grande liberté, dans le sens où on n’essayait vraiment pas de correspondre à quelque chose ou en se sentant limitées par un manque de connaissance. Avec elles, je retrouvais un rapport assez sauvage à la musique, même si un peu plus intellectualisé, puisqu’on mettait des mots dessus. Le tournant se situe là. A ce moment où toutes les trois, on bâtit un fanzine qu’on va imprimer dans le centre-ville. A ce moment où on va faire le tour de Rennes pour trouver 20 euros par-ci par-là pour le financer : les Transmusicales, Rockin’ Bones, ou notre cordonnier qui réparait nos boots et était, par le plus grand des hasards, un ex de Marquis de Sade, nous ont aidées. C’est le moment où j’ai compris que musique et écriture pouvaient avoir un lien, et que ce lien était plus fort en moi que ce que je pensais.
Dans ce fanzine, vous signiez RollK. Pourquoi ?
Carole Boinet : Pour la rappeuse Roll.K. Dans son titre Roule avec Roll.K, elle rappait « Si tu roules avec Roll.K, n’oublie pas de ramener des potes-ca ». Ca nous faisait rire. On avait un rapport aux garçons qui était assez rentre-dedans. On leur gueulait dessus, on s’affirmait. On était aussi à la tête de Rennes Riot, une association qui nous permettait d’organiser des concerts. On programmait essentiellement des groupes de mecs. Mais c’était nous qui tenions l’asso. On avait vraiment cette double envie, d’être respectées, et d’aller vers les garçons. Si un garçon nous plaisait, on ne voulait plus que ça soit à lui de faire le premier pas. Il y avait en nous ce truc de frondeuses, d’insolence, qu’on retrouvait dans ce morceau de Roll.K. On affirmait le fait de coucher, d’avoir des désirs, des fantasmes, un sexe palpitant entre nos jambes. On trouvait ça super d’asseoir notre sexualité en tant que filles. On se revendiquait un peu « salopes », en mode retournement du stigmate. D’où le pseudo RollK, que j’ai ensuite garder quand je faisais des DJ-sets. J’étais DJ RollK.
En vous écoutant, on se dit que la musique semble avoir été moins fondamentale dans votre parcours que la littérature et l’écriture.
Carole Boinet : Je crois. Mon rapport le plus instinctif va aux livres. Je suis une énorme lectrice. C’est là où je me sens le mieux au monde. Je peux lire dans le silence, seule chez moi, pendant des heures. J’aime beaucoup écrire, trouver un rythme, jouer, faire s’entrechoquer des mots qui ne devaient pas se rencontrer, dessiner une image avec la forme. Ou mettre une virgule à une place où on ne l’attendait pas. Ou essayer – désolé si ça fait un peu poésie de comptoir – de tordre une phrase tout en la rendant intelligible. Ce qui m’intéresse, c’est la musicalité des mots. Dans la littérature, j’aime le discours, mais aussi la forme par laquelle il passe. Ce qui est assez périlleux, car trop de forme peut noyer le discours et devenir poseur… Finalement, musique et littérature ne sont pas si éloignées que ça. Par exemple, dans la musique, les textes m’ont toujours beaucoup parlé, pas tant pour le sens véhiculé, que pour leur musicalité. Pourquoi suis-je allé instinctivement vers la pop ? Peut-être parce que c’est le genre musical le plus facile d’accès, mais aussi parce qu’il abrite une alliance texte/musique qui me parle énormément. Coller des mots, écrire des phrases qui parfois n’ont pas de sens, ça me plaisait beaucoup et ça développait en moi un imaginaire dingue. Chacun cherche ce qu’il veut dans le geste artistique, mais ce que je recherche personnellement, c’est qu’il m’offre à voir ce que je n’aurais pas pu imaginer, des images inédites. Pour moi, c’est ça aussi, le geste artistique. Balancer dans le monde quelque chose d’inédit qui provoque en nous un sentiment lui aussi inédit. Il faut arrêter de résumer les sentiments à J’aime/J’aime pas, l’amitié/l’amour, la joie/la colère…Il y a une variété beaucoup plus grande de sentiments. Un jour, quelqu’un réveille chez vous quelque chose qui n’existait pas auparavant, ou qui était endormi, à l’aide d’un mot, d’une guitare, d’une batterie, ou simplement d’un synthé, d’une machine.
« A l’époque, mes parents sont un peu paniqués, en mode : C’est quand même mieux d’être fonctionnaire que d’être journaliste ».
Vous êtes entrée comme stagiaire aux Inrocks en 2012.
Carole Boinet : Un peu avant, je voulais être prof de fac. J’obtiens un master d’art et culture visuels en anglais à Paris 7. Après le M2 se pose la question de faire une thèse et de passer l’agrégation. Soudain, j’ai une prise de conscience. Le réel me rattrape, et je commence à me projeter sur du concret. Je m’imagine passer 7 ans sur un même sujet, dans des bibliothèques où j’ai déjà beaucoup trainées. Ça m’angoisse. J’ai l’impression de fuir une autre réalité. Je commence à percevoir ce voyage dans la thèse comme mortifère. Comme si je n’écoutais qu’une part finalement infime de ma personnalité. Je me rends alors compte que ma volonté de décrypter, d’amener du récit, de tendre le micro à des gens peut aussi se placer hors du champ universitaire, dans le journalisme. Mes parents sont un peu paniqués, en mode « C’est quand même mieux d’être fonctionnaire que d’être journaliste ». Il faut dire qu’à l’époque, la presse n’était déjà pas en forme. Je passe des concours d’école de journalisme, que je n’obtiens pas. A chaque fois, je suis recalée aux oraux. Malgré ces échecs répétés, je ne parviens pas à lâcher l’affaire. Je commence à faire des stages. A Rue89 et à Libération. Ca me plaît énormément. Je découvre une immense joie dans l’immédiateté du sujet. A Libé, je me souviens avoir chroniqué sur deux pages une expo sur le skate à la gaieté lyrique. Pour mon papier, j’avais fait l’expo, multiplié les interviews, commencé à comprendre comment on agençait un article. C’était la première fois où je me posais ces questions : Qu’est ce qu’on veut dire dans ce papier ? Et comment on va le dire ? » Il y avait aussi l’énergie du bouclage, puisque c’était un quotidien. La grande question c’était « Comment donner le meilleur de moi-même dans un temps imparti ? ». Mais aussi « Comment trouver un titre ? », « Comment bosser avec le secrétaire de rédaction ? »… Tout ça avait provoqué en moi plus de choses positives que tout ce que j’avais connu à la fac. J’avais adoré cette excitation, ce travail à la fois solitaire et très collectif. Et le fait d’être lu, le fait que des gens découvrent ma voix, mon regard. Probablement de façon narcissique, égocentrique, aha. Donner à des gens un récit immédiat sur le temps présent m’a passionné.
Je crois que les journalistes ont un rapport très particulier à la mort : écrire, c’est aussi une façon de retenir le temps présent, de le capter, de le mettre en mots, de faire archive. Faire en sorte qu’il ne s’échappe pas, qu’il puisse y avoir une trace de ce qu’on a vu, de ce qu’on a vécu, de ce qu’on a entendu, avec l’approximation, la vulnérabilité, le plantage même que cela peut impliquer Le journalisme, c’est une forme de messe pour le temps présent. Mon stage chez Libé a été fondamental. Là-bas, j’ai rencontré des gens hyper bizarres, comme Bayon. Ca m’a frappé. Je retrouvais chez lui la poésie de l’écriture. Son écriture était ultra musicale. Plein de gens me disaient « Mais on ne comprend rien à Bayon ! ». De mon côté, je l’ai immédiatement compris. J’adorais sa liberté, sa capacité à écrire des textes un peu obscurs, étranges, mais sur du réel et sur du présent. Il s’échappait de la forme journalistique et proposait autre chose. Je retrouvais la différence que j’avais connue enfant, adolescente avec le festival, mais aussi à travers Mademoiselle âge bête.
Vous n’avez pas fait d’école de journalisme. Est-ce un atout ?
Carole Boinet :En terme d’écriture, probablement. Ca m’a permis d’écrire en dehors d’un dogme. Malgré tout, un article, ça s’apprend. A mon arrivée à Libé, j’étais incapable d’écrire un article de presse. Jusque-là, j’avais uniquement écrit pour mademoiselle âge bête, puis pour un blog que j’avais monté avec un copain, Foggy Girls Club. On y parlait uniquement de musique, principalement pop et rock. A Libé, je vais travailler avec Philippe Brochen, Gilles Renault, Christian Losson. Ces mecs vont tout m’apprendre, surtout en terme de cadre, de réel, de concret, soit : comment chercher et trouver l’angle d’un papier, comment raconter quelque chose de compliqué à quelqu’un, comment ordonner. Ils m’ont vraiment donné des cours de journalisme. Cette formation empirique a été une bonne base qui n’a pas écrasé ma volonté de proposer d’autres formes d’écriture. Les Inrocks, j’y arrive par hasard, en cherchant un stage dans la presse culturelle à qui on attribuait déjà l’étiquette « no future ». J’allais souvent aux soirées Inrocks Indie club, que j’avais découvertes à l’Ubu à Rennes. A Paris, c’était à la Flèche d’or, une salle du 20ème arrondissement. Un soir, je m’y rends et je vois à côté de moi Jean-Daniel Beauvallet, une star ! Je prends sur moi, lui tape sur l’épaule et je lui indique en quelques mots que je cherche un stage après avoir écrit pour Libération. Il me laisse son mail. Je lui écris et tout commence. Ondine Benetier, la coordinatrice Musiques des Inrocks m’avait ensuite reçu en entretien. J’étais tétanisé mais ça m’avait permis d’intégrer Les Inrocks.

Dès la fin de votre stage, vous attrapez un CDI aux Inrocks. Chose rare.
Carole Boinet : Mon stage avait duré 9 mois. 6 en musique et 3 en actu. Lorsque mon stage musique s’arrête, je suis supposé enchaîner avec un stage chez Slate. Je dois vous avouer que je suis alors le cul entre deux chaises, puisque je suis intéressée par la société et par la musique. Peut-être car les deux ne sont pas décorrélés… on parle souvent des oeuvres comme si elle surgissait de nulle part, le fameux « génie divin » du Romantisme, mais elles sont situées dans des espaces spatio-temporels. C’est ce que rappelle notamment Isabelle Alfonsi dans Pour une esthétique de l’émancipation. C’est aussi quelque part le débat Proust-Sainte Beuve, le premier soutenant qu’il faut rencontrer l’oeuvre esthétiquement, formellement, pleinement, sans connaitre la biographie de son auteur, l’autre défendant l’inverse.
Pour revenir à mon parcours, même si j’ai beaucoup traîné dans la musique à Rennes, j’ai peur de l’enfermement musical, et j’aime le geste artistique dans toute sa diversité, sa pluralité, pas uniquement la musique. Autre élément important, je suis tétanisée à l’idée de ne pas avoir de boulot, d’être au chômage, de galérer. A ce moment-là, on ne parle que de ça et ça me fait peur. Au moment de quitter Les Inrocks pour Slate, je croise pour la première fois à la machine à café Arnaud Aubron, rédacteur en chef web. Il cherche un.e stagiaire et me propose de rester dans la rubrique « actu ». J’accepte. Je ne verrai donc jamais Slate. Après deux CDD, on finit par me proposer un CDI.
Merci à la machine en café, en somme.
Carole Boinet : Oui. C’est marrant la vie.
En 2012 vous entrez comme stagiaire. Dix ans plus tard, vous êtes la directrice de la rédaction. Au cours de cette décennie, comment avez-vous perçu l’évolution de la presse musicale ?
Carole Boinet : Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que Les Inrockuptibles vont au-delà de la musique. Le magazine a souvent été résumé à la musique du fait de ses débuts comme fanzine purement musical, mais il est depuis longtemps un magazine pluridisciplinaire, avec une dominante musique. Si on ne parle que de la presse musicale, son déclin est indéniable depuis des années. Et avec internet, ça paraît normal. Au départ, il y a eu une très forte concurrence des blogs. Tout le monde peut se mettre à écrire très facilement, sans avoir à monter un fanzine papier, ce qui engageait des coûts, même minimes. Tu vas sur Tumblr ou WordPress et en quelques minutes, tu montes une plateforme qui diffuse ton discours. Les discours se sont démultipliés, ce qui était galvanisant. Mais en parallèle, les critiques des magazines se sont mis à perdre un peu de leur importance.
« Quand internet arrive, les gens peuvent se faire immédiatement leur propre avis sur un album, ils n’ont plus besoin d’un filtre critique ».
Au départ, les gens lisaient des critiques musiques pour s’avoir ce qu’ils allaient acheter. Dans les années 80-90, tu avais une certaine somme d’argent à dépenser dans la musique donc tu n’achetais pas vraiment au hasard. Pour t’aiguiller, il y avait le disquaire et la presse musicale. La culture musicale se faisait comme ça. Cette contrainte économique, c’est aussi ce qui explique, en partie bien sûr, l’existence des chapelles musicales. Si on écoutait du rock, on s’amusait rarement à acheter du rap ou du disco. Parce que ça coutait cher. On se concentrait sur les bacs de rock. On ne pouvait pas comme aujourd’hui, piocher dans toute la discothèque mondiale qu’on trouve sur internet. Quand internet arrive, les gens peuvent se faire immédiatement leur propre avis sur un album, ils n’ont plus besoin d’un filtre critique. D’autant que Youtube est gratuit et que les algorithmes les drivent. L’algorithme humain – celui de la presse, celui du disquaire – devient soudain un peu moins important. Dans le même temps, il y a aussi une tendance à l’horizontalité qui apparaît. Le discours vertical du critique qui fait la pluie et le beau temps est remis en question par les minorités politiques qui gagnent en visibilité et qui demandent : mais qui a écrit cette histoire de l’Art ? Qui a décidé qu’elle serait majoritairement masculine et blanche ? Les minorités politiques- dont je fais partie – ont questionné les goûts, les diktats, l’histoire de la musique telle qu’elle était véhiculée. Les critiques musique ont été ébranlés. A une époque, ils avaient une importance énorme. Presque démiurgique.

Le côté prescripteur a peu à peu disparu. Aujourd’hui, le rôle de la presse n’est-il pas d’identifier les grandes tendances musicales ? Ordonner en quelque sorte une production musicale mondiale devenue pléthorique.
Carole Boinet : Ce qui reste fondamental à mon avis, c’est de mettre des mots sur des œuvres, dans une époque où tout va si vite qu’à peine a-t-on réceptionné quelque chose qu’on passe à la suite sans même digérer, où on parle de plus en plus de « produire du contenu »… En ça, la critique reste importante. C’est important de réceptionner une œuvre, de prendre le temps, de creuser, de la replacer dans un paysage discographique, de l’analyser, de la penser, de l’archiver. Pour moi, le discours critique n’est pas daté. Ce qui peut l’être par contre, c’est le côté « Faire la pluie et le beau temps » comme dans les années 80-90. Pour autant, dans un monde où tout est brouillé, où les fake news se multiplient, où l’on est toutes et tous un peu paumés, scrollant infiniment nos réseaux sociaux sans plus s’arrêter, sans plus savoir ce qu’on nous dit et qui nous le dit, je pense qu’avoir des repères comme un magazine historique, installé, qui parle de culture avec expertise, précision, intelligence, est important !
« On va faire 4 pages sur la scène actuelle de Manchester, que personne ne connaît vraiment, avec Space Afrika, Iceboy Violet, par exemple. C’est ça que j’attends des Inrocks. Pas qu’on fasse comme tout le monde et qu’on parle de SCH ou de Jul ».
On reste des têtes chercheuses, des détecteurs. Aux Inrocks, on a toujours conservé notre rubrique « Nouvelles têtes », où l’on présente de jeunes artistes. Plus globalement, il reste chez Les Inrocks cette volonté de parler de groupes méconnus, émergents, peu médiatisés, singuliers. Après, nous continuons aussi les grandes interviews de personnalités connues, nous racontons effectivement les grandes tendances musicales passées et présentes. Par exemple, pourquoi les musiques dites urbaines ont pris autant d’importance aujourd’hui. Cela peut faire un dix pages. Et c’est passionnant. Même si le lecteur des Inrocks vient probablement plus des Smiths que de Tupac, ça peut l’intéresser. On travaille sur ces deux grands axes. Le fait de faire de l’évènementiel depuis des années nous permet aussi de programmer de jeunes artistes. Avant, on avait le concours CQFD qui est devenu Inrocks Lab. Aujourd’hui on fait des soirées mensuelles à la Boule Noire, baptisées Inrocks super club. C’est vraiment un principe de tremplin, même si il n’y a rien à gagner à la fin. Chaque mois, ça permet de découvrir 3 groupes encore petits. On garde cet esprit. En première partie de Martin Rev lors du dernier festival des Inrocks, à la Bourse de commerce-Collection Pinault, il y avait Bar Italia. La France ne connaît pas encore ce trio qui s’inspire énormément des 90’s, sans être passéiste. Miser sur ce type de groupes reste une force des Inrocks. On garde cette volonté de ne pas être suiveur, mais prescripteur. Ce n’est pas parce que tout le monde écoute du rap qu’on ne va faire que du rap. Nous aussi, on a envie de créer un monde, de proposer nos choix, ce qui nous attire, ce qui nous titille. C’est ce que nos lecteurs attendent je pense, et c’est ce que je souhaite en tant que directrice, que l’on sente qu’il y a de l’humain derrière Les Inrocks, des regards, des goûts, des choix. Pas un algorithme. On va faire 4 pages sur la scène actuelle de Manchester, que personne ne connaît vraiment, avec Space Afrika, Iceboy Violet, par exemple. C’est ça que j’attends des Inrocks. Pas qu’on fasse comme tout le monde et qu’on parle de SCH ou de Jul. En vous en parlant, je me rends compte que j’attends presque plus un discours pointu des Inrocks à l’heure actuelle qu’un discours dit mainstream. Pas simple de dire ça quand on vient de mettre Clara Luciani en couverture, mais face à tout ce qui se passe et aux pertes de repères dans le paysage musical, ça me semble encore essentiel de pouvoir lire des choses précises sur la musique.
L’avenir des Inrocks, ça serait de traiter de musiques de niches ?
Carole Boinet : Je crois. C’est un travail entamé par mon prédécesseur Joseph Ghosn, qui a un grand appétit pour les musiques qu’on qualifiera de non-pop, d’expérimentales. Il avait commencé à en glisser un peu dans le magazine, alors que ça avait été très peu traité jusque là par les Inrocks. Peut-être parce que je me suis lassée de la pop, ces musiques m’intéressent de plus en plus depuis quelques années. Je cherche des formes, des gestes qui me surprennent, qui m’emmènent ailleurs, qui s’éloignent de la facilité, du divertissement pour se montrer plus exigeantes, ou plus bancales. J’en ai marre du tout-marketing, des choses lisses, bien produites, taillées pour être soigneusement digérées par le troupeau… je cherche de l’accident, de la mise à nu, de la vulnérabilité, de la quête. C’est un terrain sur lequel Les Inrocks doivent vraiment s’exprimer. Sarah Davachi, Marina Herlop ou Caterina Barbieri, c’est important qu’on s’y intéresse.
« Si Les Inrocks décident de ne faire que des numéros sur leurs vieilles idoles ou des grandes storys des années 80/90, c’est ultra badant ».
Au cours de notre conversation, vous avez évoqué les Smiths, JD Beauvallet et l’histoire du magazine. C’est lourd à porter, cet héritage historique des Inrocks ?
CAROLE BOINET : Pour être tout à fait sincère, cet héritage peut être pesant. En tout cas glaçant. Dans le sens où le poids de l’histoire pourrait nous empêcher d’avancer. Déjà, tu te dis qu’avant, ils avaient fait des couv’ incroyables. Donc comment être à la hauteur ? Il y a ce poids d’excellence. Mais tu as aussi le fameux poids « Qu’est ce qu’ont été Les Inrocks et qu’est ce que sont Les Inrocks aujourd’hui ? ». Mon avis, c’est qu’on doit bien sûr s’intéresser à l’histoire des Inrocks, mais pas trop. Je n’ai pas le réflexe de me dire « Tiens, je vais aller voir ce qu’on faisait en 1999 ». Je regarde très rarement les anciens numéros, j’essaye de me concentrer sur le temps présent, en me demandant ce que j’aimerais bien voir ou lire dans un magazine culturel aujourd’hui. Si j’ai besoin de repères, de regarder ce qu’on faisait comme numéros Best Of en 2006, je me tourne bien entendu vers les archives, mais dans un troisième ou quatrième temps. Pas au début. Sinon, tu risques de répéter le passé, sans jamais réussir à t’en libérer, sans jamais écrire le présent, encore moins quelque chose d’inédit, de nouveau. Avec la musique c’est pareil, je ne me dis pas « C’est Inrocks ou c’est pas Inrocks ? ». Je vais plutôt me dire « Ok, j’aime bien cette musique. Mais d’où vient l’intérêt ? Ca bouleverse la société ? Y-a-t-il un discours ? Est-ce que c’est un morceau chewing-gum qui te fait du bien parce que t’as une gueule de bois ? …». Je me questionne pour savoir si cette musique mériterait un article. En tout cas, je ne me demande jamais « Est-ce que Rosalia est Inrocks ? ». Je vais me dire que c’est mortel pour telle et telle raison. Puis j’en parle avec la rédac’ Musiques, que je vais essayer de convaincre si je les sens un peu réticents. L’idée, c’est de capter le temps présent. Je ne veux surtout pas faire un magazine qui regarderait dans le rétro. C’est passéiste, et ça sort les violons. A l’heure actuelle, la presse française qu’on trouve en kiosques – je ne parle pas de celle présente au Palais de Tokyo ou chez OFR – n’est pas foisonnante. Il n’y a pas énormément de titres. Si en plus Les Inrocks décident de ne faire que des numéros sur leurs vieilles idoles ou des grandes storys des années 80/90, je trouve ça ultra badant.

En même temps, quand on est à la tête d’un magazine papier, il y a un modèle économique qui doit fonctionner pour ne pas mettre la clef sous la porte. C’est peut-être ce qui explique que quand Les Inrocks sont revenus en mode mensuel, la première couv’, c’est Kurt Cobain et Nirvana. Pas vraiment un groupe actuel.
Carole Boinet : Tout est question d’équilibre. En tant que lectrice, je ne crois pas non plus à un magazine où je n’aurais aucun repère, et où je ne connaitrais rien. Je pense qu’il me tomberait des mains. La nouveauté ne fonctionne que si, autour d’elle, tu as des repères. Les repères, ça va être une grande story sur Björk, Nirvana, New Order… C’est aussi une bonne façon de raconter l’histoire. Je n’ai pas non plus comme volonté de couper avec le passé. J’écoute toujours les Cure ou le Velvet, par exemple. Ca reste très moderne musicalement parlant. Renier le passé, non. Mais relier le passé avec le présent, ça, c’est excitant. D’autant que dans la production musicale, le présent se lit souvent à l’aune du passé. Il faut quand même reconstituer toute l’histoire de la musique. Pour ce qui est du versant économique, il existe bien sûr. Les Inrocks, c’est un mensuel national distribué en kiosques, à côté de l’Obs, de L’Express, de Society… Ca a un coût et il y a forcément des stratégies qui rentrent en jeu. On est loin du fanzine. On doit donc passer des récits, comme des gestes artistiques à des lecteurs qui ne sont pas forcément 24/24h dans l’art, dans la culture, à se farcir des livres, des disques, des films… Ben non, les lecteurs ont une vie. Nous, c’est notre travail, notre quotidien. Pas eux. Sans parler de pédagogie, Les Inrocks doivent être un peu didactiques. C’est le principe même du journalisme. Après, le journalisme, c’est comme la production musicale. Il y a un éventail de radicalité. La question à te poser c’est « Où est-ce que je me situe ? ». Dans un mainstream total où tu prendrais presque les lecteurs pour des cons et où tu parlerais de tout et n’importe quoi sans aucun filtre ? Faire du divertissement pur, ça ne m’intéresse pas. Se focaliser uniquement sur de l’expérimental en mode violoncelle électrique au fond d’une cave, non plus. A mon avis, il faut trouver un équilibre dans ce grand paysage. C’est un vaste jeu d’équilibriste que j’essaie de réaliser.

La presse musicalo-culturelle ne va pas hyper bien. Gonzaï papier, c’est fini. Rock & Folk vient encore de réduire sa pagination. Magic connaît des secousses depuis des années. Brain, c’est fini depuis quelques temps. Vice France vient aussi de fermer. Comment fonctionnent Les Inrocks aujourd’hui ? Salariés, pigistes ?
Carole Boinet : Nous sommes 10 journalistes salariés. Et sinon, on fonctionne avec des pigistes, certains de façon très régulière et depuis des années, comme Patrick Thévenin ou Sophie Rosemont en musiques. Ou pour ce qui est de la rubrique « Scènes », Patrick Sourd ou Igor Hansen-Love. En cinéma idem, avec Marilou Duponchel par exemple. Ils écrivent tous les mois dans le magazine, et toutes les semaines sur notre site internet. On ne va pas se mentir, ça n’est pas la rédaction que j’ai connu à mon arrivée en 2012. Ce qui est normal car à ce moment-là, on fonctionnait en mode hebdo, et on traitait aussi de société, de politique. Ca impliquait plus de moyens humains. Désormais, on a rétréci notre périmètre d’action, pour être plus précis, se recentrer sur nos domaines de compétences. Ca nous permet à mon avis d’être meilleurs sur les champs que nous couvrons. Pour en revenir à votre remarque, il est certain que la presse en général ne va pas très bien. De fait, la culture étant souvent le parent pauvre du reste, la presse culturelle, musicale ou non, ne va pas très bien. Qui plus est dans un temps d’inflation. Dans cette période compliquée, la culture n’est pas la grande priorité des gens. Et ça peut se comprendre. Après, il faut quand même porter un discours autre. C’est essentiel de rappeler à quel point la culture, c’est important. Même si je n’aime pas ce mot. Est-ce essentiel ? Je ne sais pas. En tout cas, la culture, c’est hyper important. C’est une vraie nourriture. Moi quand je vais mal, soit je nage, soit je me tourne vers l’artistique, un livre, un album, un film, une expo… Je me sens comprise, moins seule. Ça ravive et apaise les peines dans un même mouvement.
« Si les Inrocks n’existaient plus, je me sentirais seule. »
La production artistique est donc importante, tout comme celles et ceux qui passent, et qui analysent. Il ne faut pas oublier qu’un musicien qui sort son album, à moins d’être misanthrope et de s’appeler Lou Reed, est souvent content de donner une interview, de trouver quelqu’un qui réceptionne son œuvre, de voir un autre regard posé dessus, qu’on le confronte à ce qu’il a fait ou qu’on écrive un article pour le replacer dans un paysage. Si j’ai pris la direction des Inrocks à 35 ans, c’est aussi parce que je suis convaincue de tout cela. Ca peut paraître con, mais pour moi, c’est quasiment une mission de santé publique. Je serais très déçue que Les Inrocks n’existent pas. Ou alors il faudrait que ça soit remplacé par un autre titre. Et encore, rien ne remplacera Les Inrocks, qui ont vraiment une place unique dans le paysage de la presse française voire internationale, de part leur ton, leur approche, leur regard, leur sujet, leur esthétique… Si ça n’existait plus, je me sentirais seule. Il y un combat à mener, qui durera je l’espère le plus longtemps possible. Ce combat, on le mène en sortant bien sûr un magazine papier, mais aussi en se diversifiant. Les Inrocks ont su très tôt faire autre chose. Monter un festival, un concours, de l’événementiel. Ca permet au mot Inrockuptibles de vivre au-delà du papier, en s’affichant devant La Cigale, devant La Boule Noire, devant L’Olympia. Cela permet de dessiner un monde Inrockuptibles, un combat Inrockuptibles qui sort du cadre étroit du mensuel papier. Pour moi Les Inrockuptibles c’est une somme de passions, de connaissances, d’exigences, de détermination, et d’assurance qui peut exister hors-kiosques. Pas partout, non plus. L’idée n’est pas de coller ce mot sur une Toyota.
Pas encore.
Carole Boinet : Non. Certainement pas avec moi en tout cas.
Tout au long de cet entretien vous avez évoqué de nombreux artistes. Lorsqu’on est journaliste, le mot artiste va souvent avec celui d’interview. Certaines interviews se sont-elles mal passées ?
Carole Boinet : Je ne sais pas si mon cerveau est en mode bisounours ou si j’ai une mauvaise mémoire, mais je n’ai pas de souvenirs d’interviews catastrophiques. Bien sûr, je me souviens de dictaphones qui ne se déclenchent pas, d’angoisses totales quand c’est moi qui me plante sur une date, un prénom, une référence… mais le reste…Ah si, avec Catherine Ringer, ça avait été difficile. Ca ne s’était pas mal passé, mais la personne était difficile. Tu sens qu’elle peut facilement se lever et te dire « J’ai pas envie » ou « Tes questions ne m’intéressent pas ». Je me demande même si elle ne me l’avait pas dit. Mais quand on est journaliste, c’est très bien d’être confronté à ça. On l’oublie parfois, mais l’intervieweur n’a pas à avoir le dessus sur l’interviewé, qui peut tout à fait dire : « Mais en fait, vous n’avez rien compris à mon travail ».
« Une des grandes questions de ma vie, c’est : « Est-ce qu’on attend vraiment d’un artiste qu’il soit sympa ? »
Ce pouvoir de l’interwieweur s’est aussi affaibli du fait de l’affaiblissement de la presse. Les artistes en ont moins besoin pour faire connaître leurs œuvres.
Carole Boinet : Oui, et ça amène peut-être vers des dialogues qui sont plus vrais, moins déséquilibrés en mode promo ou press junket, des formats qu’on déteste tous. Une des grandes questions de ma vie, c’est « Est-ce qu’on attend vraiment d’un artiste qu’il soit sympa ? ». Quand je rencontre des acteurs, des chanteurs, on me demande souvent « Il était sympa, machin? ». Je n’ai jamais attendu de la part des artistes qu’ils soient sympas avec moi. Qu’ils se comportent correctement, oui. Qu’il n’y ait pas de sexisme, oui. Mais qu’ils soient sympas…Un journaliste n’est pas pote avec un artiste. Le mode friendly de certains interviews sonnent un peu fake. Ce que j’attends ou espère d’un artiste, c’est qu’il ait des propos éclairants, qu’il m’amène vers des endroits que je n’aurais pas découverts seule, qu’il me fasse voir les choses différemment.
Sans être forcément sympas, certains artistes sont parfois diserts. Vous souvenez-vous avoir interviewé Kevin Shields ?
Carole Boinet : C’était dingue. Il ne voulait pas lâcher son téléphone et je m’étais retrouvée avec plus de 4 heures d’interviews. Et encore, c’est moi qui avais coupé court à la conversation !
La prochaine question est toute trouvée : comment synthétise-t-on 4 heures de propos dans un article de quelques pages maximum ?
Carole Boinet : Mon grand truc – c’est un défaut pour certains journalistes, et une qualité pour d’autres –, c’est de très peu réécrire mes interviews. Je suis le plus fidèle possible aux propos tenus par l’artiste. Ca rejoint peut-être le fait que je recherche de la musicalité dans l’écriture. J’adore quand je peux retrouver la voix de la personne en lisant l’interwiew. Je réécris donc très peu les phrases. Même les tournures de phrases. Certains artistes s’en sont plaints. Je crois que c’était Discodéine qui avait gueulé, car ils trouvaient que le papier les faisait passer pour des gens qui s’expriment mal, tout simplement parce que j’avais très peu retravaillé leurs propos. Garder une forme d’oralité, ça me plaît. Si quelqu’un répète le même type d’adjectif ou le même type d’adverbe, j’aime bien le garder, que le lecteur voit les redondances. Si on réécrit tout, à la fin tout le monde parle pareil. La pensée traduite sera forcément différente, mais la forme sera la même. C’est pour cette raison que j’aime beaucoup la radio, et notamment les interviews à la radio. Les silences, les modulations dans la voix, les accents, la gêne, les pas de côté, la fuite !
« Le meilleur conseil que m’ait donné JD Beauvallet ? N’aies jamais peur des silences. »
Et Kevin Shields, dans tout ça ?
Carole Boinet : Mon but, c’est de garder le maximum de ce qui s’est passé pendant l’interview. Si je garde un paragraphe, je n’enlève jamais de phrases à l’intérieur du paragraphe. Pour ne pas dénaturer le propos. Ce que j’adore aussi faire, c’est garder les rires, les silences, raconter quand quelqu’un pose son téléphone et va chercher une bière. Bref, retranscrire les didascalies de l’interview pour qu’on vive le moment. Sur 4 heures d’interview, c’est évidemment impossible. Ce que je fais souvent, c’est que je conserve le début en l’état. C’est important, le début. Je ne vais pas prendre une question que j’ai posée à la fin et la placer au début de l’interview écrite, mais je sais que certains journalistes le font. Si je le faisais, j’aurais l’impression de trahir ce qui s’est réellement passé. Idem sur le déroulé de l’interview, ce que j’écris correspond souvent au déroulé réel. Pour un lecteur, c’est intéressant de comprendre la conversation, de comprendre comment une discussion s’installe. Ce qui me plaît dans les interviews, ce n’est pas de balancer des questions pour avoir des réponses, mais la conversation, l’échange. Le meilleur conseil que m’ait donné JD Beauvallet était celui-ci : « n’aies jamais peur des silences ». Car l’être humain ayant peur du vide, il cherchera toujours à combler le silence. Or l’objectif est que ce soit l’artiste qui se charge de le combler en exprimant quelque chose d’imprévu…
Quand la retranscription est trop longue, j’entre dans la phase calvaire et mal de ventre. J’enlève des questions, des réponses. Parfois beaucoup, parce qu’on est limité par le calibrage de l’article papier. Tout ça se fait au feeling. J’enlève les redondances, j’enlève ce que l’artiste a dit en dehors des Inrockuptibles. Pour des artistes comme Shields, j’essaye aussi de me projeter dans le lecteur ou la lectrice, et j’enlève ce qui n’intéressera peut-être pas des personnes plus âgées que moi qui l’ont déjà lu cent fois. Aux Inrocks, on ne peut pas parler de Kevin Shields comme si on faisait la première interview d’un artiste émergent alors qu’il a déjà rencontré plusieurs fois le magazine et que certains de nos lecteurs ont 50 ans et sont des fans hardcore de My Bloody.

A propos, qui sont les gens qui constituent le lectorat des Inrocks aujourd’hui ? Vous le savez ou ça reste brouillardeux ?
Carole Boinet : Le lecteur principal, je pense que je sais…Enfin, j’en suis sûre. C’est un mec, hétéro cis comme on dit, blanc, de plus de 40 ans, habitant essentiellement le bassin parisien, CSP+ voire ++. Aha.
Ca vous ennuie d’écrire et de fabriquer un magazine pour ces gens-là ?
Carole Boinet : C’est une question que je me suis beaucoup posée. Surtout quand j’ai accepté le poste. A un moment, je me suis dit « Mais est-ce que tu n’es pas en train de complètement délirer ? ». Premièrement, faire un magazine papier alors que j’avais 35 ans, était-ce bien raisonnable ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de monter ma chaîne Tiktok ? Et deuxièmement, je me disais : « Est-ce que Les Inrocks c’est pas juste un mec que toi même tu ne connais pas trop et qui ne pense pas forcément comme toi ? » et « Est-ce que lui et moi, on a vraiment des choses à nous dire ? ». La réponse est oui, on a bien sûr des choses à se dire. Déjà parce que je n’ai absolument aucun mépris pour ce mec. C’est quelqu’un que j’ai envie de rencontrer et j’ai envie qu’on se parle. Notamment parce qu’on a des goûts en commun, comme le Velvet, les Smiths, les Cure, Patti Smith, Nan Goldin, Sonic Youth, PJ Harvey, Public Enemy, Happy Mondays, Stone Roses, Pulp…Je pense aussi que je peux préserver ce lecteur, tout en ramenant un autre public vers Les Inrocks. Ca ne sera pas forcément un public qui va immédiatement aller acheter le magazine – la jeunesse actuelle ne vas pas se précipiter sur du papier– mais un public qui peut s’abonner en numérique, nous suivre sur Instagram, venir à nos concerts, au festival. Chaque mois, à nos soirées à la Boule Noire, je constate que le public est hyper jeune. C’est aussi un public qui peut venir à des talks qu’on organise, comme celui de Paul B. Preciado que j’ai programmé par le passé à La Gaité Lyrique et qui a fait plus que sold out. En 2019 j’avais organisé un petit événement à Lafayette Anticipations (Paris, 3e), « Les Inrocks revisitent les années 2010 » à base de rencontres et de showcases. Le public était super jeune là aussi. Certainement du fait du lieu qui est très « branché », mais aussi de la programmation où se croisaient Edouard Louis, Vincent Lacoste, (LA) HORDE, Ascendant Vierge, Crystal Murray, Habibitch….
« Nous, on écoute autant New Order que Rosalia ».
Je pense que c’est aussi dans ces interstices que l’on peut toucher un autre type de lectorat. Ce qui me paraît important, et je tiens vraiment à appuyer ce propos, c’est que Les Inrocks, je les vois avant tout comme un espace de dialogue. J’ai envie qu’on se parle dans ce magazine. J’ai envie que Preciado côtoie un article sur New Order, qu’on trouve Joyce Carol Oates à côté de Bret Easton Ellis,…Tout cela n’est pas opposé. Ca dit la complexité du geste artistique, et ça dit le biotope des Inrocks. Nous, on écoute à la fois New Order et Rosalia. Cette diversité traduit bien sûr notre rédaction, mais reflète, je pense, le monde actuel. Je connais plein de mecs blancs hétéro cis de 50 ans qui trouvent – peut-être par leurs enfants – Rosalia assez passionnante d’un point de vue musical, même s’ils ont grandi avec Nick Cave. Les Inrocks doivent s’autoriser ça. Sinon, ce n’est plus Les Inrocks.
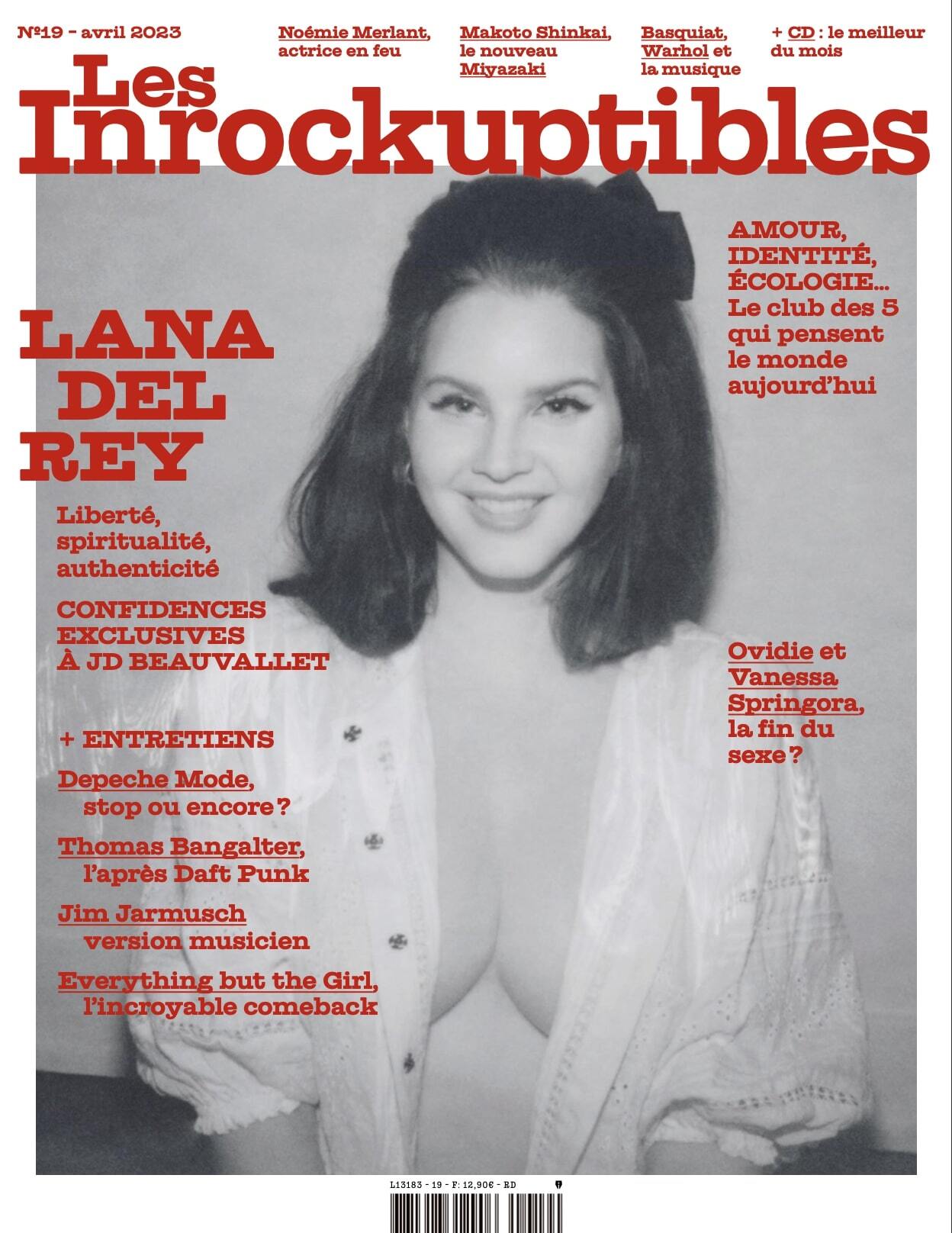
Au-delà du fond, il y a aussi la forme, c’est-à-dire la manière dont le média est véhiculé. Pour faire simple, on assiste à un grand schisme des temps modernes, celui de l’écrit versus la vidéo adoptée par des médias comme Konbini ou Brut, par exemple. Côté Inrocks, vous travaillez beaucoup ce format ? Vous voulez le développer ?
Carole Boinet : Je me suis occupée pendant longtemps du développement vidéo aux Inrocks. Je connais assez bien le sujet. On s’était mis à produire de petits formats, à inventer des rubriques vidéos, des formes. Certaines cartonnaient. C’était drôle et excitant. Le gros souci de la vidéo – et c’est le même pour tout le monde – c’est qu’il n’y a pas de modèle économique. Si tu as une entreprise qui est florissante et qui te permet d’avoir de la marge pour investir à la fois dans la vidéo et travailler sa visibilité, ça peut fonctionner. Ceci dit, ça reste un énorme investissement qu’il va falloir équilibrer. Cela dit, je pense qu’il faut qu’on reprenne le terrain de la vidéo. En tout cas on ne peut pas s’en passer totalement. Il faut qu’on réfléchisse à « Où en faire ? Comment en faire ? Comment proposer des vidéos qui soient différentes de Konbini et Brut ? Etc. ». Mais je ne crois pas du tout au fait de faire des Inrocks un média tout-vidéo, ni même un média où la vidéo serait très importante. Le coeur et la force des Inrocks reste l’écriture, même si elle est un peu dévaluée. Et encore, dévaluée…Oui et non. Regarde, par exemple, Dua Lipa vient de lancer une newsletter. C’est un format qui marche assez bien, la newsletter. Nous en sortons une par jour, thématisée. L’écriture en elle-même n’est pas forcément dévaluée, ce sont plus les pratiques d’écriture qui changent, qui évoluent. Peut-être qu’aujourd’hui, par exemple, il faut poster des textes plus longs sur Instagram, ce que font par exemple Libération, Le Monde, Le New York Times et qu’on se met aussi à faire. Peut-être qu’il faut inventer des storys Instagram avec plus de texte ? Il faudra probablement se développer davantage sur ces plateformes, mais notre force reste l’écriture. Peut-être faut-il aussi investir davantage le champ de la librairie en sortant de beaux livres…
« Même si j’aime bien farfouiller dans les bacs des disquaires, j’achète très peu de disques ».
Cette interview se déroule dans votre bureau, à la rédaction des Inrocks, au milieu des bouquins, des disques. La rédaction reçoit bien sûr encore énormément d’albums physiques, même si il y a de plus en plus de liens, de streaming… A titre personnel, achetez-vous encore des disques ? C’est probablement une question très hétéro machin quadra, mais je me dois forcément de la poser : avez-vous chez vous une collection de disques ?
Carole Boinet : Bonne question. Même si j’aime bien farfouiller dans les bacs des disquaires, j’achète très peu de disques. Il m’arrive quand même parfois d’acheter des vinyles d’occasion, des trucs un peu deep. Ca m’arrive aussi dans des brocantes, mais c’est rare. Depuis que je reçois quasiment toutes les sorties, j’ai complètement perdu ce truc d’acheter les sorties actuelles. Et puis j’ai grandi avec internet… j’ai pris le pli d’écouter des mp3, du streaming, du Bandcamp, du Soundcloud…
Quand on est à la tête d’un magazine, comment gère-t-on son temps ? Avez-vous ressenti un grand changement entre le positionnement de journaliste et celui de directrice de la rédaction ? Ce changement de situation a-t-il été facile vis-à-vis des collègues de la rédaction ?
Carole Boinet : Je rebondis sur cette dernière question : non, ça n’est jamais facile ! Ceci dit, j’ai eu de la chance que ça soit très bien pris. Je ne vais pas vous le cacher, je stressais un peu. Je me suis dit : « Peut-être qu’ils ne vont pas être d’accord ? Peut-être que ça va mal se passer ? ». Il ne faut pas oublier qu’il y a des membres actuels de la rédaction qui m’ont vu en stage ici, donc ça pourrait être un peu bizarre. Mais cela se passe hyper bien. En tout cas pour l’instant, je touche du bois. Déjà parce qu’on se connaît bien. Il savent que je suis très franche, et plutôt cash. A tort ou à raison, je ne sais pas, mais je suis comme ça. Je suis sûrement parfois trop cash, mais je suis dans le dialogue. Pour avancer, je préfère qu’on se dise les choses et qu’on se parle ouvertement. Je ne suis en tout cas pas la directrice enfermée dans son bureau, qui ne parle à personne, qui gère son truc dans son coin et qui donne des ordres. Le but, c’est que Les Inrocks soient avant tout un projet, une entreprise collective. Même si c’est moi qui ait le final cut et qui prend la responsabilité des écrits et de tout ce qu’on fait, je préfère qu’un enthousiasme collectif porte chaque numéro, chaque soirée, chaque festival. Sinon j’aurais crée Carole Boinet Magazine.
Les Inrocks, ce n’est pas mon magazine. Ils ont existé avant moi et ils existeront sûrement après moi. A un moment, il se trouve que je prends la tête du truc, mais une tête de coordination, d’équilibre intérieur, de « Qui met-on en couv’ ? », de développement, de création d’évènements… J’ai aussi été nommé pour ça, parce que j’ai 35 ans, que j’ai la pêche, que je suis dynamique, que j’y crois. J’ai encore en moi cette illusion d’enfant qui croit que tout est possible, que tout est formidable, et c’est un moteur.
On en arrive au mot de la fin.
Carole Boinet : C’était une vraie psychanalyse cet interview, aha !
Photos : Astrid Karoual









13 commentaires
achete T disques !! tu veux une playlist ?
La Boule Noire c’est dans le 18è FYI
Merci Laulau White.
Il y aura un volume 3 ? Je viens de terminer le 2
oy 64!
les gosses sucent la matraque rue amelot 11°
On savait que les Inrocks n’étaient pas des punks mais là si on avait des doutes.. ..
La musique dans ce canard a de moins en moins droit au chapitre.
L’appropriation de la bourgeoisie continue en nous proposant cette gélatine tiède qu’elle appelle la « culture ».
Beurkkk
brule d voitures au son de 72 seasons
jai d enregistrements de casseroles en edits-
le média subventionné n’a pas dit son dernier lol
Cette dame n’achète pas de disques… Bon
Elle ne nous vend pas grand chose non plus, en tout cas rien d’excitant.
Il y a plus de gens qui vivent grâce à la culture que ceux qui l’a crée réellement et qui vivent dans la mouise.
Parasite?
« J’ai aussi été nommé pour ça, parce que j’ai 35 ans, que j’ai la pêche, que je suis dynamique, »
Macron sort de ce corps !!!
on s’en branle des inrocks ils sont mort pour moi des 1995 au passage a l hebdo (ARRETE DE FAIRE DU CORPORATISME ,PENSE PLUTOT A FAIRE TON JOB AVEC DEONTOLOGIE ET PLURALITE)