Qui a eu l’idée de cette énorme compilation ?
Thomas Blondeau : C’est l’agence Supernova qui a supervisé le projet, le producteur étant Universal et le distributeur exclusif la Fnac. On ne m’ont pas dit « Tu vas prendre 15 hits de rap pour en faire un CD », ce que tout le monde peut faire, mais plutôt quelque chose en trois, voire quatre volumes. Là, je me suis dit qu’il y avait moyen de raconter une vraie histoire. Et je pèse mes mots, car il s’agit de l’histoire d’un genre musical qui a peu ou prou 35 ans. Une fois mis en place sa batterie de thèmes, son discours, ses techniques de production, son solfège, son esthétique et son balancement rythmique, il n’a plus cessé de muter, à cause de paramètres sociaux, éthiques, économiques, techniques et juridiques. C’est comme ça que l’on est passé d’une sorte de funk à une musique quasi électronique, séparée en plein d’écoles, de sous-genres comme le rock à son époque. C’est pourquoi j’ai voulu raconter cette histoire, aussi bien à travers la tracklist que les notes de pochettes que j’ai rédigées, qui raconte aussi celle des Etats-Unis. Les rappeurs ne parlent pas de la même chose, ni de la même manière, dans les années 80 sous Reagan qu’aujourd’hui sous Obama.
Concrètement, comment parvient-on à réunir autant de titres ?
T.B. : Avec Jérôme Arondel, qui a travaillé pour la Fnac sur le projet, on a demandé 250 ou 300 titres à Universal. Le label s’est occupé de ce qu’on appelle la « clearance », c’est-à-dire obtenir les autorisations. Il y avait des titres qui leur appartenaient déjà, mais aussi d’autres provenant de chez tous leurs concurrents, comme Warner ou Sony, ainsi que des titres de labels indépendants dont on avait perdu la trace des ayants droit. Donc c’était très compliqué, mais Universal a été particulièrement efficace et a réussi à « clearé » tous les morceaux en deux mois. Il y a des labels sur lesquels on a obtenu tout ce qu’on voulait, même plus, et d’autres qui ne nous ont rien accordé. Après, il a fallu faire une sélection. Par exemple, pour N.W.A., on a obtenu six titres, mais ça n’avait pas de sens de tous les faire figurer. On a refait une sélection pour en garder finalement deux. Au final, une fois dressée la liste définitive des titres utilisables, il me restait trois semaines pour écrire l’intégralité des notices de pochettes… Elles sont selon moi super importantes, car au-delà de ce qu’on entend, elles permettent d’expliquer pourquoi le rap a pris ce chemin, esthétiquement parlant.
Aujourd’hui, les rappeurs ont « pris le pouvoir » et sont donc à l’image d’un mainstream international qui n’a jamais prétendu faire la révolution.
La collection n’oublie pas les hits…
T.B. : Oui, et c’est très important puisqu’ils sont parfois signés par des producteurs qui ont aujourd’hui un poids énorme sur la pop internationale comme les Neptunes, Timbaland, Dr. Dre, Jay Z, soit ceux qui produisent Britney Spears, Daft Punk, Katy Perry, Madonna ou Björk. Donc je n’ai aucun problème avec les hits, même si dans le rap il y a encore ce débat entre le commercial et l’underground. La rap a fait une OPA sur le mainstream international, on ne peut pas passer à côté si on parle de l’histoire de ce genre. En revanche, cette tracklist propose des morceaux bien moins connus mais qui ont pesé de manière durable et esthétique sur le genre. D’ailleurs, les querelles sur le mainstream et l’underground ont lieu au sein des communautés de fans, beaucoup plus qu’entre les artistes eux-mêmes.
La période « Golden Years » a droit à deux volumes, qui vont de 1989 à 1992 et de 1993 à 1997…
T.B. : C’est la période ou le rap s’est considérablement éloigné du funk, a formulé son catéchisme musical, a mis en place des techniques de production spécifiques, et atteint un certain succès commercial. Il faut préciser l’importance de la technique. Au début, les rappeurs ont utilisé des machines qui n’étaient pas faites pour eux, comme la SP-12 destinée à l’origine aux musiciens lambda de studio et qui a fait le son du rap des années 1990. Très spartiate, elle possédait deux défauts majeurs : une faible résolution sonore et une mémoire minuscule. Les premiers producteurs de rap s’en sont emparés car c’était plus simple que d’utiliser des platines pour enchaîner les breakbeats. Les défaillances de cette machine ont conduit des producteurs comme Ced-Gee, Paul C et Marley Marl à ruser. Au lieu de sampler une mesure de funk à 90 BPM qui remplissait toute la mémoire, soit 2,5 secondes de son maximum, ils ont passé les vinyles en 45 tours pour les accélérer et donc utiliser moins de mémoire. La faible définition sonore de la machine fait qu’une fois le sample ralenti à son tempo d’origine, on perd du grain, on obtient un son sale, rocailleux, un peu dégueu, qui va devenir l’archétype de cette époque-là. Une autre technique consistait à sampler chaque élément d’un rythme – caisse claire, charley et grosse caisse – pour les recomposer dans la boite à rythme. On garde le son d’une batterie live avec un balancement nouveau car issu d’une machine. Le rap de cette époque, c’est comme du funk qui se tord, s’étrangle, devient plus raide. Avec ça, arrivent les hits. Les mecs deviennent célèbres. Le rap devient un marché, du coup les fabricants de matériel commencent à produire pour lui et inventer des machines, comme la MPC d’Akai qui possédait un disque dur gigantesque, une batterie d’effets et une définition sonore haut de gamme. Tout le monde s’est jeté dessus et ça a modifié encore une fois le balancement et la formulation du son.
Can I Kick It, la plus célèbre chanson de A Tribe Called Quest, utilise un sample de Walk On The Wild Side. […] Les crédits ont été entièrement accordés à Lou Reed et 100 % de l’argent généré est allé dans sa poche.
Il y a aussi les aspects juridiques qui ont changé la donne.
T.B. : Le rap s’est fondé en samplant les disques d’autres artistes. Sauf que le problème, c’est qu’il fait payer des droits aux producteurs et à l’éditeur. Au début, les rappeurs n’en avaient rien à foutre. Mais quand le rap a commencé à faire beaucoup d’argent, les procès sont arrivés et ont coûté des millions à des tas de groupes. Par exemple, Can I Kick It, la plus célèbre chanson de A Tribe Called Quest, utilise un sample de Walk On The Wild Side. A l’issu d’un procès, les crédits ont été entièrement accordés à Lou Reed et 100 % de l’argent généré est allé dans sa poche. Le groupe n’a jamais touché un centime. Il faisait ça dans sa cave, il n’était pas connu, il s’en foutait des questions juridiques. Ces procès des années 90 ont rendu la production de rap extrêmement coûteuse. Coup de bol, la technique a encore changé la donne. Les progrès de la microélectronique ont permis de produire avec des home studios et de créer ses propres mélodies en évitant les samples.
« Hip Hop Basics » permet de toucher du doigt le passage d’un rap festif, parfois naïf à ses débuts, à un style plus agressif et revendicatif dans les années 90, et qui, finalement, est revenu aujourd’hui à son point de départ, à savoir l’entertainment le plus total.
T.B. : Il faut comprendre qu’à la base, le rap était une musique dans laquelle le MC était là pour se vanter de rapper le mieux, de faire la meilleure fête, d’avoir le meilleur producteur, le meilleur DJ, le meilleur son et donc la meilleure musique. Sauf que le dénuement absolu dans lequel se sont retrouvés les ghettos des années 80 a fait que les mecs se sont mis aussi à raconter leur vie, comme Grandmaster Flash dans The Message, une cassure absolue. Au lieu de dire « allez on monte sur les tables, on lève les bras bien haut », il a dit « j’habite dans une cité pourrie où on vend du crack et on pisse dans les escaliers ». Pareil pour Public Enemy avec 911 Is A Joke, où il est dit que l’appel d’urgence, le 911, ne sert à rien quand tu habites la zone. Les services d’assistance publique ne viendront jamais à ton secours, tu ne peux compter que sur toi, ta famille et tes amis. Ces artistes ont tellement marqué le mouvement de cette colère et fait si peur à l’Amérique qu’on a retenu que ça.
Pourtant, le rap reste une grande fête, même sur les albums de Gang Starr qui tapait parfois sur le pouvoir, Guru passait quand même beaucoup de temps à rapper sur son ego de MC. Aujourd’hui, les rappeurs ont « pris le pouvoir » et sont donc à l’image d’un mainstream international qui n’a jamais prétendu faire la révolution. Ces mecs sont nés sans rien au pays du dollar roi, ils sont là pour faire de l’argent, pas se planquer dans le maquis avec des Kalachnikov. La fracture s’est opérée entre les New-Yorkais, qu’on appelait les « teachers » et qui voulaient engager la communauté noire à s’élever par la fraternité, la culture et la conscience, et ceux de Los Angeles qui se sont levés pour dire « nique sa mère la fraternité, on va défricher le pays avec nos flingues, faire de l’argent et baiser des putes ». Cette OPA agressive sur l’esthétique du rap a fait qu’à la fin des années 90, il n’y avait pas un album, même à New York, qui ne contenait pas son morceau gangsta rap.
Dans « Hip Hop Basics », quels sont tes titres préférés, toutes périodes confondues ?
T.B. : Il y a Chief Rocka, de Lords Of The Underground, un groupe du New Jersey qui, en termes de production, représente exactement ce son rocailleux et dégueulasse produit à la SP-12, avec un BPM assez rapide, très représentatif de l’éthique des B-boy du début des 90’s. Une époque où le fait d’être rappeur n’était pas encore un métier. Je retiens ensuite Nuthin‘ but a ‘G‘ Thang de Snoop Dogg et Dr. Dre, venus de Los Angeles et qui rompent avec l’esthétique de New York, le berceau du rap. Ce sont les prémisses du G-funk et du gangsta rap, soit un funk lent, généreux, très chargé en basses, plein de synthés analogiques, qui puise dans le style extravagant de Rick James, George Clinton, Bootsy Collins ou Zapp. Je dirais ensuite Get Ur Freak On de Missy Elliott, parce que c’est produit par Timbaland qui est représentatif d’une époque où on utilisait presque plus de samples grâce à un nouveau matériel simple d’utilisation. Et puis, Missy Elliott, c’est l’une des premières filles à parler des garçons comme les garçons parlaient des filles. D’ailleurs, aucun mec n’a jamais osé l’insulter ni la clasher sous peine de se faire déchirer. Ensuite, il y a les productions des Neptunes, comme Super Thug de Noreaga, dans les années 2000 et enfin le Canadien Drake, pour la période actuelle, avec Started From The Bottom. C’est la première fois qu’on peut faire la fête sur des chansons tristes. L’armure se fissure. C’est nouveau.
https://youtu.be/WC-Cn7L-rec
Quels sont pour toi les titres jalons de cette collection, ceux qui ont fait basculer le genre ?
T.B. : D’abord The Message de Grandmaster Flash, qui commence à parler du ghetto et développer une conscience sociale. Puis Rebel Without A Pause, de Public Enemy, parce que c’est produit par le Bomb Squad qui a révolutionné les techniques de production en ajoutant des sons de boîtes à rythme sur des grosses caisses et des caisses claires piochées sur d’autres disques. Ce qui a donné une pression sonore inédite. Il y a ensuite Dr. Dre qui a demandé à des musiciens de rejouer les samples en studio au lieu d’utiliser ceux prélevés sur disques. Ce qui permettait de ne pas payer les droits d’édition. Il a aussi bouleversé la textualité du rap car après lui, tous les rappeurs se sont sentis obligés de faire au moins un titre gangsta sur leurs albums. Je citerai aussi un titre de Jay Z, n’importe lequel, car c’est à travers lui que le rap a pris le pouvoir sur l’industrie. Et enfin, je citerai les mecs du sud, comme Future ou Young Thug, qui mélangent aussi le rock et le R’n’B avec un diction particulière et un auto-tune très discret.
Dr. Dre et Eminem ne sont pas compilables.
Selon le principe du « clearance », il y a des titres qui n’ont pas pu figurer dans la compilation…
T.B. : Oui, Dr. Dre et Eminem ne sont pas compilables tout simplement parce qu’ils se réservent l’exclusivité de l’exploitation de leurs titres. C’est pourquoi il n’y a pas dans « Hip Hop Basics » de titres du premier album de Dre, par exemple. Il a donc fallu passer par des biais détournés. Avec Eminem ou Snoop Dogg, on a pris des titres où ils sont en featuring pour des rappeurs signés sur d’autres maisons d’édition. Pour Dre, il figure dans la compilation à travers les morceaux de N.W.A. Donc on a ces mecs-là, mais pas forcément leurs plus beaux faits d’armes, il faut le reconnaître.
Tu aimerais faire la même chose avec le rap français ?
T.B. : C’est totalement envisageable. Il y a une évolution relativement similaire, sauf qu’elle a démarré plus tard. Il y a un underground, des balbutiements au début des années 80, une prise de conscience, l’utilisation des mêmes machines pour se battre à armes égales avec les Américains malgré un fort complexe, et un écho à l’histoire de la société française. D’ailleurs, la critique de la société, au début du rap chez nous, était encore une pale copie des propos tenus par les Américains. Elle a depuis atteint sa maturité pour devenir, selon moi, plus virulente encore qu’outre-Atlantique.
Compilations Hip Hop Basics // Universal (dispo en CD et vinyle)

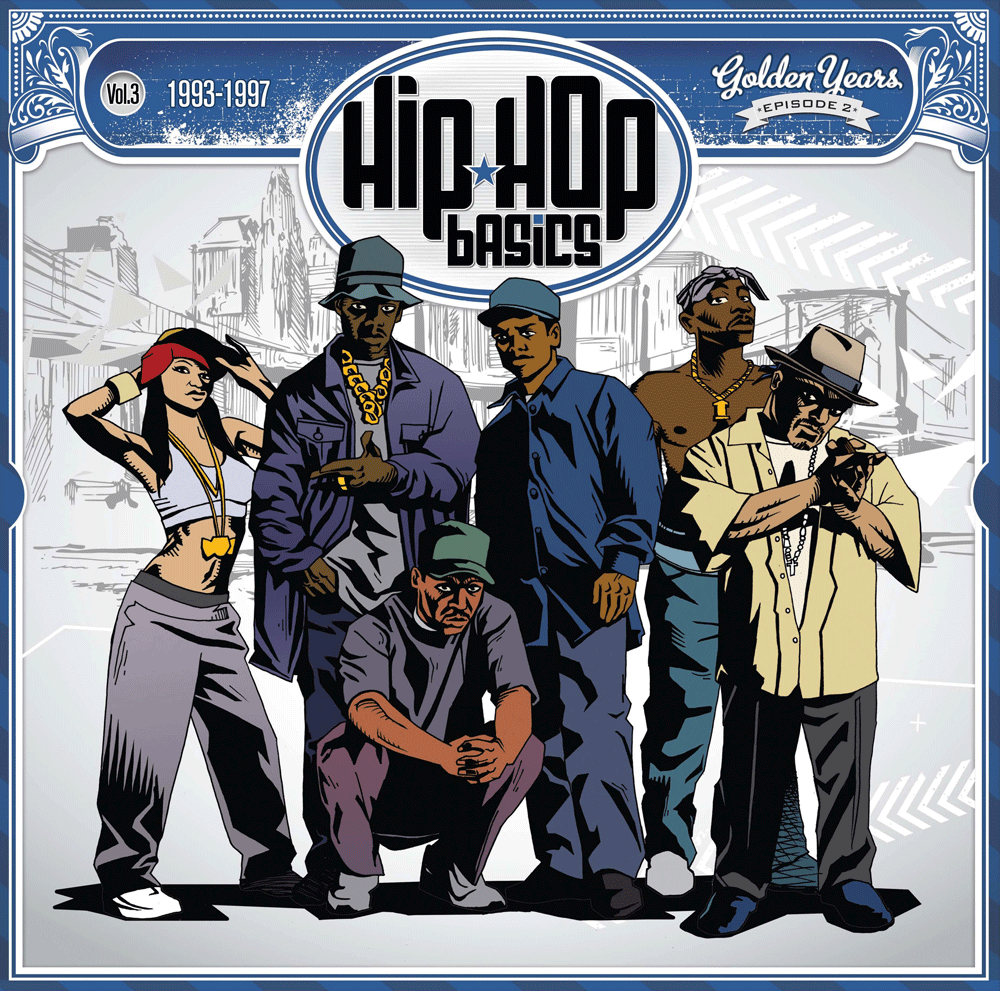








5 commentaires
Vraiment dommage que les pochettes soient aussi caricaturales, ça fait vraiment « le rap pour les nuls »..
Petite rectification : quand Dr Dre fait rejouer les basses, les claviers et les guitares des groupes de funk pour éviter de les sampler, c’est pour éviter de payer les droits de reproduction mécanique – c’est à dire le droit d’utiliser le master financé par un producteur, un label – et non les droits d’éditions. Il ne paye, justement, que les droits d’édition. Je me suis sans peut-être mal exprimé.
C’est quoi une pochette de compilation de rap pas caricaturale ?
Une photo de manchots sur fond de banquise ?
Fail : http://willkrause.com/wp-content/gallery/sesame-hip-hop-penguins/album-cover-1f-final.jpg
Non franchement niveau packaging c’est vraiment pas convaincant. La pochette est pas ouvrante, les visuels, même s’ils représentent les différentes époques font assez « gamin », »caricatural » comme dis plus haut, le spot est pas génial non plus. (l’illustration du Vol°3 passe pas mal par contre). Mais bon au final le plus important c’est le son donc c’est quand même de très bons disques.