Bruce Springsteen n’a certes pas le même rapport à son public que AC/DC, Leonard Cohen ou Justin Bieber. Imagine-t-on un fan d’Angus Young normalement constitué (il y en a) s’enquiller cinq concerts d’une même tournée? Non, ne serait-ce que parce que la setlist de son groupe ne varie pas d’un iota pendant un an. Imagine-t-on un auditeur du poète zen se sentir « like the backbone of Québec », à l’image de cette jeune et jolie camionneuse américaine parlant dans Springsteen and I de ce qu’elle ressent lorsqu’elle écoute « Nebraska » pendant le boulot ? Non plus.
 Les années passent et en dépit de deux trois mauvais disques, elles n’ont pas altéré la crédibilité de Springsteen aux yeux de son public (qui s’élargit à chaque tournée). Eux ont grandi et vieilli avec leur idole de jeunesse quand, dans le même temps, il ne ressortent leurs disques des Ramones [1] ou de Lou Reed [2] que motivés par la nostalgie.
Les années passent et en dépit de deux trois mauvais disques, elles n’ont pas altéré la crédibilité de Springsteen aux yeux de son public (qui s’élargit à chaque tournée). Eux ont grandi et vieilli avec leur idole de jeunesse quand, dans le même temps, il ne ressortent leurs disques des Ramones [1] ou de Lou Reed [2] que motivés par la nostalgie.
C’est qu’après avoir, comme tous les rockers, chanté leurs émois adolescents (She’s the one), le boss a également chanté leurs baises de jeunes adultes après le boulot (Because the night), leurs illusions conjugales (I wanna marry you) et leurs désillusions conjugales (Brilliant disguise, chef-d’œuvre méconnu). Et je ne m’en tiens qu’aux chansons d’amour; je ne parle pas de toutes les pépites que notre homme a enregistrées sur les guerres de gangs, l’accès à la propriété, la vie à l’usine, les conflits avec le père ou le retour du Viêt Nam. Car ce n’est pas mon propos que d’analyser le corpus composé par les quelques 300 chansons écrites par Springsteen. Ce que je veux montrer, c’est qu’il est peut-être le seul rocker à avoir mûri avec son public. Ce public qui, grâce à ce formidable passeur aura pu découvrir le rock de Buddy Holly, le folk de Woody Guthrie, la soul de Wilson Pickett, les films de John Ford, les livres de Howard Zinn. Tout à la fois objet de séduction, incarnation d’une Amérique mythifiée et modèle d’intégrité humaniste, le phénomène Springsteen a sans doute plus à voir avec Gary Cooper qu’avec David Bowie [3].
« La relation entre Springsteen et ses fans » était donc un sujet de film tout à fait valable.
A priori, il y avait la matière pour faire autre chose que de l’exhibitionnisme neuneu façon Fan de. Las ! Springsteen and I s’avère l’entreprise la plus hallucinante d’opportunisme mercantile jamais montée par l’industrie culturelle (en l’occurrence, Ridley Scott Associates). En envoyant leurs employés aux quatre coins de l’Internet pour demander aux fans de s’autofilmer, les commanditaires ont eu une idée géniale : réduire les coûts de production à néant pour ensuite se gaver sur le dos de ces mêmes fans : investissement minimal, plus-value maximale. A l’exception de l’épilogue sur lequel nous reviendrons, Springsteen and I se réduit à une collection de témoignages enregistrés sur smartphone entrecoupée de vidéos de concert récupérées sur Youtube. Il va de soi que la projection en Imax ne fait que grossir les défauts d’une image généralement dégueulasse.
La plupart des images de concert, le fan les a d’ailleurs déjà vues puisqu’il est assez grand pour se connecter à Youtube tout seul. A part celui de la camionneuse déjà évoquée et celui d’un homme qui se met à pleurer lorsqu’il évoque la musique de Bruce (images désolantes d’impudeur), les témoignages se réduisent à des anecdotes au mieux attendrissantes au pire embarrassantes. Plusieurs de ces anecdotes sont déjà connues des fans car elles ont contribué à forger la légende Bruce, la rock-star amie du populo. Et l’intérêt du film est alors de révéler le contre-champ de ces morceaux de bravoure de la mythologie springsteenienne. Ainsi, on verra le musicien des rues de Copenhague revenir, vingt-cinq ans après les faits, sur sa rencontre avec le boss. Le fan sera rassuré de constater que ce jam avec un clochard n’était pas bidonné: contrairement à son pote Obama lorsqu’il sort chez Five Guys, Springtseen n’était visiblement pas au courant de la présence d’une caméra. Mais on le voit, les fans de Bruce parlent aux fans de Bruce. Il n’y a aucune mise en perspective des témoignages qui sont alors exposés avec la complaisance exhibitionniste propre à la télé-réalité.
Les producteurs ont tout compris à l’état d’une société qui a désormais plus à voir avec le narcissisme qu’avec le spectacle. Immanquablement, le fan qui va voir Springsteen and I va s’identifier au fan dans le film qui réalise son rêve en serrant la pince du boss. Mais quelle idée mesquine et étroite du cinéma cela sous-tend ! Alors que la grandeur de Springsteen – le plus cinématographique des songwriters – réside justement dans sa faculté de rendre universelles ses histoires de prolos du New-Jersey. Alors que l’occasion était donnée de faire comprendre le talent de Springsteen – artiste célèbre mais victime de malentendus de toutes sortes – à des non-convertis. Eh bien non ! A l’instar d’un vulgaire film indépendant de Sundance, Springsteen and I repose uniquement sur la connivence et l’entre-soi. D’où ce concept marketing fumeux des projections « événementielles » en lieu et place d’une sortie en salles en bonne et due forme qui certes aurait nécessité de s’adresser à un public plus large que celui déjà acquis au chantre d’Asbury Park.
Alors, n’y a-t-il vraiment rien à tirer de ce Springsteen and I ?
Je dirais qu’il mérite quand même le déplacement pour les trente minutes filmées au concert de Londres en 2012. Projetées après le générique, ce sont les seules images « pro-shot » du film. Comme si au dernier moment, la production avait eu des scrupules quant à son foutage de gueule et avait décidé de jeter un peu de la pâture attendue au cochon de payant. L’ouverture où la star chante Thunder Road, accompagnée seulement par le majestueux piano de Roy Bittan, est véritablement grandiose. Son charisme, décuplé par l’Imax, est terrassant. Pourquoi alors ne pas avoir proposé un spectacle en entier? Les fans, avant tout désireux de prolonger l’ivresse de la tournée estivale, s’y seraient rués pareillement. Les autres, attirés par une presse de toute façon enthousiaste, se seraient peut-être laissés tenter ne serait-ce que pour pouvoir vérifier la réputation de « bête de scène » du bonhomme à peu de frais; une projection étant nettement moins chère et nettement plus pratique qu’un concert. Après tout, le meilleur instrument de conversion à la religion springsteenienne reste le fabuleux Live à New York City filmé par HBO. En revanche, pour ce qui est de retranscrire «la relation entre Springsteen et ses fans », l’écriture – et plus particulièrement l’écriture critique – reste à ce jour le medium le plus approprié. Reportez-vous par exemple au texte de Laurent Chalumeau paru dans le hors-série de Rolling Stone.
Ridley Scott // Springsteen and I // Sony







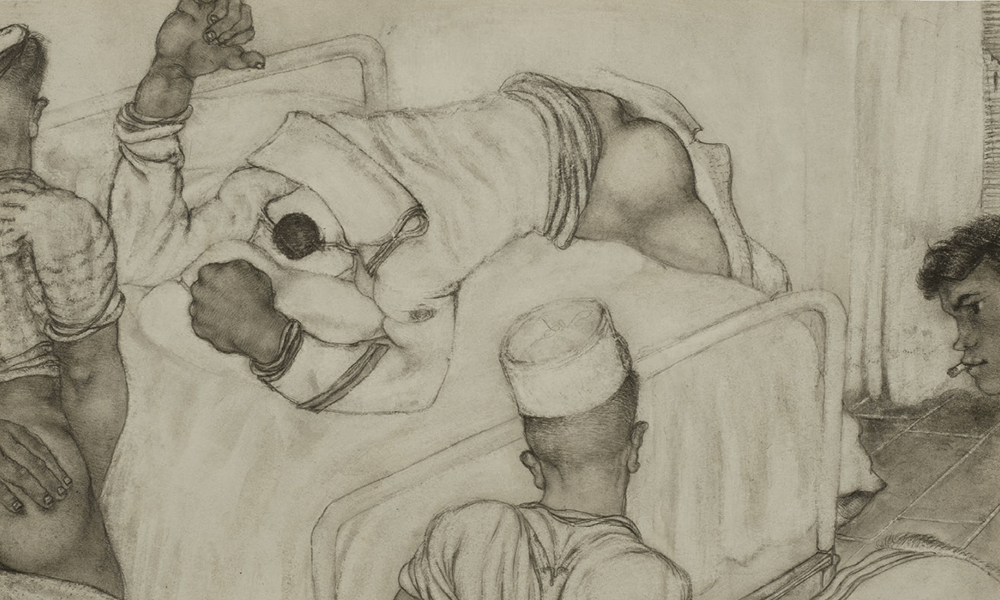
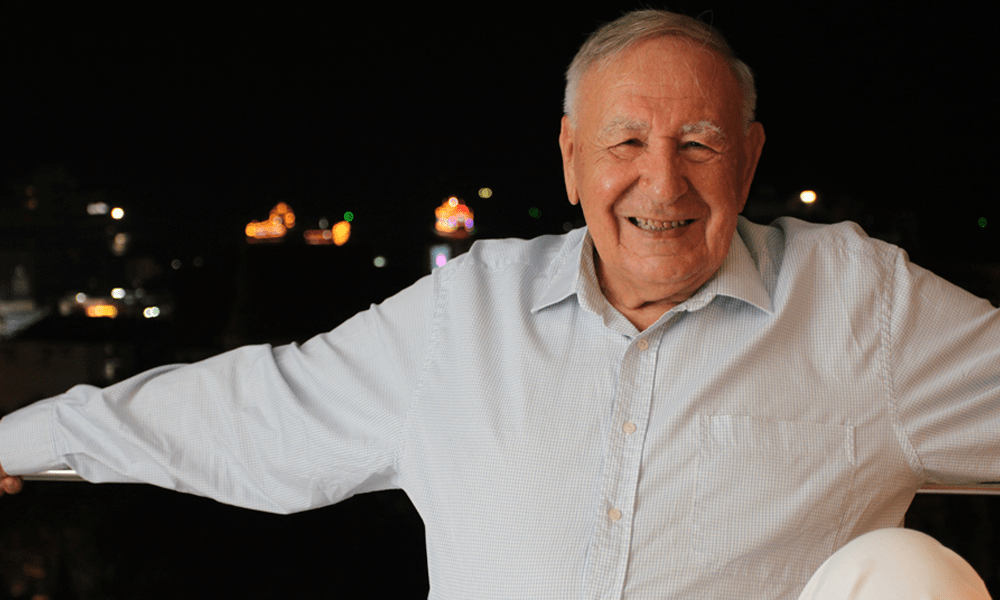
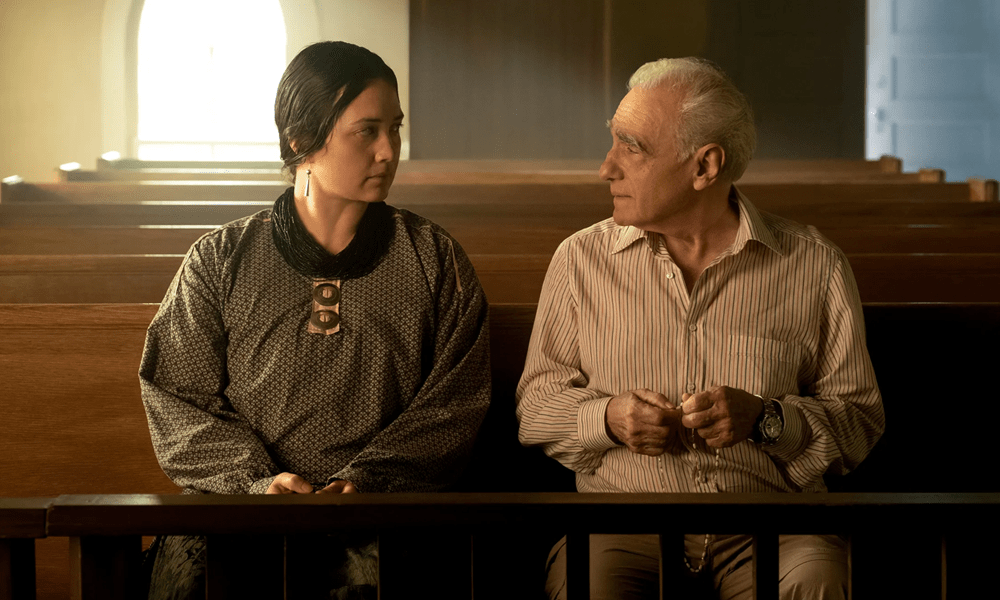
1 commentaire
Il va de soi que je suis tout à fait d’accord avec ce que tu écris sur le Boss, mais j’arrive à un avis tout à fait opposé sur ce film avec pourtant la même base de départ. Sur le fond, la seule question d’où découle le reste, c’est : est-ce que c’était une bonne idée de faire un film sur le rapport entre Springsteen et ses fans ?
Nous divergeons sur la méthode. si je te comprends bien, tu aurais aimé un film fait un metteur en scène, avec un point de vue unique et ce qui en découle. Je pense que cette idée d’un film collectif, multipliant les points de vue et les expériences, est riche en même temps qu’assez originale. Par rapport à la production, je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations, mais les règles étaient claires pour ceux qui ont participé et je fais confiance au côté procédurier des anglo-saxons pour évacuer l’accusation de mercantilisme. S’il est vrai que la qualité technique de ce qui est montré est très inégale, c’est inhérent au projet, mais je ne pense pas que tout ait été fait à l’iphone. Il y a des images et des cadrages qui sont intéressants (la fille du camion, la femme du Danemark). Sur le registre émotionnel, la frontière entre l’exhibitionnisme et l’expression sincère est ténue, mais quelle différence avec un metteur en scène qui serait allé faire les entretiens ? Je ne suis pas sûr qu’il n’aurait pas gardé cette belle scène du gars en voiture qui se met à pleurer tellement il est envahi de son émotion propre quand il parle de ce que les chansons de Springsteen représentent pour lui. Ce qui compte me semble-t’il, c’est la vérité de ces émotions et ce que j’ai vu me paraît sincère.
Je me suis posé la question d’un « contre-champ ». Le film est tout à la gloire du Boss. Précisons que celui-ci n’a vu le film que terminé et donc j’imagine qu’il n’a pas influencé le résultat final (ou alors, je serais déçu). Je serais curieux de savoir s’ils ont reçu des témoignages négatifs. On peut imaginer qu’un réalisateur aurait pu chercher de tels témoignages et faire parler Robert Crumb. Mais ça serait un autre film.
Le film est donc de fans. Oui, mais de ceux qui s’investissent d’une manière que ni moi, ni toi je suppose, ne font. Je ne vient pas avec des pancartes, je ne cherche pas à être au premier rang (j’ai même renoncé au dernier concert parce que c’était dans un stade), je n’ai pas eu l’idée de participer à ce projet, je n’aborderais sans doute pas Bruce si je le croisais dans la rue. J’ai d’autres manies… Donc oui, j’ai aimé voir ces contre-champs dont tu parles et que l’on ne connaissait pas. Jusqu’ici, les films montraient le point de vue de la scène et, rarement, les visages des milliers d’anonymes comme nous. C’est la première fois que l’on passe de l’autre côté et rien que ça me paraît passionnant. A la limite, je me serais passé des extraits de concerts qui n’apportent rien au fond du film. Encore moins le morceau bonus, qui ne fait pas partie du film, et qui est lui aussi sur Internet. Qu’est-ce qui n’y est pas ? Le véritable bonus, c’est ce petit morceau qui raconte, dans le DVD, la rencontrer de cinq des apprentis réalisateurs avec le boss à l’issue d’un concert à Copenhague.
Je suis d’accord quand tu écris que ce n’est pas avec « Springsteen and I » qu’il faille faire découvrir le boss, encore moins sa musique, à un novice. Mais ce film est une pièce, parmi tant d’autres, comme les bouquins ou l’article de Chalumeau, pour rendre compte de ce qu’il est, de ce qu’il fait et de ce qu’il représente. De ce dernier point de vue, je trouve la film réussi.
Je ne sais pas ce que ça vaut en Imax, moi je l’ai vu dans l’intimité de mon salon, et j’y ai vu comme un grand film de famille, chaleureux, émouvant, springsteenien.