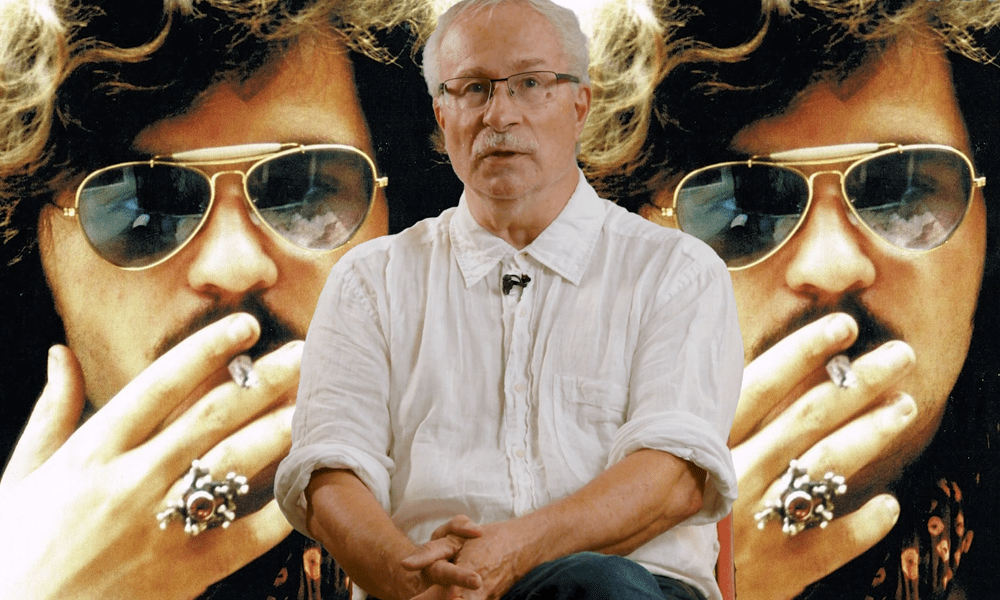Depuis que j’ai fermé mon Facebook, je rate un tas de concert, je ne comprends plus la moitié des conversations entre mes amis, et pire, je ne connais plus la valeur des choses. Voyez-vous, j’ignorai que nombre de mes connaissances pouvaient déclencher 150 commentaires en écrivant un rien. Je ne connaissais pas plus ces mœurs qui consistent à souligner sa ressemblance avec des violeurs expérimentés. Je baignais dans l’ignorance la plus grasse. Puis, on m’a ouvert les yeux, remis dans la matrice, montré ce que je loupais. Et qu’ai-je vu ? Un monde merveilleux où les gens passent leur temps à se sucer la bite. Pour ça, ça y va : chacun pompe, les joues débordantes de salive, à s’en faire péter le buccinateur. Même dans l’agression, ça prend des formes, des pincettes, on discutaille le bout de gras et ça fait rien avancer sinon les aiguilles sur l’horloge, celle qui nous amène inévitablement à la mort, au silence et au vide. En attendant, toutes ces bonnes personnes remplissent l’espace, les sous-sols, l’air et la stratosphère, de vacarme. Du bruit, du bien divertissant, du qui tient chaud et nous rapproche, tous, collés comme nous sommes les uns aux autres, satisfaits et aveugles. En voyant tout ce bruit sur cette fenêtre qui monopolise notre attention, ce monde sans matière, la mort en somme, qu’est l’internet ; cela me rappela qu’à une époque, les rock-critic mouraient de faim. Et, par ailleurs, quand le dernier d’entre eux est mort, il y a bien longtemps maintenant, en même temps que le dernier écrivain, le dernier musicien, ou le dernier peintre, personne ne vint le remplacer.
Le rock-critic d’aujourd’hui est le chroniqueur permanent de ses fantasmes.
Comme le chroniqueur napoléonien, ce plumitif fébrile s’approprie la vie et la mort de ses tiers pour vous bourrer le mou. Le summum du délicat pour cet être étant, évidemment, l’écriture des évangiles, ce qui suggère qu’il a connu le grand dahu en personne et que ce dernier l’a missionné, tout spécialement, pour tout révéler de sa nature divine, son martyr et sa résurrection. D’où l’éternel retour, dans ce répertoire, du motif classique, mort du rock.
Dans les dernières morts du rock en date, j’ai lu avec attention celle de Romain Flon. Au fond, comment ne pas être d’accord avec ce qui y est dit, si simplement ? Cela ne se discuterait même pas si… Si le choix des groupes cités pour représenter l’époque ne se cantonnait pas justement à l’esthétique ayant enterré ce que notre ami pleure. Mais qu’importe. Ce que cette prose nous apprend est plus gros que la fin de la guitare : c’est la source même de la mort de toute chose. Au fond, le problème, fondamental, qui explique « la mort du rock », mais aussi la disparition des auteurs, des musiciens, de la réalité, ce que vous voulez, réside simplement dans le fait que chacun passe sa vie à se faire passer pour un autre. Vous comprenez ? La mascarade du tous face à tous, celle qui passe par une invention perpétuelle de soi, et des milliers d’activités par lesquelles on se définit. Au fond, personne n’ose avouer que nous ne sommes plus que des employés de bureau ayant pour seul rêve l’adolescence éternelle. Nous sommes à peine des êtres humains. Plus que des grades, des salaires annuels, des marques de pompes, des restos branchés, un nombre d’amis sur Facebook, une collection de 3000 vinyles, un prix au mètre carré, un sticker Le Fooding, une note sur Airbnb… Nous sommes des rognures d’être humain, la version sans relief d’une veille espèce, l’annonce de la fin d’une aventure qui fut souvent cruelle, mais pourtant gigantesque. Vous comprenez ? Quand chacun refuse de se comporter comme son âge l’exigerait, quand on sacralise notre personne, que l’on pense s’être fait seul, quand le bien est toujours de notre côté, quand l’on ne veut plus quitter l’euphorie, passer un jour sobre, croiser le regard d’un tiers, voir qu’il faut des fantasmes toujours plus radicaux pour faire naître le désir… On trace le point final. À ce prix-là, ne nous arrêtons plus : ce n’est pas le rock qu’il faut regretter, mais tout le reste. L’esprit par exemple, qui se contente désormais de créer des milliers de mini tendances parasites au lieu de produire une analyse complète. Ou le sexe, qui est devenu impossible depuis que chacun considère la baise comme une gratification de sa personne et non la jouissance à plus d’un. Où la littérature, stérilisée par l’incapacité de nos contemporains de faire abstraction de soi.
Alors, pourquoi pleurnicher que plus rien n’est authentique – plus d’art, de héros, d’élu, de penseur, de tailleur, de cordonnier – alors que plus personne n’est capable de l’être ?
On ne pourrait plus supporter, de nos jours, quelqu’un qui n’est QUE ce qu’il est. Un jusqu’au-boutiste. On le sait, c’est embarrassant ces gens-là. Quelqu’un qui n’est jamais ironique… Un passionné, un enthousiaste, un qui n’en démord pas. Ou pire, un simplet qui ne fait rien de plus que son métier et élever ses enfants, qui n’a même pas un label de K7 ou un potager collectif pour lui. Les quelques spécimens de cette espèce n’ont jamais fait face qu’à des dos. Le dos de ces personnes ne cessant de se réinventer pour ne pas être considérées comme des fonctionnaires de l’existence. Avec ce type d’individu, quoi d’étonnant à ce qu’il n’y ait plus de «rock star qui font fantasmer les foules », de type et de nana qui passent au-dessus du lot. L’humain du XXIe siècle s’est montré bien médiocre. Au fond, nous n’avons pas encore eu l’occasion de la montrer, notre humanité : ce monde nous en tenant le plus à l’écart possible. Mais à bien nous regarder, nous ressemblant de plus en plus aux bûches que l’on jette dans l’âtre, à des outils biologiques, de simple machines à êtres dont la vie est tolérée, car elle se cantonne au paraître et à la reproduction. Alors, il faudrait se souvenir qu’il fut un temps ou les Rock Critics mouraient de faim, par amour pour cette chose si infime, si ridicule, qu’a été le rock & roll. Plus personne ne meurt pour si peu. D’ailleurs, plus personne ne meurt tout à fait : il reste toujours un sédiment, ces milliers de petites actions, de petit poke, de vote, d’avis, ce limon qui rempli l’espace infini que nous ne quittons plus, ce tombeau spacieux qui sera le nôtre : l’écran.