Son timbre est grave et son profil romain – on dirait un peu Tibère, enfin, celui de nos manuels d’histoire. On lit parfois que son style est classique et ses portraits peints au vitriol. Contradictions dans les termes ? Non, c’est assez vrai, il y a les deux chez François Taillandier, une manière de disséquer l’époque au sabre mais avec élégance. C’est à cela que l’on reconnaît les hussards.
Depuis plusieurs années, François Taillandier consacre la majeure partie de son temps à la rédaction d’une suite en cinq volumes. A mille lieues de la saga historique ou régionaliste, La Grande Intrigue est une œuvre complexe qui fait s’entrecroiser les vies de personnages attachants, d’hier et d’aujourd’hui, et qui justement dialoguent, ou essaient de la faire. C’est parfois à mourir de rire, parfois à pleurer. Fidèle à sa passion dévorante pour Balzac, lui qui « postula » en 2009 pour rejoindre les Immortels. A ce jour, trois volumes ont été publiés. On attend le quatrième en 2010.

Une première question très originale. Une suite en cinq tomes, c’est, sur le papier, un sacré défi. Aussi, comment se prépare-t-on à entamer la rédaction d’une œuvre de cet acabit ? Et, plus globalement, pouvez-vous nous raconter la généalogie de celle-ci ?
Comment ? D’une part, un constat : j’avais composé trois romans, Des Hommes qui s’éloignent, Anielka, Le cas Gentile, dans lesquels les personnages étaient fermement ancrés dans le présent. Et, finalement, surtout pour Anielka, d’ailleurs, j’ai compris la nécessité de remonter dans le temps, de raconter leur passé, leurs origines. D’où le désir d’écrire un roman qui intégrerait cette idée de temporalité longue, qui permettrait une vue panoramique au-delà de l’atomisation et des destins singuliers. La décision, ensuite, a été rapide. Lorsque j’ai parlé à mon éditeur d’une suite romanesque en cinq volumes, je pensais qu’il serait méfiant… J’en ai presque parlé « à la blague ». A ma surprise, il a dit oui tout de suite. Après quoi j’ai reçu le contrat. Je n’avais plus qu’à m’y mettre.
Mais il y avait donc, en amont, un véritable désir de…
Oui ! D’ailleurs, quelle que fût mon anxiété en me lançant dans l’aventure, je sentais que j’avais la matière… La grande question, que j’ai mis un an à résoudre, a été celle du déroulement. Je ne voulais pas m’en tenir strictement à un ordre chronologique (on commence par l’arrière-grand-mère puis on descend dans les générations), bref, reproduire le schéma de tant de sagas plus ou moins interchangeables… Et ce d’autant plus que, dans mon esprit, le temps romanesque n’est pas linéaire.
Votre suite est effectivement un permanent aller-retour entre passé et présent.
Oui. Dans le système que j’ai mis au point, aucun chapitre ne « suit » le précédent ni n’évoque le même personnage. Il ne s’agit même plus de « flash-back », mais d’un itinéraire libre dans la dimension temps. Et cela prend du sens par rapport à l’idée que je me fais des interactions entre les êtres. Le tout étant de veiller à la cohérence du total…
Comment fait-on pour ne pas se perdre ? En accrochant de grandes feuilles de papier Canson partout sur les murs ?
Beaucoup de travail préparatoire, oui, et du Canson ! Sans pour autant – j’y tenais absolument – connaître la fin dès le début. Il m’a fallu plusieurs mois avant de pouvoir m’appuyer sur un véritable protocole avec, notamment, l’idée de découper le texte en cinquante-cinq chapitres. Pourquoi cinquante-cinq ? Parce que c’est l’année de ma naissance (et, dans le roman, l’année de deux mariages décisifs) et que j’aurai 55 ans en 2010, quand la Grande Intrigue sera finie. Ce cadre arbitraire, par un paradoxe apparent, offre une grande liberté, car il est évident que c’est la contrainte qui rend libre.
Contrainte d’un genre, celui de la suite, qui n’est plus tellement à la mode. Aviez-vous conscience d’aller contre une tendance qui fait la part belle aux romans courts et soi-disant « coup de poing » ? N’est-ce pas, j’ose le mot car il sonne bien en plus, anachronique ?
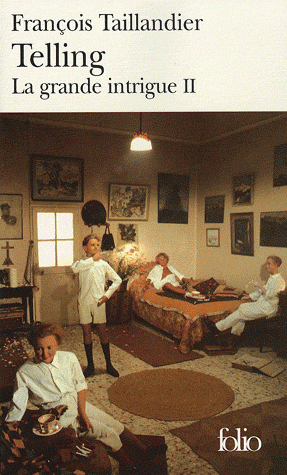 Ce n’est pas tellement un ‘genre’ que je voulais retrouver. Evidemment, j’ai songé à tous ces modèles mais, plus que le genre, c’est sa signification qui m’intéressait. La volonté d’entrer dans l’épaisseur du temps. La « suite romanesque » (je récuse le mot de « saga ») m’offrait cette possibilité. Prenez un personnage X à un moment M : peut-être que son père, son grand-père, joue un rôle, influence X au moment M sans qu’il le sache. C’est la raison pour laquelle le troisième tome s’intitule Il n’y a personne dans les tombes. Les morts sont là ! Voyez le personnage de Louise. Dans le prochain volume, que je viens de terminer, je consacre un chapitre entier aux questions qu’elle se pose sur son oncle, oncle qu’elle n’a pas du tout connu, dont elle ne sait presque rien. Pourtant, il l’obsède. Ou prenez la famille Rubien, celle de Nicolas, Juifs d’Ukraine venus s’installer à la périphérie de Paris. Ont-ils, comme le pense leur descendante Jeanne, « refoulé » leur identité juive et censuré leur mémoire ? Pour elle, des décennies plus tard, cette question présente des enjeux psychologiques, une souffrance… Maintenant, en ce qui concerne le genre lui-même, je suis un peu en porte-à-faux. On écrit aujourd’hui beaucoup de « sagas », notamment dans la littérature régionaliste ; il est évident que je ne suis pas du tout dans ce courant. Mais peut-être pas non plus dans ce qui se fait de plus up to date en littérature…
Ce n’est pas tellement un ‘genre’ que je voulais retrouver. Evidemment, j’ai songé à tous ces modèles mais, plus que le genre, c’est sa signification qui m’intéressait. La volonté d’entrer dans l’épaisseur du temps. La « suite romanesque » (je récuse le mot de « saga ») m’offrait cette possibilité. Prenez un personnage X à un moment M : peut-être que son père, son grand-père, joue un rôle, influence X au moment M sans qu’il le sache. C’est la raison pour laquelle le troisième tome s’intitule Il n’y a personne dans les tombes. Les morts sont là ! Voyez le personnage de Louise. Dans le prochain volume, que je viens de terminer, je consacre un chapitre entier aux questions qu’elle se pose sur son oncle, oncle qu’elle n’a pas du tout connu, dont elle ne sait presque rien. Pourtant, il l’obsède. Ou prenez la famille Rubien, celle de Nicolas, Juifs d’Ukraine venus s’installer à la périphérie de Paris. Ont-ils, comme le pense leur descendante Jeanne, « refoulé » leur identité juive et censuré leur mémoire ? Pour elle, des décennies plus tard, cette question présente des enjeux psychologiques, une souffrance… Maintenant, en ce qui concerne le genre lui-même, je suis un peu en porte-à-faux. On écrit aujourd’hui beaucoup de « sagas », notamment dans la littérature régionaliste ; il est évident que je ne suis pas du tout dans ce courant. Mais peut-être pas non plus dans ce qui se fait de plus up to date en littérature…
Ah oui, ça, forcément, la Province, l’Eglise : on a fait plus sexy !
Si vous voulez… Mais je reviens – j’insiste ! – sur le rapport au temps. J’ai la conviction profonde qu’une œuvre d’art entretient un rapport particulier au temps. Elle a sa propre temporalité. Sa résonnance, ce qu’elle enveloppe… Idée difficile à énoncer à une époque, la nôtre, gangrénée par l’immédiateté, rejetant la notion de durée. C’est une donnée qui me taraude. Je ne cache pas que lorsque je me suis lancé dans cette aventure, je me demandais : combien de gens liront le premier tome ? Combien voudront bien me suivre ?
Dans le premier tome, Option Paradis, il est beaucoup question de ladite Option, l’idée que l’Occident aurait été, après 1945, la victime consentante d’une grand basculement culturel, idéologique, matériel, surtout moral, en fait. Cette thèse est défendue par le personnage de Charlemagne, professeur d’université qui reste l’illustration de ce qu’il dénonce quand il drague ses étudiantes. Scénario qu’on retrouve avecJean de Malars, l’historien que l’on suit dans le troisième volume et qui trompe sa femme avec… une de ses étudiantes, avant de rendre les armes après la défaite de Chevènement en 2002. Les deux réactionnaires du roman ne sont guère à la fête !
Ah ! c’est amusant, je n’avais pas pensé au fait qu’on pouvait les rapprocher. En tout cas, oui, ce sont deux hommes plein de contradictions. Dans l’absolu, mon idée du roman, c’est qu’il doit montrer ces contradictions. Comme nous, les personnages d’un roman en sont fatalement la proie. En l’occurrence, ils sont, évoluent pleinement dans la modernité. Par définition. Ils ont chacun de grands principes, l’un ses théories sociétales, l’autre l’histoire et la politique, et puis une fille passe devant eux et… Ce n’est pas plus compliqué que cela. On peut être dans une distance critique vis-à-vis de certains aspects de la modernité, alors que dans sa propre vie on y plonge jusqu’au cou ! Néanmoins, s’ils peuvent être infidèles à ce qu’ils professent, cela ne donne pas tort à leurs idées. En outre, disons-le clairement : la théorie de l’Option Paradis, c’est un peu la mienne !
Charlemagne brasse et synthétise des questions, des thématiques que l’on retrouve dans la plupart de vos livres et chroniques.
J’aurais du mal à le cacher ! Et cela m’a amusé d’être un peu cruel avec lui. Professeur installé, charismatique, sûr de la pertinence de ses prophéties, avec ses allures de gourou… Et hanté par l’envie de séduire ses étudiantes, qui ne cèdent pas… Le contraire d’un personnage de Philip Roth ! Dans le prochain tome, vous verrez ce qu’il lui arrive ! Rien de très glorieux. D’ailleurs, c’est encore une fois lié à une femme… (…) Entre l’image que l’on a de soi, l’envie de sublimer sa propre histoire, ou l’Histoire, et la réalité sensible, effective, du présent, le pouvoir d’attraction du présent : tout le monde, je le répète, vit ce décalage. « Je ne suis pas ce que je prône » : si l’on peut dire quelque chose à propos de l’Option Paradis, c’est bien celle-là. A cet égard, Nicolas est exemplaire, qui se dit catholique, brode sur l’Eglise romaine, mais conduit sa vie comme un bobo. Mais je ne saurais dire si j’en suis un…
François Taillandier, un bobo ?
J’espère que non. A la vérité je me méfie de ce genre de catégorie. Le bobo, c’est comme le petit-bourgeois autrefois : c’est toujours l’autre !
Le plus étonnant, de prime abord, c’est Louise, la première personne à s’interroger ou celle qui s’interroge le plus concrètement, oserait-on dire, sur ce vide qu’engendre l’Option Paradis. Quand elle revient de l’enterrement de son père, elle est frappée – sans comprendre pourquoi – par… par cette question, au fond : qu’y-a-t-il dans les tombes ? Que reste-t-il en elle de son père ?
 En effet, je ne sais si l’on ne s’y attend pas mais oui, elle éprouve le besoin d’analyser cet événement et cela passe aussi par de la provocation quand elle demande à Nicolas, qui a toujours réponse à tout : « Alors, qu’est-ce que tu dis de ça ? Quelle-est ta réponse de catholique ? » Et il ne voit rien, bien entendu, il n’a rien à dire, et ce parce que sa foi est toute relative. En tant que catholique moderne, culturel, l’éternité de l’âme, il hésite à l’affirmer…. Tandis que Louise, qui ne prétend pas tout savoir… Eh bien, elle commence à comprendre. Et cette évidence va s’imposer à elle par la suite. Elle fait l’amour avec Nicolas, elle l’a fait avec beaucoup d’autres, mais c’est elle qui dit que cela devra finir un jour, que leur corps seront trop vieux, qu’il leur faudra passer à autre chose, qu’ils ne peuvent continuer de courir après leur jeunesse morte. Cette même Louise qui n’était précédemment que désir assumé, qui est incroyante, qui revendique une futilité et un goût de la consommation, pourrait bien devenir la plus mystique de toute la bande.
En effet, je ne sais si l’on ne s’y attend pas mais oui, elle éprouve le besoin d’analyser cet événement et cela passe aussi par de la provocation quand elle demande à Nicolas, qui a toujours réponse à tout : « Alors, qu’est-ce que tu dis de ça ? Quelle-est ta réponse de catholique ? » Et il ne voit rien, bien entendu, il n’a rien à dire, et ce parce que sa foi est toute relative. En tant que catholique moderne, culturel, l’éternité de l’âme, il hésite à l’affirmer…. Tandis que Louise, qui ne prétend pas tout savoir… Eh bien, elle commence à comprendre. Et cette évidence va s’imposer à elle par la suite. Elle fait l’amour avec Nicolas, elle l’a fait avec beaucoup d’autres, mais c’est elle qui dit que cela devra finir un jour, que leur corps seront trop vieux, qu’il leur faudra passer à autre chose, qu’ils ne peuvent continuer de courir après leur jeunesse morte. Cette même Louise qui n’était précédemment que désir assumé, qui est incroyante, qui revendique une futilité et un goût de la consommation, pourrait bien devenir la plus mystique de toute la bande.
Le parcours de tous les personnages, lequel forme l’intrigue du récit, s’articule autour de la sensation de vivre dans un entre-deux historique. On a l’impression que la génération qui en souffre le plus est celle de Louise et Nicolas. Leurs enfants, Alexandra et Grégory, sont quant à eux passés à autre chose. Ils ne se posent pas ces questions et, surtout, on se dit qu’ils ne se les poseront jamais.
Ils sont totalement entrés dans un autre monde. Ceux de la génération d’avant – leurs grands parents – ont, vaille que vaille, joué le jeu jusqu’au bout. Ils ont pu fauter, emprunter des voies transversales, ils sont revenus dans le droit chemin, toujours. Nicolas et Louise ont pris des libertés, divorcent, couchent à droite, à gauche, et cela très naturellement. Toutefois, ils connaissent ce qu’ils ont déserté ou abandonné, ils se posent des questions. Les enfants, au contraire, sont définitivement ailleurs. Ce sont eux qui me posent le plus de problèmes. Je pense d’ailleurs que Grégory sera le personnage principal du cinquième tome.
En racontant la vie des grands-parents, et même des arrière-grands-parents, vous montrez que, dans l’acceptation d’une certaine norme, il n’y avait alors rien de naturel.
Oui, ils voient bien que les générations se reproduisent, et ça ne va pas plus loin. Cela ne les intrigue pas. Pauline qui, dans les années 1920, quitte sa campagne pour monter à Paris, c’est un cas à part, tout à fait exceptionnel. La différence entre la génération d’avant et celle d’après, c’est que ceux de la première ne théorisent pas. (…) Dans les années 70-80. La société autorise des comportements différents, la psychanalyse devenue idéologie de masse apporte une vision nouvelle de l’individu. La dernière génération est encore au-delà de cela. Alexandra se laisse glisser dans une sorte de trip bouddhiste, se passionne pour les régimes, embrasse toutes les nouvelles libertés qui lui sont offertes. Il n’y a plus de contraintes. Tant mieux, peut-être !
Tout autre chose, à présent: la critique méthodique de l’hygiénisme, de la novlangue, de l’aseptisation de la langue. Charlemagne en parle, certes. Mais il semble que celui qui bataille le plus contre cette évolution, ou à tout le moins celui qui introduit cette critique virulente, c’est Athanase, fonctionnaire à Bruxelles. Le fait qu’il soit originaire d’Afrique, qu’il soit pour ainsi dire extérieur à cette histoire, ce n’est pas innocent, si ?
Je pense que nous sommes confrontés à deux types de novlangues : celle de la marchandise mondiale, et, ici en Europe, celle des institutions communautaires, qui est effroyable, et que je m’amuse, à travers Athanase, à parodier. Toutes deux sont porteuses d’un ordre du monde. Or, la vie ne peut pas tenir là-dedans ! Ou alors, elle finit par exploser. Le fait que cette critique vienne d’Afrique est intéressant car c’est là, je crois, que subsiste une certaine vitalité de la langue. Athanase est un rescapé, il est le résultat d’une histoire riche et difficile. Il ambitionne de devenir auteur. Il aime la langue française, il se réfère aussi beaucoup à la langue populaire d’Afrique laquelle est par sa seule survivance une épine dans le pied de celle que quelques bureaucrates veulent imposer, avec toute l’idéologie dont elle est à la fois le fruit et le support. Moi, je m’appuie sur le français classique (littéraire), et aussi sur les formes populaires.
On peut quand même affirmer que vous menez contre elle, cette langue technocratique, une guerre totale !
Il est vrai que j’accepte difficilement l’idée que, sous l’effet de la langue du marché, d’une part, et d’autre part de ce que j’ai appelé « la langue d’inox » institutionnelle, cette double culture, à la fois classique et populaire, soit condamnée à disparaître.
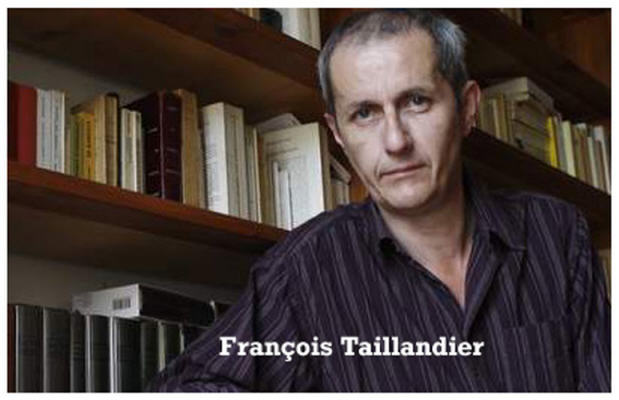
Un autre qui perd quelque chose, c’est Christophe, le frère de Louise. Dans un chapitre extrêmement onirique, il s’aperçoit qu’il a perdu… son ombre. Rentré en France, un peu troublé et après un passage par la case psychanalyse, il plonge dans la religion. Quel sens avez-vous voulu donner à cet épisode ?
Christophe travaille dans le domaine de l’informatique. C’est l’archétype même du moderne. La perte de son ombre signifie qu’il est dépossédé de sa liberté intérieure. L’idée de cette scène m’est venue à l’esprit lorsque je marchais sur une plage, au Vietnam, dans un coin complètement configuré pour le tourisme de masse, semblable à mille autres partout sur la planète. Il s’agit pourtant d’un haut lieu de l’histoire vietnamienne… Plus globalement, à travers ou plutôt grâce à cette perte, il appréhende confusément le mensonge sur lequel s’édifie sa vie. Comme beaucoup de gens aujourd’hui, il pense que la vie peut fort bien n’être qu’un empilement de voyages organisés, achats de gadgets informatiques, divertissements. Alors que la vie est faite, peut-être majoritairement faite, de choses rugueuses, douloureuses, de chagrins. Cette perte est liée à une thématique éminemment chrétienne : l’ombre est l’endroit où se développe la complexité, le mystère, en somme l’existence véritable. La réponse de Christophe à cette dépossession apparaît, dans un premier temps, un tantinet caricaturale. Après la psychanalyse, en effet, il s’enfonce dans une religiosité new-age – croit-on. De même qu’Alexandra, pour des raisons différentes, file en Israël pour suivre les enseignements d’une secte syncrétiste…
Les religions cool, syncrétistes, qu’on nous vend quotidiennement comme autant de sentiers vers un avenir radieux !
Pour sûr, elles ne sont pas hargneuses, intégristes. C’est terriblement cool, oui. Au reste, Nicolas se tourne vers le catholicisme mais par défaut, parce que c’est ce qui est culturellement et matériellement le plus proche de lui. Mais croit-il vraiment ? Son choix est davantage de l’ordre du réflexe. Non, plus j’y pense, plus je me dis que c’est Louise qui va caresser l’authenticité, une forme de vérité – en la matière, en tout cas. Elle va rafler la mise ! Louise, c’est Marie-Madeleine ! La Samaritaine ! On devine, au fil des pages, que ça l’effleure. Et quand Dieu va la dénicher, il ne va pas se tromper de cible ! Enfin, c’est ainsi que je la perçois. Je vous rappelle que j’ignore encore comment cela va se terminer. Mais bien des choses en elle renvoient à la figure fascinante de Marie-Madeleine. Elle ne paye pas de mine, elle ne se prend pas au sérieux, on ne le prend pas au sérieux, et c’est cependant elle qui va être transpercée par la grâce que j’évoquais tout à l’heure. Ce phénomène me passionne.
A plusieurs reprises on tombe sur cette phrase : « En définitive, les hommes ne font que ce qu’ils peuvent ». Phrase qui m’a semblé symbolique de votre souci de ne pas juger vos personnages, ce qui aurait été facile tant certains sont parfois antipathiques.
Jusqu’à quel point peut-on absorber les mutations du monde ? François Rubien lorgne les quatre-vingt ans et se souvient de son grand-père qui lui racontait les événements de la Commune. Et désormais, quand il allume la télé… Il arrive un moment où l’on ne peut plus absorber ces mutations, voilà tout. Toutefois, on persiste à tenter de le faire, on avance. On avance avec une infinité de souvenirs et fantômes du passé. On peut y être confronté bien avant quatre-vingt ans. Prenez Imola, l’amante de Nicolas, qui conserve un buste de Mussolini dans une commode – héritage de son père. Dans le prochain tome, je consacre un chapitre à son histoire. En adoptant son point de vue, on se rend compte qu’elle aussi a fait ce qu’elle pouvait, qu’elle a traversé des doutes, des peurs, des souffrances. Et l’on se retrouve fatalement face au thème du pardon. Cette façon de se reconnaître en l’autre, car pardonner l’autre, c’est se pardonner soi. C’est avouer sa propre incapacité, l’admettre. De combien d’amour sommes-nous capables ? Quelle capacité d’amour pouvons-nous donner malgré tout ce qui nous entraîne à verser dans des jugements tranchants et définitifs ? Je m’aperçois que l’on n’est peu apte à en donner beaucoup. Moi-même, combien puis-je en donner ? Alors oui, les hommes font ce qu’ils peuvent.






